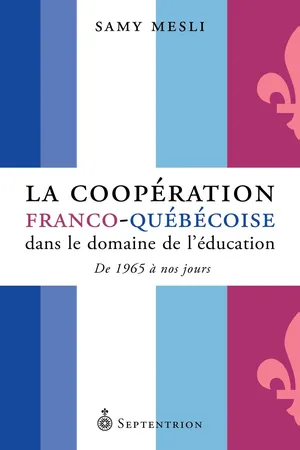CHAPITRE VIII
La coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur
À la différence de la coopération dans le domaine technique et du programme d’échanges de jeunes maîtres, façonnés de toutes pièces par les gouvernements, il existait déjà des liens entre les universités françaises et québécoises, bien avant la signature d’une entente officielle entre les deux parties. D’une part, les établissements québécois avaient pour tradition d’accueillir des enseignants français, particulièrement dans les départements de littérature française et de langues romanes. Selon les chiffres compilés par Nathalie François-Richard, on dénombrait, en 1962, huit professeurs français travaillant à temps plein à l’Université de Montréal. L’Université Laval en comptait sept, dont trois pour la seule Faculté de médecine. Des enseignants effectuaient également des missions de courte durée dans les facultés de sciences et de droit à Laval, et dans les départements de littérature, de géographie et de pédagogie à Montréal. D’autre part, la France distribuait déjà des bourses à des étudiants canadiens, leur nombre ne dépassant toutefois guère la trentaine à l’échelle du pays, la moitié allant à des élèves en provenance d’universités québécoises.
Les relations interuniversitaires s’avèrent donc particulièrement modestes au début des années 1960. Dans ce contexte, la signature de l’entente en éducation permettra une croissance rapide des échanges.
La coopération accompagne ainsi les grandes réformes du système universitaire québécois, alors en pleine expansion. Avec l’instauration, en 1961, de programmes de prêts et bourses et la généralisation de l’enseignement secondaire et collégial, le taux d’inscription des jeunes de 20 à 24 ans au premier cycle universitaire grimpe de 4 % en 1960 à 9 % en 1970, puis à 12 % en 1977. Pour faire face à l’afflux d’étudiants et décentraliser l’enseignement supérieur, les constituantes de l’Université du Québec ouvrent leurs portes en 1969.
Toutes les universités connaissent un essor important, au point où elles doivent composer avec une pénurie d’enseignants pendant ces premières années. La formation des étudiants aux cycles supérieurs et le domaine de la recherche prennent une importance croissante, et des structures particulières sont créées pour encadrer les activités scientifiques, avec l’instauration, en 1968, à Laval et à l’Université de Montréal, d’un poste de vice-recteur à la recherche. Le nombre d’étudiants inscrits à temps plein à la maîtrise et au doctorat augmente considérablement, passant de 2 307 en 1961 à 8 272 en 1971, si bien que les universités québécoises vont produire, entre 1966 et 1970, plus de diplômés que lors des dix années précédentes.
Dans ce contexte, les objectifs de la coopération intergouvernementale apparaissent clairement : encourager la formation des étudiants et des enseignants des deux pays, et soutenir l’essor du réseau d’enseignement supérieur québécois. Comme nous allons le constater, la Commission permanente déploiera de nombreux programmes pour répondre aux besoins manifestés de part et d’autre.
Les bourses d’études
Parmi les premières dispositions adoptées par les gouvernements figure l’octroi de bourses aux étudiants. Cette mesure, la plus facilement applicable, est destinée à encourager la mobilité entre les deux pays, et doit notamment permettre aux étudiants québécois de compléter leur thèse de doctorat dans l’Hexagone. Dès 1965, le ministère de l’Éducation du Québec instaure un programme de bourses de perfectionnement destiné à des étudiants québécois. Le Service de l’aide aux étudiants distribue ainsi 182 bourses en 1965-1966, et 119 l’année suivante. Les récipiendaires doivent être titulaires d’une licence universitaire pour toucher une allocation d’environ 3 500 $ pendant leur séjour en France. Comme nous le verrons plus loin, le MEQ versera également des bourses à des étudiants français : 29 en 1965, et leur nombre ira croissant par la suite.
Pour sa part, le gouvernement français décide d’augmenter le nombre d’allocations offertes aux étudiants québécois. Les chiffres cités plus tôt faisaient état d’une trentaine de bourses distribuées en 1961. En 1966-1967, on en dénombre 45 ; l’année suivante, le Québec bénéficie de 73 bourses universitaires, ce qui le place devant des pays comme la Turquie ou Israël, qui en reçoivent respectivement 61 et 42.
Le voyage d’Alain Peyrefitte au Québec, en septembre 1967, provoque une accélération. Le ministre annonce en effet l’intention de son gouvernement de porter progressivement le nombre de bourses offertes à 1 000 au cours des trois années subséquentes. Le montant de ces bourses s’élèvera à 6 750 francs, soit environ 1 500 $ canadiens, pour les étudiants en licence, et à 13 500 francs pour ceux des cycles supérieurs. Le ministère français des Affaires étrangères assurera également les frais de transport des boursiers.
Les résultats ne se font pas attendre : comme l’indique le tableau suivant, pendant l’année 1969-1970, 383 bourses « Québec-France » sont ainsi attribuées par le gouvernement français, plus de 300 l’année suivante. Si l’on ajoute à cela les récipiendaires des bourses de perfectionnement du MEQ et des bourses du Conseil des Arts du Canada, ce sont plus de 460 jeunes Québécois qui bénéficient chaque année d’un financement pour étudier en France.
Tableau 5
Nombre de bourses distribuées par le gouvernement français à des étudiants québécois entre 1965 et 1973
Source : rapports annuels du MEQ de 1965 à 1974.
Dans le cadre de ce programme, les gouvernements décident d’instaurer quelques bourses de prestige, les « bourses Champlain ». Cette mesure, inscrite dans les accords Johnson-Peyreffite, est officialisée deux ans plus tard par la Commission permanente, qui annonce la création de ces allocations, attribuées par voie de concours à des candidats au doctorat ou aux études postdoctorales « en vue d’effectuer en France des études de haut niveau, en particulier dans les domaines scientifiques et techniques ». Il s’agit de bourses conjointes, d’un montant de 45 000 à 70 000 francs, qui permettront à leur titulaire d’effectuer un séjour de deux à trois ans dans un établissement français. Selon le MEQ, ces étudiants obtiennent ainsi la possibilité « d’acquérir une meilleure connaissance des réalisations scientifiques dans les secteurs de pointe de la technologie française ». En 1970, cinq candidats sont sélectionnés parmi les récipiendaires des bourses du gouvernement français et des bourses de perfectionnement du ministère de l’Éducation du Québec. Ils sont choisis par un comité paritaire, constitué de Guy Frégault, commissaire général du Service de coopération avec l’extérieur du MEQ, de son adjoint Pierre Langevin, ainsi que du consul de France Pierre de Menthon, et de Napoléon Leblanc, vice-recteur de l’Université Laval.
Après le sommet atteint au tournant de 1970, le nombre de bourses décroît, pour se stabiliser à 125 allocations en 1973, date de l’entrée en vigueur des projets intégrés auxquels seront désormais associés chercheurs et étudiants. Les échanges se poursuivront par la suite, mais il convient de souligner que, durant ces huit premières années, le gouvernement français a distribué plus de 1 300 bourses, contribuant ainsi à la forte présence d’étudiants québécois dans l’Hexagone.
En effet, les programmes de cycles supérieurs étant encore peu développés, nombre d’étudiants vont en France compléter leur formation. En 1968, on compte, selon Claude Galarneau, 4 000 à 5 000 Québécois présents en France. Des chiffres semblables sont avancés par Denis Monière, qui note que pendant « les années fastes de la décennie soixante-dix, on dénombrait chaque année environ 5 000 Québécois » inscrits aux études supérieures dans l’Hexagone. La majorité d’entre eux se dirige vers la région parisienne, mais également vers les grands centres universitaires régionaux comme Bordeaux, Aix-en-Provence ou Strasbourg. En 1969, un observateur québécois, de passage dans la capitale alsacienne, dresse un portrait étonnant :
Depuis [la fin des années cinquante], de très nombreux étudiants et chercheurs viennent à l’université de Strasbourg, notamment au Département de géographie et au Centre de Philologie romane (section de langue et littérature françaises), mais aussi en psychologie, en sociologie, en sciences, et ils poursuivent des études de spécialisation en vue d’un doctorat. Dans le seul domaine de la linguistique et de la littérature françaises, une quinzaine de Québécois dont la plupart enseignent dans les universités Laval, de Montréal et de Sherbrooke, sont docteurs de l’Université de Strasbourg ; plusieurs d’entre eux ont fait des thèses sur la langue ou la littérature du Québec. Cette année [1969-1970], au moins huit étudiants québécois, de maîtrise ou de troisième cycle, travaillent au centre de philologie romane. […] Le nombre total de ces étudiants et chercheurs s’élève à Strasbourg, chaque année, à 70 ou 80 au moins.
En 1966, une poignée d’étudiants fonde l’Association générale des étudiants québécois en France (AGEQEF), qui a pour objectifs de faciliter l’intégration de ses membres à la société française, d’être le porte-parole en France du monde étudiant québécois et de faire connaître le Québec aux Français. Pour la somme de 10 francs, ses membres bénéficient de différents services, comme un bulletin de liaison avec une revue de presse québécoise, un service de récupération des appartements laissés vacants par leurs prédécesseurs, un fonds de dépannage pour les personnes en difficulté financière temporaire, etc. L’association organise également des conférences et des tables rondes avec des personnalités québécoises et françaises. Parmi les revendications figurent l’augmentation du montant des bourses et la création à court terme d’un foyer-résidence pour les étudiants québécois. L’association sera dissoute en 1976, alors que le flux d’étudiants québécois vers la France tend à diminuer.
La présence de ces milliers de jeunes Québécois dans l’Hexagone constitue l’un des faits marquants de cette période. Après l’obtention de ...