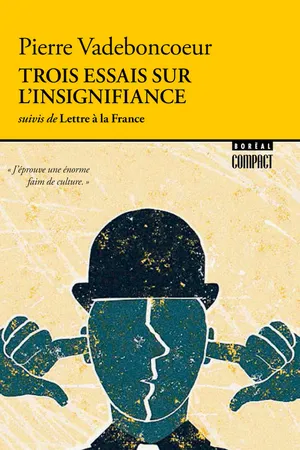![]()
1
La parabole du néant
Il y a un débat jamais conclu touchant l’effet de la culture. Le problème se pose à peu près comme ceci : pouvons-nous nous trouver dans une relation parfaitement légitime avec elle ? Peut-elle ne pas amoindrir ou ruiner notre authenticité première ? Loin de nuire à celle-ci, confère-t-elle au contraire à l’homme des moyens additionnels de dégager sa vérité ? Ceci ne sera pas tout à fait le sujet de cet essai, mais c’en est le commencement.
C’est un débat qui se déroule assez indirectement, assez peu franchement dirais-je même. La culture est suspecte comme une addition. De toute façon, quand la directe nature passe outre à une idée de la culture, ce qui est fort fréquent, alors on a l’impression que c’est une vérité libérée qui passe devant…
Ce problème n’est pas clair. Tantôt l’on prend le parti de la culture, tantôt celui de la nature, selon qu’on envisage les malheurs que fait l’une ou l’autre ; mais on choisit entre elles pour des raisons confuses – et même sans raison aucune, autrement dit suivant l’inclination ou bien le préjugé qu’on a. Les Québécois ont dépouillé en vingt ans le principal de leur culture : croyances, mœurs, rites, imaginaire, préférences ancestrales ; bouleversé leur organisation sociale, famille, école, paroisse, économie de gagne-petit ; répudié leurs maîtres traditionnels, leurs conseillers séculaires. Quand le mouvement de vérité se fait vers la nature, contre la culture, ce n’en est pas moins un mouvement de vérité. On le ressent d’ailleurs ainsi. Il était évident que par certains côtés celui-là nous libérait. Mais culture, nature, on ne peut vraiment juger cela qu’au terme d’une expérience, donc après coup, quand tout vieillit et tombe – quand de nouveau il faut fuir !
Aujourd’hui, par exemple, en divers endroits du monde, c’est avec effroi qu’on commence à mesurer les effets de la ruine de la culture, ruine je ne dis pas moderne mais toute contemporaine. Je ne me pose pas la question de savoir si la culture est un ajout plus ou moins artificiel et qui ferait que l’homme, additionné de culture, deviendrait faux en quelque sorte : j’éprouve une énorme faim de culture, de quelque chose de radicalement éloigné de ce qu’est devenu le comportement d’une humanité s’écartant sans cesse de tout enseignement qui l’obligerait en l’exaltant, et se rapprochant toujours de ce qui ne requiert aucun enseignement pour être poursuivi. Mais j’espère montrer que cette faim correspond à une nécessité essentielle et que par conséquent la culture gagne d’emblée le procès qu’on veut lui faire.
C’est en lisant The Postman Always Rings Twice, de Cain, que j’ai vraiment entrevu l’extrémité où conduit la liquidation de la culture. La situation n’est plus la même qu’il y a seulement trente ou quarante ans, alors que la pensée restait malgré tout tributaire d’une idée capitale d’exigence et où les contestations réciproques se faisaient surtout entre gens proposant respectivement des philosophies du dépassement, fût-ce malgré l’absurde. Il y avait encore, dans les sociétés, un esprit tout disposé à recevoir de grands messages. On est maintenant loin de ce temps-là. Mais ce n’est pas à la façon dont on était, hier, éloigné de ce qui avait précédé ; ce n’est plus selon les lois d’une dialectique ancienne dans laquelle une pensée répondait à une autre pensée en s’y opposant, certes, mais en continuant la philosophie elle-même. Peu importe ici ce que ces produits valaient. Voici ce qui est nouveau : l’inculture, dans la société, a fait des progrès stupéfiants. Il y a moins d’antécédents philosophiques et parallèlement moins d’expectatives philosophiques que jamais, sauf, dans un état d’incohérence, chez une fraction de la jeunesse. Dans un pays comme le Québec, par exemple, la religion, qui faisait jadis dans le peuple un fond philosophique considérable, est en grande partie disparue et n’a pas été remplacée. La plus étrange simplification est survenue dans un laps de quelques dizaines d’années, ici comme ailleurs ; dans les masses, la connaissance de la culture et par conséquent la culture ont largement été éliminées. Pour une vaste partie de la population et pour une fraction encore plus grande de la jeunesse, l’humanité pensante a à peine cinq ans, si elle les a. Les sources, pour elles, ne sont-elles pas la télévision, la publicité, la pensée du commerce, la dernière rage, et c’est à peu près tout ? Les personnages de Cain, dans le roman cité, écrit annonciateur daté de 1934, produit de l’Amérique, sont tout entiers dans leur actualité immédiate, dans la jouissance, dans le meurtre, dans le vol, dans la pensée de tout cela et dans celle de l’argent aussi ; coupés des lettres, privés du Livre, bien entendu, mais étrangers aussi à toute intelligence ancestrale des choses, à tout héritage spirituel jadis transmis par la famille, l’école ou l’Église ; nouveaux barbares, damnés de l’ignorance, non pas l’ignorance populaire de jadis, qui n’en était pas une puisque le peuple était enseigné, mais une ignorance comme il ne s’en était généralement pas trouvé encore dans l’histoire, dans une histoire depuis toujours éclairée par la sagesse et par les cultes. Hélas ! le petit monde de démence et de convoitise qui fait l’univers de ce roman préfigure la décadence actuelle et ne connaît pas une seule pensée !
Comprend-on bien la nature de ce mal ? C’est la question de la culture qui se pose dans cette œuvre. L’auteur ne distinguait peut-être pas lui-même la portée de celle-ci, car il est possible en effet qu’il l’ait écrite prophétiquement, c’est-à-dire à l’occasion d’une lecture spontanée et inconsciemment divinatoire d’un cas particulier, d’un cas confié pour lors et comme indirectement à un artiste, lequel n’y verrait quant à lui que matière d’art. Ce roman ne pouvait guère alors voir le jour qu’aux États-Unis, pays en avance par son état de conscience sur ce qui viendrait et se répandrait partout, en bonne partie sous l’influence de l’Amérique au demeurant. Choisir le sujet d’un couple assassin et de tout un entourage qui comme lui présenterait une conscience absolument vide d’éléments moraux même hérités du milieu social ou tenant à des sentiments innés de l’individu, de sorte qu’aucun des personnages n’aurait en somme un comportement qu’on pût qualifier d’humain, ou de politique, ou de religieux, il me semble que cette prouesse aurait été difficilement concevable en Europe. L’Amérique devait certainement s’exprimer jusqu’à un certain point, en Cain, par ce choix, par ce traitement. Faits bruts et consciences brutes. Même chez Stendhal, on ne voit pas cela : dans Le Rouge et le Noir, par exemple, une femme, au moins, y représente la faculté d’aimer. Il paraît que l’œuvre de Cain a agi sur Camus, mais dans ce cas avec quel retentissement, justement, sur une culture ! Chez Cain, apparemment, rien. Le sujet est assumé entièrement comme il est, glacialement, par l’auteur, d’ailleurs à l’exemple de ses personnages. L’écrivain fait une sorte de policier. Peut-être, je ne sais, croit-il effectivement écrire un policier, ce qui serait sans conséquence. Or cette histoire traverse dans la littérature. Un événement révélateur et d’une étonnante signification s’est donc produit. Quelque chose s’est soudain manifesté dans cette œuvre en principe perdue parmi d’autres. Camus, dit-on, en a été frappé ; c’est donc qu’une réalité nouvelle, incroyable pour l’héritier d’une culture millénaire, mais une réalité présente dans ce livre, laissait entrevoir, ne serait-ce que fugitivement, un temps où des masses d’humains, façonnés à l’américaine et selon l’indifférence capitaliste (et maintenant socialiste) pour les valeurs, n’escompteraient plus rien de l’esprit. On donnerait entre autres un nom à ces populations, sans voir autre chose dans ce nom que sa signification économique et simple : ces foules, on les appellerait les consommateurs, en vérité une nouvelle race apparue, aussi originale culturellement parlant que tel ou tel type morphologique d’humanité l’avait été physiquement à certains âges géologiques. Race inouïe, sans exemple. Il y aurait toute une société perdue, déshéritée. Les personnages du roman de Cain, tous, sans exception, sont spirituellement stupides. Très intelligents pour la plupart, par ailleurs. Leur culture, par quelque côté qu’on la considère, est nulle, et ils n’offrent même pas le reflet, le reste, le résidu d’une culture qui aurait jadis existé, sinon en eux, du moins dans leur ascendance ou dans leur civilisation. Leur nature elle-même, qui pourrait comporter des sentiments susceptibles de tenir lieu d’une culture (bonté, remords, pitié, sensibilité imprévisible et variable), exclut tout cela, de sorte que personne ne fait sur ses actes ou sur ses intentions le retour de la moindre réflexion. En outre, pas de frère, pas de sœur, pas de père, pas de mère, pas d’enfant ; il n’y a personne auprès d’eux qui tout à coup ferait luire le moindrement une idée dans une conscience…
Résumons l’œuvre en quelques lignes pour l’intelligence du présent essai. Ce roman, qui met en scène deux amants et un mari visqueux, imbécile et bonasse, est le récit de deux complots successifs de la part de ceux-là pour assassiner celui-ci, puis du meurtre, du procès et d’un dénouement. Pour chaque personnage, il s’agit seulement d’avoir ce qu’il veut, comprenez-vous ? L’homme engagé, qui est l’amant, veut la femme de ce mari, qui est le patron ; celle-ci veut l’homme engagé ; le patron, qui est un crétin ridicule, ne veut rien, mais les deux premiers veulent sa mort ; le procureur veut la tête des assassins, l’avocat de la défense veut leur argent ; des représentants des assurances ne veulent rien payer ; l’homme à tout faire de l’avocat veut après coup faire chanter l’homme engagé et la femme, grâce à un document encore compromettant, de manière à prendre tout leur bien et même un peu plus ; tout le monde à peu près veut tromper tout le monde, à n’importe quel prix.
Camus, comme artiste, doit avoir été étonné par le regard absolument direct de Cain, exactement le même que celui des personnages, ni l’un ni l’autre n’étant infléchi par quelque polarisation spirituelle. C’était un regard purement violent, matter of fact, invraisemblable pour l’Europe d’il y a quarante ou cinquante ans, surprenant, pourtant seul capable de rajeunir l’attention en la fixant durement sur des réalités inédites dans lesquelles n’entrait précisément aucune part de culture – c’était un regard donc idoine. Un écrivain européen aurait peut-être observé le phénomène d’inculture, comme je le fais ici, ou il l’aurait interprété, par culture, comme Camus, l’affectant dès lors d’un signe exactement contraire à son signe d’origine ; jamais le coup d’œil qu’il aurait porté n’eût fait un avec le spectacle et n’eût été observable au même titre que lui et du même angle. Il faut prendre les choses où elles originent, l’art nègre par exemple en Afrique et jadis, ou le flamenco en Espagne. La barbarie américaine, comme n’importe quel fait authentique, ne connaît pas de traducteur, elle ne connaît que des acteurs. De même, pour annoncer une modernité, il faut être de cette modernité. Pour dire la non-réflexion, il ne faut pas avoir de réflexion. Les Européens pouvaient bien être surpris et fascinés ! Toute chose qui a quitté l’état de fait risque de moins intéresser. Or ils constataient que l’Amérique était le fait même. Le drame (ou plutôt la comédie ?) raconté par Cain n’excédait pas ce factuel américain. Cain traitait ses personnages comme ses personnages traitaient la vie. Brutalement. Il y avait identité. Son livre allait directement à eux comme ils allaient directement à l’objet de leur désir. Il faisait par eux le geste américain, plus généralement le geste d’une certaine modernité, un geste matériel. Il le reproduisait lui-même, pour son compte, en racontant, sans plus, leur concupiscence radicale. Il ne mettait pas de sens entre l’auteur et eux, comme ceux-ci n’en mettaient aucunement entre eux-mêmes et ce qu’ils cherchaient à prendre. Cain narrait, strictement.
Je me figure que Camus dut être séduit par un échantillon d’univers dans lequel ne s’insinuait aucune explication, fragment de monde qui était un pur fait. La pensée de l’absurde ne saurait être mieux encouragée. Un pareil livre fait apparaître une absence de philosophie, qui semble montrer qu’il n’y a pas de philosophie. Ce morceau d’existence est en outre une pièce à conviction. Entre les mains d’un désespéré de la métaphysique, polémiste tenant à son idée comme presque tous les penseurs d’Occident, cette pièce à conviction qu’est l’univers sans âme de Cain confirme Camus dans la justesse de sa pensée. Vous voyez bien, doit-il se dire. Que l’univers puisse produire une société comme celle de Frank, Cora et les autres, c’est en soi une absurdité, donc la réalisation objective de l’idée camusienne.
De l’absurde, cette petite société romanesque horrible porte témoignage et elle fait entendre une accusation qui ne soulève pas le moindre écho d’un infini. L’énigme est là, résolue par son propre silence. Le manque de réponse y est absence de réponse. Un Camus tient là la réalité en même temps que la figure de ce qu’il pense. Qu’il puisse y avoir au monde ne serait-ce qu’un îlot de mal où l’on soit privé de toute lueur d’espoir, cela porte accusation irrémissiblement.
Chez Camus, néanmoins, l’interrogation était si profonde, si grave, que je crois qu’elle en était ambiguë, en ceci que sa négation du sens de l’être était comme une accusation, justement, par conséquent comme un appel, car on n’accuse pas un mur, on accuse ce qu’il peut y avoir derrière le mur. Le fait d’obtenir, comme dans ce roman, une certaine confirmation de sa propre pensée sur l’absurdité du monde avivait l’accusation qu’il lançait contre celui-ci. Cela veut dire secondairement qu’il pouvait en ressentir je ne sais quelle secrète joie de penser que cette accusation, peut-être, ne fût pas fondée. Il y a de l’amour dans certaines haines, l’homme sait cela depuis longtemps. Il y avait tristesse : la tristesse est un commencement de joie. Camus désirait-il au fond de lui-même ruminer, remuer ses raisons de croire que l’univers n’eût aucun sens ? Il pouvait ainsi attiser son sentiment contre lui, ce qui était rallumer son sentiment pour lui. Ces choses-là sont bien cachées. Elles sont doubles. Elles sont croisées. La désespérance de Camus est à mon avis un peu de l’espérance. Sa négation, un peu une affirmation. L’espoir de Sartre, existence, liberté, est au contraire pour moitié et davantage un désespoir. La logique voudrait, pour chacun d’eux, qu’ils cessent d’écrire ; l’un pour attendre et désirer, l’autre pour se tuer. Le pessimiste attendrait, l’optimiste se suiciderait. Or ils ne font ni l’un ni l’autre. Ils écrivent. Cela ne peut être que significatif. Rien à voir cependant avec monsieur Cain. Camus et Sartre sont des représentants de la culture. C’est l’Europe.
Nous voilà donc entre Européens. On a beau s’étonner de l’Amérique, comme Camus, je suppose, devant Cain, ou comme Simone de Beauvoir excitée par les États-Unis dans le voyage qu’elle nous raconte, on ne se change pas. Justement, le coup d’œil européen, que fait-il voir ? Je m’en tiens ici au sujet de mon interrogation initiale sur la valeur de la culture. En Europe, il s’agissait de la conscience, même chez des intellectuels qui préparaient inconsciemment depuis des générations quelque nihilisme final. Le débat se poursuivait, à un certain niveau faut-il dire. Mais l’Amérique était bien autre chose.
Quand Lottman, dans La Rive gauche , constate que Paris n’est plus la capitale intellectuelle du monde et que les écrivains-oracles se sont éteints et l’influence du Quartier latin avec eux, sur quoi donc met-il le doigt ? Sur une chose redoutable, je crois, mais il n’en parle pas. Au moment où la France est tombée avec fracas pour ne plus retrouver son rang qui avait été le premier parmi les peuples, une autre chute, plus ou moins distincte de la première, s’est produite dans le monde, silencieusement, celle de la culture. (Il ne s’agit pas d’une relation de cause à effet ; je parle de deux phénomènes contemporains, mais curieusement concomitants à vrai dire.) Il ne suffit pas d’écrire que Paris a cessé d’être la capitale du monde. Ce qu’il faut dire, c’est qu’il n’y a plus eu de capitale du monde et singulièrement plus de centre philosophique, artistique et littéraire universel, où que ce fût. Rien n’a succédé au Quartier latin, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Lottman, du reste, remarque que, à cause de la bombe atomique, ce sont les scientifiques que l’univers s’est mis à écouter. Si la France a vu tomber l’avantage extrême dont elle jouissait, on peut donc se demander en effet si l’accident dont il s’agit ne tient pas plutôt au fait, bien plus général, que c’est la culture elle-même qui a perdu son crédit dans le monde, y compris en France, y compris en Europe, sur lesquelles ont déferlé des courants venus d’ailleurs qui ont relativement tout abaissé, en particulier le renom de la culture et l’importance reconnue aux pensées. Je ne tenterai pas d’énumérer les causes d’un tel phénomène. Mais je vois bien que quelque chose d’aussi divers qu’incommensurable, dans l’univers, tue ce qu’on peut appeler d’un autre nom : le regard porté sur le bonheur de l’âme, le désir qui s’ensuit. Huxley, autre écrivain des années trente, annonçait aussi que la culture deviendrait quelque chose d’étranger et qu’il n’en serait même plus question.
Les affrontements entre spiritualistes et matérialistes, au xixe siècle, étaient encore, essentiellement, des tournois se déroulant dans le champ de la culture. On ne s’évadait pas de cette dernière, à cette époque. On se fût complètement discrédité à le faire. La société ne l’avait pas désertée ...