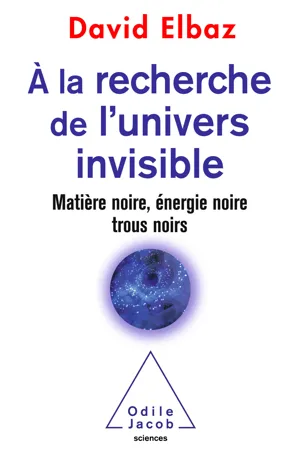Fritz Zwicky et l’enquête qui révéla l’existence de la matière noire
Le crime sur lequel enquêtèrent les scientifiques au début du XXe siècle continue de se produire au moment même où vous lisez ces lignes. Ses victimes, les atomes de l’atmosphère terrestre, perdent leurs électrons attaqués par une source d’énergie invisible. On pensa d’abord que l’énergie en cause venait de la radioactivité des roches terrestres à la suite de la découverte de la radioactivité par Pierre et Marie Curie à la fin du XIXe siècle. Le père jésuite Theodor Wulf, passionné de science, décida donc en 1909 de réaliser une expérience pour le vérifier. Il suffirait de monter en altitude pour vérifier que l’effet diminuait en s’éloignant du sol. Le père Wulf, muni d’un petit électroscope de sa construction, monta au sommet des 324 mètres de la tour Eiffel et découvrit avec étonnement que son électroscope se déchargeait aussi bien en haut qu’en bas. Cela signifiait que les atomes perdaient autant d’électrons au sommet de la tour qu’au sol. Bizarrement, la distance à la source de rayonnement ne diminuait pas ses effets. Quand l’histoire arriva aux oreilles du physicien autrichien Victor Hess en 1912, celui-ci décida de reproduire l’expérience en montant plus haut grâce à une montgolfière. À une hauteur de 1 kilomètre au-dessus du sol, les atomes continuaient de perdre leurs électrons avec la même intensité. Le scientifique ne se découragea pas et continua de monter. Il découvrit alors un phénomène profondément troublant : au lieu de diminuer, l’effet augmentait avec l’altitude ! La source d’énergie qui brisait les atomes de notre atmosphère ne venait pas du sol mais de l’espace… Un rayonnement d’une puissance extraordinaire en provenance du cosmos, et d’origine totalement inconnue.
Le prix Nobel de physique Robert Millikan baptisa l’arme du crime du nom de « rayonnement cosmique », et il vit dans cette source d’énergie prodigieuse la preuve du « processus divin de création continue de la matière ». Seuls des « rayons cosmiques » nés des « cris d’atomes nouveau-nés » dans l’espace interstellaire pouvaient, selon lui, posséder l’énergie suffisante pour éplucher nos atomes de leurs électrons. Il pensait que les noyaux d’atomes fusionnaient dans le milieu interstellaire en libérant de l’énergie sous la forme de rayons gamma, au cours de ce qu’il appela dans une interview la « création continue de dieu en action ». Les particules de lumière très énergétique libérées lors des hypothétiques fusions nucléaires devaient bombarder la Terre.
Le 27 octobre 1932, la Fondation pour le mémorial Roosevelt récompensa Millikan de sa médaille d’or pour l’« invention » des rayons cosmiques et le qualifia de « prophète des temps modernes, apportant aux hommes égarés la nouvelle de la présence et de la bonté de Dieu, dans les mondes des atomes et des étoiles1 ».
Un jeune professeur de physique d’origine suisse, qui travaillait dans l’équipe de Millikan, voyait d’un très mauvais œil ce mélange de propos religieux et scientifiques. Il s’appelait Fritz Zwicky. Un jour, il vint trouver Millikan et lui dit :
« Monsieur Millikan, j’ai lu tous les articles que vous avez écrits, j’ai écouté toutes les conférences que vous avez données, et je peux vous dire catégoriquement que je n’ai jamais trouvé la moindre idée originale que vous puissiez honnêtement revendiquer comme la vôtre.
– Très bien… et vous ?, répondit Millikan au jeune physicien.
– J’ai une idée originale tous les deux ans et j’irais même plus loin : nommez le sujet et je vous apporterai l’idée nouvelle. »
La réponse de Millikan conditionna le reste de l’existence de Zwicky :
« Très bien jeune homme, l’astrophysique. »
Le défi lancé par Millikan conduisit Zwicky à partir à la recherche du criminel, de la source d’énergie qui épluchait les atomes de notre atmosphère de leurs électrons. Au cours de cette recherche, Zwicky allait mettre la main sur une autre source d’énergie inconnue, encore plus mystérieuse.
Fraîchement diplômé de l’école polytechnique de Zurich, vingt ans après Einstein, Zwicky rencontra en août 1925 le président de la Fondation Rockefeller qui lui proposa un financement pour travailler deux ans aux États-Unis, à l’endroit qu’il souhaiterait.
« Là où on peut trouver des montagnes », répliqua le jeune physicien amateur d’escalade et de ski qui se retrouva ainsi projeté dans la fameuse université de technologie de Californie, Caltech, pour y travailler sous la tutelle de Robert Millikan. À peine arrivé, il questionna son prestigieux hôte sur un thème inattendu :
« Où sont les montagnes pour l’escalade ?
– Vous ne les voyez pas ?, demanda Millikan en pointant le mont Wilson culminant à 1 900 mètres d’altitude.
– Je vois bien quelque chose, mais seulement des collines », grommela Zwicky2. Rapidement nommé professeur assistant à Caltech, Zwicky y effectua l’ensemble de sa carrière.
Le physicien suisse combinait une intuition géniale avec un caractère parmi les plus difficiles de la profession, où il en existe beaucoup. Zwicky traitait ses collègues de spherical bastards, abrutis sphériques. Quand on lui demandait : « Pourquoi sphériques ? », il répondait que leur comportement d’abrutis ne variait pas, quel que soit l’angle sous lequel on les regardait… Sphériques, car lisses, sans aspérité, sans capacité abrasive sur le réel, en d’autres termes incapables d’émousser la croûte qui recouvre le monde derrière laquelle se cache la beauté des lois physiques et mathématiques de l’univers.
Au moment du défi lancé par Millikan, Zwicky ne pouvait se vanter que de quelques écrits théoriques sur l’astronomie. Mais après cela, il s’attaqua sans tarder au problème de l’origine mystérieuse des rayons cosmiques. Il savait qu’un autre prix Nobel de physique proposait une explication différente pour cette source d’énergie cosmique. Selon Arthur Compton, il ne s’agissait pas de particules de lumière, mais de particules de matière accélérées dans l’univers par l’effet auquel il donna son nom, l’« effet Compton ». Un mécanisme qui permettait à la lumière de donner son énergie à des particules de matière.
Zwicky pencha pour l’hypothèse de Compton quand il apprit que des mesures montraient une variation du taux d’ionisation de l’atmosphère terrestre entre les pôles et l’équateur. La différence entre ces deux régions de la surface terrestre vient de l’intensité du champ magnétique, or les photons ne subissent pas de déviation par le champ magnétique terrestre contrairement à des particules électriquement chargées, comme des électrons ou des protons. Il restait à découvrir quelle source d’énergie dans l’univers pouvait projeter des particules avec une puissance suffisante pour ioniser l’atmosphère terrestre.
Que feriez-vous confronté à une telle question ?
Imaginons un détective qui arrive sur la scène d’un crime. La victime, effondrée sur le sol, porte la marque d’une blessure par balle. La réaction du détective consiste dans un premier temps à chercher l’impact de la balle dans le mur et, si possible, la balle elle-même. Dans un second temps, celui qui nous concerne ici, il cherche à identifier l’arme du crime, son calibre, sa marque et le fournisseur qui le conduira à l’auteur du crime. Zwicky partit donc en quête de la source d’énergie de ces balles qui nous traversent en permanence. Il ne savait pas alors que son enquête le mènerait sur la voie des plus grandes découvertes du XXe siècle.
Seul un phénomène violent et très énergétique pouvait accélérer des particules de matière avec une énergie assez grande pour arriver sur Terre et ioniser les atomes de l’atmosphère. Il existe deux grandes sources d’énergie dans l’univers : la fusion nucléaire et l’énergie gravitationnelle. Et contrairement aux idées reçues, la seconde possède une plus grande efficacité que la première.
Pendant son existence, une étoile rayonne de l’énergie sous la forme de lumière grâce aux fusions nucléaires qui se produisent en son cœur. Une fois le combustible épuisé, les étoiles plus massives que 8 masses solaires s’effondrent sur elles-mêmes et libèrent leur énergie gravitationnelle sous la forme de lumière au cours d’une explosion. Zwicky proposa d’expliquer l’origine de l’énergie des rayons cosmiques par la transmission de l’énergie de cette lumière à des particules de matière par effet Compton. Sûr de son explication, il décida de partir en quête de ces sources d’énergie dans l’univers, car celles que l’on connaissait ne possédaient pas assez d’énergie.
Nous savons aujourd’hui que les rayons cosmiques viennent bien de l’explosion d’étoiles qui accélèrent des particules de matière à des vitesses proches de celle de la lumière par un mécanisme légèrement différent qui se produit après et non pendant l’explosion. Avec leur vitesse prodigieuse, les particules traversent la matière sans aucune résistance. Seuls quelques rayons cosmiques interagissent avec la Terre et ionisent les atomes de l’atmosphère ou de notre propre corps. On pense d’ailleurs que certaines mutations génétiques viendraient de l’impact de rayons cosmiques.
La plupart des rayons cosmiques traversent notre corps sans aucune interaction avec notre peau, nos organes, muscles, cellules, molécules et atomes au rythme de 200 rayons cosmiques à chaque seconde. Entre le début et la fin de cette phrase, quelques milliers de rayons cosmiques auront traversé votre corps sans vous causer la moindre sensation, après un voyage de plusieurs millions d’années dans l’univers…
Fritz Zwicky connaissait l’existence d’événements violents dans l’univers, que l’on dénommait des novae depuis leur découverte par l’astronome danois Tycho Brahe. En 1572, ce dernier découvrit une nouvelle étoile visible en plein jour. Une nova stella. Il répertoria sa position nuit après nuit. Contrairement aux planètes, la nova de Brahe ne dessinait pas de « parallaxe », un mouvement apparent lié à notre propre mouvement autour du Soleil. L’absence de parallaxe la reléguait à une distance aussi lointaine que les étoiles. Or l’Église continuait de prôner la théorie d’Aristote adoptée par Thomas d’Aquin au XIIIe siècle. Selon le philosophe, aucun changement ne pouvait se produire dans le monde parfait et éternel des dieux situé au-delà de la Lune. L’absence de parallaxe de la nouvelle étoile de Tycho Brahe invalidait la théorie d’Aristote, et donc aussi celle de l’Église : la nouvelle étoile témoignait d’un changement apparu dans le monde divin. Le cosmos ressemblerait désormais au monde terrestre, affecté par le temps, soumis aux changements. Par une chance exceptionnelle, son assistant Johannes Kepler découvrit à son tour une nova en 1604. Une chance exceptionnelle, sachant que depuis cette date, aucun astronome ne vit plus jamais de nova à l’œil nu dans notre Galaxie.
Il faut remonter plus...