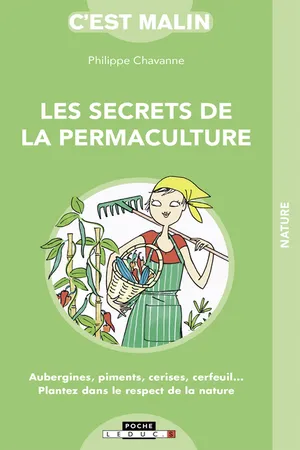Si l’on se réfère à une célèbre encyclopédie disponible sur Internet, la permaculture est « une méthode systémique et globale qui vise à concevoir des systèmes [...] en s’inspirant de l’écologie naturelle (biomimétisme) et de la tradition. Elle n’est pas une méthode figée, mais un “mode d’action” qui devra prendre en considération la biodiversité de chaque écosystème. Elle ambitionne une production agricole durable, très économe en énergie (autant en ce qui concerne le carburant que le travail manuel et mécanique) et respectueuse des êtres vivants et de leurs relations réciproques, tout en laissant à la nature “sauvage” le plus de place possible. »1
La définition proposée par cette encyclopédie est correcte. La permaculture, c’est ça ! Mais c’est bien plus encore…
UN CONCEPT MADE IN AUSTRALIA
Nous sommes dans le courant des années 1970. Bien loin des rives de la Seine, du bocage normand ou des plantations de chênes truffiers du Périgord. Bien loin des vignobles du Bordelais ou des oliveraies des bords de Méditerranée. Bien loin de la France et de l’Europe. Nous sommes aux antipodes de nos contrées. Nous sommes en Australie.
Deux environnementalistes, David Holmgren et Bill Mollison, font un constat effrayant : les méthodes agro-industrielles de plus en plus utilisées partout dans le monde sont aussi dangereuses que contre-productives. Elles empoisonnent les sols, les végétaux, les animaux et les hommes. Elles détruisent l’indispensable biodiversité. Elles érodent des millions de tonnes de terre qui, jusqu’alors, étaient pourtant fertiles. Et, en plus, leurs rendements restent très moyens, voire médiocres, et s’avèrent insuffisants pour nourrir la population mondiale.
Ils jettent donc les bases d’une nouvelle technique culturale respectueuse des végétaux, des sols, de l’air que l’on respire, de l’eau, du monde animal et… des hommes. Ils créent un concept 100 % éthique et d’une réelle efficacité, capable d’être employé de manière très concrète afin de créer des systèmes agricoles stables. Leur concept repose sur une agriculture durable faite de cultures multiples judicieusement associées, en parfaite synergie avec le monde animal et l’homme.
LES TROIS BASES ÉTHIQUES DE LA PERMACULTURE
La permaculture est un concept qui se veut avant tout fondamentalement éthique. Par opposition, notamment, aux techniques nocives utilisées par l’agriculture industrielle et par le secteur agroalimentaire.
Les valeurs fondamentales de la permaculture reposent sur trois solides piliers fondateurs :
> respecter et prendre soin de la nature nourricière au sens large du terme (les sols, l’air, l’eau, les bois et forêts…),
> respecter et prendre soin de l’être humain (à titre individuel et collectif, dans le présent et pour les générations futures),
> parvenir à créer une véritable abondance et redistribuer équitablement les surplus de production.
Leur réponse saine et durable aux méfaits de l’agriculture industrielle prend le nom de « Permanent Culture ». Autrement dit, en français, « agriculture permanente ». Assez vite cependant, l’appellation anglophone est raccourcie et se transforme en « permaculture » : un terme qu’ils utilisent pour la première fois dans leur ouvrage de référence, Permaculture One, paru en 1978.
S’ils ont largement contribué à diffuser le concept et le mot, ce dernier n’est pourtant pas une véritable nouveauté. Il a déjà été utilisé, de manière plus discrète il est vrai, au début du XXe siècle, en 1910, par l’agronome américain Cyril Hopkins dans son livre Soil Fertility and Permanent Agriculture.
DE L’AGRICULTURE PERMANENTE À LA CULTURE DE LA PERMANENCE
Tout cela étant précisé, encore faut-il souligner le fait que la signification même du terme « permaculture » a vite évolué et s’est rapidement élargie. L’agriculture permanente a peu à peu cédé la place à la « culture de la permanence ». En effet, les deux environnementalistes australiens, comme d’ailleurs tous ceux qui leur ont emboîté le pas, se sont rendu compte que cette fameuse permaculture ne s’attache pas seulement au jardinage et à l’agriculture, mais touche aussi différentes facettes de la vie quotidienne qui, toutes ensemble, font partie intégrante d’un système global durable.
S’il repose souvent sur du simple bon sens et sur la notion élémentaire de respect (respect de la nature, respect des animaux, respect des hommes), le concept de la permaculture se veut innovant dans le sens où il apprécie l’efficacité et la productivité des écosystèmes naturels via une observation rigoureuse. Une innovation qui ne manque pas d’intriguer et de séduire : aujourd’hui, on compte plusieurs centaines de milliers d’exploitants agricoles diplômés en permaculture à travers le monde.
Autre innovation : la permaculture s’attache aussi à la notion de design, ce qui l’oppose également aux techniques brutales et destructrices de l’agriculture conventionnelle industrielle. Cette notion de design repose notamment sur l’observation de systèmes naturels existants et performants afin de planifier au mieux l’intégration de l’être humain au cœur des écosystèmes où il s’implante et s’impose.
LES DEUX GRANDES MOUVANCES DE LA PERMACULTURE
Les puristes, menés entre autres par le britannique Patrick Whitefield, formateur en permaculture, estiment qu’il existe deux grandes mouvances au sein de la permaculture : la permaculture dite originelle et la permaculture du design.
La première, également connue sous le nom d’« agriculture permanente », regroupe la conception et la gestion de systèmes agricoles productifs qui possèdent différentes caractéristiques liées à la stabilité, la diversité ou la résistance des écosystèmes naturels. Cette permaculture originelle s’attache à l’intégration la plus harmonieuse possible de l’homme au sein de son environnement de manière à ce qu’il puisse en retirer de manière durable tout ce qui lui est nécessaire en matière de nourriture, d’habitat…
La seconde, aussi connue sous l’appellation de « design des systèmes naturels », s’intéresse aux diverses connexions au sein d’un écosystème et à son fonctionnement. Elle en tire toute une série de principes (dits « principes énergétiques ») applicables aux systèmes mis en place par l’homme : l’agriculture, les transports…
DESIGN, VOUS AVEZ DIT DESIGN ?
Sans l’ombre d’une hésitation, on peut affirmer que la notion de « design » reste au cœur de l’esprit de la permaculture. Encore faut-il bien s’entendre sur cette notion. En permaculture, le terme « design » s’attache à la conception, à la création et à l’aménagement d’un système dans son fond et dans sa forme.
Ce que l’on appelle généralement le « design permaculturel » est donc une méthode qui permet tout à la fois :
d’appréhender un système (ou un problème) dans sa globalité,
d’observer les interconnexions entre toutes les parties d’un système,
de veiller à réparer les défaillances éventuelles d’un système qui est en fonctionnement,
d’intégrer, en apprenant des systèmes naturels en fonctionnement, de la manière la plus harmonieuse possible l’homme à l’écosystème qu’il a détérioré (ou carrément détruit) par des pratiques urbanistiques, industrielles ou agricoles violentes et destructrices.
Les permaculteurs tendent à appliquer ce mode de pensée et de fonctionnement à tout ce qui est nécessaire à la construction d’un avenir durable.
DU JARDINAGE, OUI, MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT !
Comme on l’a vu, la permaculture prise dans sa globalité va au-delà du jardinage et de ses préoccupations essentielles. Elle s’intéresse à tout ce qui nous intéresse. Elle touche à tout ce qui nous touche. Elle se préoccupe de tout ce qui nous préoccupe… ou, en tout cas, devrait nous préoccuper : les façons de mieux se nourrir (tant sur le plan qualitatif que gustatif), la problématique des transports, la préservation des ressources… jusqu’à la manière de nous habiller. Ou la façon de nous soigner de manière efficace et plus sainement que par les médications chimiques. Mais dans le cadre de cet ouvrage, c’est sa facette la plus populaire (et incontestablement l’une des plus spectaculaires) qui sera surtout mise en avant et traitée en priorité : la conduite durable et responsable du jardin.
Exploiter son jardin en permaculture consiste à adopter des habitudes et des techniques de jardinage durables, peu énergivores, mais vraiment productives. En utilisant au mieux les ressources offertes par le milieu naturel, en minimisant les efforts physiques ainsi que les investissements financiers, l’objectif est d’arriver à créer et conserver un milieu privilégié, optimisé, au sein duquel le jardin s’« auto-entretient » tout en préservant sa précieuse fertilité.
À chaque problème, à chaque situation (la préparation des sols, la gestion des besoins en eau, la maîtrise des indésirables et celle des ravageurs, le suivi des cultures…), le permaculteur apporte une réponse écologique et naturelle. Une réponse efficace qui vise une maximisation qualitative et quantitative de la production.
En schématisant quelque peu, on peut affirmer que la plupart des techniques et des méthodes utilisées en permaculture relèvent tout simplement du bon sens le plus élémentaire. On parle de recyclage via le compostage. On évoque la non-utilisation des produits et traitements toxico-chimiques. On mentionne des économies énergétiques et une diminution des besoins en eau. On insiste sur la volonté de lutter contre toute forme de gaspillage. On souligne l’importance d’assurer une réelle diversification des mises en culture… Bref, il s’agit de valoriser et d’utiliser de la manière la plus efficace ce que l’on a sous la main. Le tout pour aboutir à un jardin ouvert, accueillant, sain et productif.
Pour y arriver, le permaculteur malin puise son inspiration auprès de celle qui reste sa véritable muse. Son meilleur exemple. Dame Nature !
Elle lui sert de maître à penser et à agir. Il tente de la comprendre. Il tient à s’en inspirer. Il veut la respecter. Il cherche à l’imiter. Il y puise aussi sa force, une force qui lui permet de multiplier les possibilités de son jardin tout en minimisant son travail et ses efforts.
Le résultat de tout cela ? Contrairement à ce qui se passe avec les jardiniers qui détruisent leur environnement, appauvrissent leur terre, exterminent les animaux qui sont souvent de précieux auxiliaires et empoisonnent leur productions (potagères notamment) à grand coups d’engrais, de pesticides et d’autres douteux traitements chimiques, le permaculteur transforme sa parcelle en un lieu productif. Un lieu durable. Et, avant tout peut-être, un lieu plein de vie.