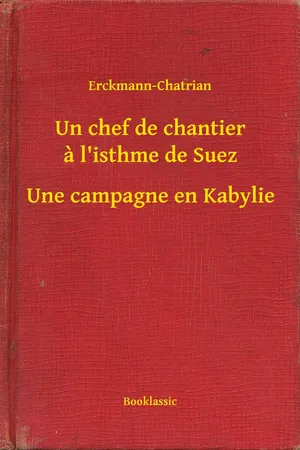Lorsque j’étais employé au canal de Suez, en 1865 et les années suivantes, me dit mon ami Goguel, j’avais l’habitude de me lever une ou deux heures avant le travail, pour respirer la fraîcheur du matin et voir si tout était en ordre dans nos environs.
Le campement du Sérapéum, – où se trouvaient nos chantiers, – situé sur l’emplacement de l’antique temple de Sérapis ruiné depuis deux mille ans, se composait alors de cinq maisonnettes recouvertes de béton, de la cantine, grande baraque en briques, d’une vingtaine d’autres baraques plus petites, pour loger les ouvriers, et du village arabe, formé d’un monceau de huttes sur le bord de l’embranchement qui nous amenait l’eau potable du canal d’eau douce, éloigné d’environ deux kilomètres.
Quant aux ruines de Sérapis, c’étaient quelques briques qu’on déterrait de loin en loin ; un vieux pot cassé, un tesson de cruche ou d’autres choses du même genre, que les amateurs admiraient comme des reliques, et qui ne valaient pas une pipe de tabac.
Presque toutes nos baraques étaient abandonnées depuis la mort du vice-roi Mohamet-Saïd, l’ami de M. de Lesseps, arrivée en 1863 ; son successeur, Ismaïl, ayant retiré les vingt mille fellahs qui travaillaient au canal maritime, pour les employer à la culture de la canne à sucre et du coton, il s’agissait de remplacer cette masse de gens par des travailleurs libres, recrutés dans toutes les parties du monde.
À force d’articles de gazette et de promesses, il en arrivait quelques-uns de l’Italie, de la Syrie, de la Grèce ; quelques barbarins, presque tous domestiques, garçons de barque ou d’écurie, venaient aussi de Kenneh et d’ailleurs, mais, sauf les anciens employés de la Compagnie universelle, bien logés et bien payés, il ne restait plus mille ouvriers dans l’isthme : c’était une véritable débâcle.
M. de Lesseps, pour monter son personnel, avait dû s’adresser aux Ponts-et-Chaussées, qui avaient commencé, grâce aux vingt mille fellahs, la première partie du canal maritime, de Port-Saïd au lac Timsah : un petit chenal, avec cinquante à soixante centimètres d’eau, permettait aux bateaux plats d’aller de Port-Saïd à Ismaïlia ; mais, pour terminer le canal, il fallait couper les seuils d’El-Guirs, de Toussoum, du Sérapéum, de Chalouf jusqu’à Suez ; creuser la tranchée dans une partie des lacs amers et lui donner dans tout son parcours la largeur et la profondeur nécessaires au passage des plus gros paquebots ; il fallait remuer plus de millions de mètres cubes de déblais qu’il n’en faudrait pour couvrir Paris et sa banlieue bien au-dessus des tours Notre-Dame.
D’après cela, Jean-Baptiste, tu comprends que mille ouvriers auraient eu de l’ouvrage jusqu’à la consommation des siècles.
C’est alors que M. de Lesseps eut l’idée de traiter, pour l’achèvement du canal maritime, avec les ingénieurs Borel et Lavalley, à tant le mètre cube, et moyennant de fortes avances sur les cent vingt millions d’indemnité dus par le vice-roi à la Compagnie universelle, en compensation des fellahs qu’elle avait perdus.
Ces messieurs avaient leur plan : c’était de remplacer les bras, qui manquaient, par des machines et par des dragues, qui n’emploieraient qu’un petit nombre d’hommes et feraient chacune le travail de trois cents fellahs.
Et l’affaire entendue de la sorte, ils se mirent à construire ces machines énormes dans tous les ateliers et toutes les fonderies de l’Europe ; cela leur prit deux ans.
En attendant, nous autres employés de l’Entreprise, nous creusions un petit canal, large comme celui de la Marne au Rhin, entre le Sérapéum et le lac Timsah, pour recevoir les dragues et les bateaux porteurs quand ils viendraient ; cette tranchée se développait sur la ligne même que devait suivre le canal maritime ; les dragues devaient l’élargir et l’approfondir ; seulement il fallait d’abord y faire arriver l’eau, chose qui nous paraissait assez difficile, attendu que le niveau de la Méditerranée d’un côté et celui de la mer Rouge de l’autre étaient à quelques mètres au-dessous du fond.
Enfin, cela regardait l’Entreprise ; nous poursuivions notre travail sans nous inquiéter du reste.
Et maintenant que tu connais ma position, j’en reviens à notre histoire au Sérapéum, en plein désert, à seize kilomètres d’Ismaïlia, à soixante-dix de Suez.
Je me levais donc la nuit, la chaleur du jour étant tellement grande qu’un œuf cuisait au soleil, et qu’il suffisait, pour se débarrasser des puces qui vous obsédaient, d’exposer sa chemise sur le sable : au bout de dix minutes elles étaient rôties.
Moi, j’étais devenu noir comme un corbeau, et tous les camarades d’Europe se trouvaient dans le même état.
Je passais simplement mon pantalon de coutil et je me mettais en route, en roulant une cigarette.
Il me semble encore y être. Voici la baraque de notre docteur arabe, Chabassi ; voici celle de mon camarade Ker-Forme, commandant l’équipe de nuit ; celle du maître charpentier Gendron, un Parisien plein de bon sens ; le four de notre boulanger Sainbois, chez lequel on allait prendre un verre d’absinthe ou de raki à l’occasion ; la jolie maisonnette de M. Réné-Caillé, chef de section de la Compagnie ; celle de M. Laugaudin, le nôtre ; la chapelle, la poste, le télégraphe, tout est là qui défile sous mes yeux à la lueur des étoiles.
J’allais au hasard, à droite, à gauche ; et le plus souvent je longeais par derrière les petites baraques des Piémontais, Dalmates, Monténégrins, où fumait encore sur l’âtre, devant les portes, un restant du feu de la veille.
En rôdant ainsi, j’arrivais près des magasins de la Compagnie ; là, parmi les hangars, dans une sorte de fenil en planches couvert de nattes en roseau, un vieux chameau tout pelé, les paupières à demi fermées, les lèvres pendantes, devant une auge en bois pleine de paille hachée et de fèves concassées, mâchait gravement sa pitance.
Il était vieux comme Mathusalem ; ses longues dents jaunes rabotaient l’une contre l’autre pour moudre ses fèves, et de temps en temps il relevait sa vieille tête de patriarche, promenant au loin un regard mélancolique sur le désert, où ses jambes s’étaient allongées pendant un demi-siècle.
Maintenant il avait sa retraite et remplissait seulement encore les petites commissions de M. Réné-Caillé.
J’éprouvais un certain plaisir à le contempler.
Au-dessus du fenil dormait le chamelier Iousef ; ses jambes sèches et nues, couleur de chocolat, sortaient de la niche ; et, dans les environs, des milliards de mouches tapissaient les madriers vermoulus ; elles étaient venues s’abriter là contre la fraîcheur et devaient repartir aux premiers rayons du soleil.
Il m’arrivait quelquefois de pousser plus loin, pour donner des ordres à nos chameliers, des bédouins du mont Sinaï, chargés de porter l’eau sur nos chantiers pendant le travail, les brouettes et les madriers d’un endroit à l’autre le long de la tranchée, et d’aller chercher notre viande à Ismaïlia.
Leurs tentes grises, rayées de brun, se détachaient sur le sable au clair de lune, à deux portées de fusil du campement, quelques chameaux et bourricots autour, et de véritables nichées d’enfants blottis dessous, comme des poussins sous les ailes de leur mère.
Ces gens ne dormaient jamais ; leurs chiens-loups donnaient l’éveil ; une ou deux femmes à l’ouverture des tentes me découvraient de loin ; elles se dépêchaient, en rampant sur les mains, de rentrer à mon approche, et presque aussitôt le cheik Saad-Méhémèche, un beau vieillard à large barbe grise, le nez fort, les joues ridées, couvertes d’un léger duvet jusqu’aux yeux, et la grande robe blanche traînant sur les talons, paraissait, me demandant ce que je désirais.
En quatre mots je lui disais ce qu’il avait à faire avec ses gens pendant la journée, et je repartais.
Il pouvait être alors cinq heures, moment où rentrait l’équipe de nuit, sous la conduite de mes camarades Ker-Forme et Bonifay.
En longeant l’embranchement du canal d’eau douce, et passant devant une baraque à deux pas de la cantine je toquais aux vitres d’une petite fenêtre, en criant :
– Hé ! Georgette, il est temps de se lever… La mère Aubry s’impatiente !
Et une voix gaie, une voix de jeune fille, me répondait :
– C’est bon… c’est bon !… Merci, Goguel… Je me lève tout de suite.
C’était une pauvre enfant qui demeurait là, Georgette Lafosse, la fille d’un peintre français venu dans l’isthme dès les premiers temps, et mort l’année précédente à l’invasion du choléra.
Il était en train de badigeonner l’intérieur d’une baraque, lorsque la mort l’avait surpris, et le lendemain seulement, au milieu de cette consternation générale, un garde du campement, voyant Georgette courir désolée, demandant son père, avait découvert le pauvre homme étendu sur les planches, auprès de ses brosses et de son pot de couleur. Des milliers de papillons blancs l’entouraient, disait le garde ; il avait fallu l’enterrer tout de suite.
Georgette, âgée de treize à quatorze ans, restait seule au monde, loin du pays, sans personne pour la réclamer ; et tout le campement, tous les amis du père l’avaient adoptée. Elle nous tutoyait tous, et nous la tutoyions. Ce pauvre petit être, vif et gracieux comme un cabri, avec de grands yeux noirs, un fond de caractère un peu fantasque, chantant et pleurant tour à tour, nous intéressait tous et nous apitoyait.
Du reste, Georgette ne demandait rien à personne ; elle aidait la mère Aubry à laver sa vaisselle, à servir les clients, et se nourrissait à la cantine.
On plaisantait avec elle, mais on se souvenait de son père, un brave ouvrier, un bon Français, et ce souvenir sauvegardait l’enfant contre toute mauvaise action.
C’est moi qui l’éveillais tous les matins, car elle était grande dormeuse ; et puis je poursuivais mon chemin, en songeant à mes affaires.
Le père Surot, surveillant de la Compagnie, un ancien soldat, ponctuel, matinal, avait déjà balayé sa chambre et pris son café ; il allait maintenant éveiller le conducteur de son bourricot et faire un tour sur les chantiers. À huit heures il était de retour et rendait compte à son chef, M. Réné-Caillé, de tout ce qu’il avait vu et du nombre des travailleurs.
Mais il ne s’agissait pas de cela : les camarades rentrés, il fallait partir.
Abou-Gamouse (le Père des Buffles), un grand nègre efflanqué, déhanché, soi-disant gardien du jardin public, où ne poussait pas un radis, – parce qu’il ne l’arrosait jamais, – Abou-Gamouse se mettait à sonner la cloche du campement à tour de bras ; il aurait réveillé des morts ; les ouvriers sortaient effarés de leurs baraques, et passaient les manches de leurs vareuses en se dirigeant vers les chantiers. Moi, je coupais au court, près des ateliers de l’Entreprise, et j’arrivais en dix minutes à la tête de notre chenal, sur la butte du Sérapéum, où notre locomobile était en pression.
Cette machine, la première arrivée, le 21 décembre 1865, avec son treuil et ses quarante wagons, enlevait cinq cents mètres cubes par jour. Tous les visiteurs de l’isthme venaient la voir : des Russes, des Anglais, des personnages de toute sorte, même le grand-duc Constantin ; pas un ne l’oubliait.
En ce moment, sa cheminée, à la fraîcheur du matin, détachait des auréoles qui tourbillonnaient jusqu’au ciel.
Je faisais vite mon appel, et les ouvriers des différentes attaques commençaient à charger ; ceux de la décharge attendaient au haut de la rampe ; les mulets, au fond de la tranchée, amenaient les wagons pleins au pied du plan incliné, la chaîne les accrochait ; elle se tendait, et voilà tout en train.
Quelle activité tout à coup, Jean-Baptiste ! quel mouvement !… Et, ma foi, tu riras si tu veux, quelle belle chose de voir ces wagons pleins de sable arriver à la rampe, de les voir monter à la file, basculer là-haut ; d’en voir d’autres descendre à vide, d’autres rouler au-dessous à la décharge, et d’entendre ce bruit de la machine, ces cris des charretiers !… Oui, c’était un grand et magnifique spectacle !
Au bout d’un quart d’heure, on ne pensait plus qu’à l’ouvrage : les mouches, les puces, la chaleur, le soleil rouge qui s’élevait sur la plaine aride, tout disparaissait. On était dans le feu de la bataille, et celle-là valait bien les autres de Crimée ou d’ailleurs : – il devait au moins en rester quelque chose…
Mais la chaleur augmentait toujours ; vers dix heures, elle devenait accablante ; deux chameaux, toujours occupés à chercher de l’eau douce à l’embranchement du canal pour abreuver les ouvriers, ne faisaient qu’aller et venir ; d’autres montaient de l’eau pour alimenter la machine ; d’autres apportaient de la houille.
Les Autrichiens et les Piémontais, mêlés de quelques Arabes syriens, chargeaient les wagons, les Européens en manches de chemise, les Arabes tout nus.
C’est là qu’il fallait voir, par cette chaleur écrasante, l’âpreté des hommes au gain ; ils ne travaillaient pas à la corvée pour le vice-roi, les nôtres, ils travaillaient pour eux, c’était facile à reconnaître ; les mulets y résistaient à peine, ils se tenaient immobiles en attendant le chargement, la tête entre les jambes, comme affaissés ; les hommes allaient toujours… Ils en ont sué des chemises !
Et les poseurs de la voie, qui travaillaient de onze heures à une heure, pendant le repas des autres, ont-ils souffert !…
Moi, presque toujours à l’ombre de la petite cassine qui me servait de bureau, je succombais presque ; dans ces moments, l’intérieur de la tranchée, où le soleil tombait d’aplomb, ressemblait à une fournaise.
Représente-toi cela toute l’après-midi, sans interruption ; il fallait sortir souvent, vérifier les chargements et s’assurer s’ils étaient complets ; il fallait en tenir note, se fâcher, s’indigner quand tout ne marchait pas rondement.
C’était une existence impossible ; eh bien, Jean-Baptiste, je ne puis m’en souvenir sans attendrissement.
De ma porte toujours ouverte, je découvrais l’immensité du désert : du côté d’Ismaïlia, le campement de Toussoum ; du côté de la Syrie, vingt lieues de sables entassés comme les flots de la mer ; vers l’Arabie, quand le temps était bien net, les cimes lointaines des contreforts du Sinaï ; et, à la chute du jour, les montagnes de l’Attaka, qui bordent la mer Rouge.
Tout est là comme peint devant mes yeux ; mais dans tout cela, pas un arbre, pas un brin d’herbe, ce qui répandait une grande tristesse sur cette vue imposante.
Du côté de la Syrie, je voyais quelquefois défiler au loin une caravane ; on aurait dit une ligne de fourmis sur la terre poudreuse ; d’autres fois un cavalier arabe galopait là-bas comme la foudre, et je me demandais :
« D’où vient-il ? – Où va-t-il ? – Est-ce à la chasse de la gazelle ?… – Est-ce à la poursuite de quelqu’un ? »
Bientôt il avait disparu, et le grincement de la machine m’avertissait de songer à mes affaires.
Souvent, à l’approche du soir, nous voyions arriver à cheval notre sous-chef de section, M. Saleron ; c’était un de mes bons amis.
Il venait de passer l’inspection des autres chantiers, qui se faisaient encore à la brouette, et s’arrêtait près de n...