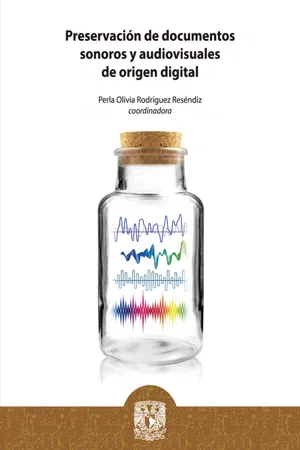
Preservación de documentos sonoros y audiovisuales de origen digital
- 200 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
Preservación de documentos sonoros y audiovisuales de origen digital
Descripción del libro
La preservación digital de materiales sonoros y audiovisuales es uno de los ámbitos más complejos y desafiantes que tienen ante sí los museos, las galerías, las bibliotecas y los archivos que los resguardan. Implica diversos enfoques como reconocer que el documento es un objeto digital cuya naturaleza es diferente a la de los materiales analógicos; el diseño y la puesta en marcha de planes y políticas de largo plazo; la perspectiva sustentable en las tareas de preservación; la aparición de nuevos procesos y roles profesionales; el uso de técnicas y tecnologías en el ciclo de vida digital; el reconocimiento de los derechos de autor, entre otros. Es desafiante porque la preservación digital es, hasta ahora, la única forma de conservar los documentos para el futuro; no existe una tecnología única y debe ser una tarea permanente. Esta condición contribuye a que el riesgo de pérdida de los contenidos sea alto. El lector interesado en el resguardo en este tipo de materiales, encontrará distintas perspectivas de autores nacionales e internacionales.
Preguntas frecuentes
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Información
Conserver et valoriser le patrimoine sonore
enregistré L’expérience de la phonothèque
de la Maison méditerranéenne des
sciences de l’homme (MMSH)
à Aix-en-Provence, France
Qu’est-ce que la phonothèque de la Maison
méditerranéenne des sciences de l’homme d’Aix-en-Provence?
Un dispositif archivistique complet,
de la collecte à la numérisation:
Índice
- Panorama de la preservación de colecciones sonoras y audiovisuales de origen digital
- Escuchar a los rarámuris hoy Oralidad y narrativas espaciales (Ecouter-Voir les Rarámuris
- Cantos rituales coras. Materiales históricos de Konrad Theodor Preuss
- Mito y grabación sonora: dos concepciones del tiempo, el espacio y la sustancia como memoria
- Conserver et valoriser le patrimoine sonore enregistré L’expérience de la phonothèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH) à Aix-en-Provence, France
- Investigar en la era digital con archivos analógicos
- Experiencias de preservación del patrimonio sonoro purépecha XEPUR, Red de Radios Indígenas y Universidad Intercultural Indígena de Michoacán1
- Posibles montajes interpretativos de la documentación en campo. El quehacer del Laboratorio Nacional de Materiales Orales
- Preservación digital El caso del Portal de Datos Abiertos UNAM, Colecciones Universitarias