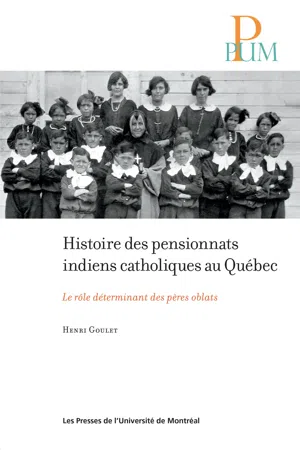![]()
CHAPITRE 1
L'ouverture tardive des pensionnats
indiens au Québec
Au Canada, tout au long des 19e et 20e siècles, le gouvernement fédéral a ouvert plus de 120 pensionnats indiens. En 1948, au Canada, il en existait encore une centaine, dont deux seulement au Québec, situés dans le Grand Nord sur la côte est de la baie James à Fort George, aujourd’hui Chisasibi. Comment expliquer une telle disparité?
Avant la signature de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) en 1975, il n’y a pas eu, aux 19e et 20e siècles, de signature de traités avec les communautés autochtones du Québec, comme cela fut le cas en Ontario et, par la suite, dans les provinces de l’Ouest du Canada (voir la carte 1.1). Cette particularité mérite explication.
Les réserves au Québec sont récentes. En comparaison avec la situation en Ontario et dans les provinces de l’Ouest du Canada, les Autochtones du Québec connaissent une histoire passablement différente. Au moment de la Conquête britannique en 1759, il existe en effet quatre bandes indiennes reconnues dont les territoires ont été accordés sous le Régime français. Il s’agit des Hurons de la Jeune-Lorette (Wendake), des Mohawks de Kahnawake et des Abénakis de Odanak et de Wôlinak, ainsi que des Iroquois, Nippissingues et Algonquins du lac des Deux-Montagnes (Oka). Ce sont les «Autochtones domiciliés». À l’époque, ces groupes se sont réfugiés auprès des établissements français pour pratiquer librement leur nouvelle religion – la religion catholique – ou pour éviter d’être complètement décimés par leurs ennemis indiens ou par les colons américains. Leur histoire est donc particulière et elle possède des caractéristiques très différentes des autres communautés autochtones.
Une première vague
de «réserves» au Québec en 1853
C’est à compter du milieu du 19e siècle qu’on assiste à une «première vague», toujours très limitée géographiquement, de création de nouvelles réserves indiennes au Québec après l’invasion de leurs territoires par colons et compagnies. L’invasion des colons s’explique, entre autres, par la volonté du clergé catholique de retenir ses «fidèles» canadiens-français et de les empêcher de quitter le Québec pour les villes de la Nouvelle-Angleterre en leur octroyant de nouvelles terres agricoles. L’Église réclame donc du gouvernement la mise de côté de «terres de colonies», terres occupées en grande partie par les Autochtones. Ensuite, ce sont les compagnies forestières qui cherchent à se développer sur leurs territoires de chasse et de pêche pour accéder à la ressource forestière: le bois équarri à compter des années 1810, le bois scié après 1850 et, finalement, le bois de pulpe à la fin du 19e siècle. C’est l’époque du développement du Moyen-Nord au Québec. À cet effet, en 1851, après l’obtention du gouvernement responsable en 1848, le gouvernement du Canada-Uni adopte une loi qui s’applique uniquement au Bas-Canada et qui réserve 230 000 acres pour la création de réserves indiennes sur son territoire. Les premières réserves apparaissent en 1853 et le commissaire des Terres de la Couronne, Denis Benjamin Papineau, propose d’établir les Autochtones sur des terres agricoles sous la supervision des missionnaires. Ce sont les oblats qui prendront en charge cette responsabilité, surtout au Témiscamingue, dans la Haute-Gatineau et sur la Côte-Nord.
Cette politique différenciée entre le Haut et le Bas-Canada est importante. Dans la formule des «traités» utilisée au Haut-Canada et ailleurs au Canada anglais, l’éducation des enfants indiens fait partie intégrante des ententes. Le cas du Traité numéro 9, celui de la baie James, est éclairant à ce sujet. Signé en 1905 et 1906, il concerne surtout des communautés cries et ojibways installées autour de la baie James et à la frontière du Québec et de l’Ontario, mais ne s’applique qu’à celles de l’Ontario. Le texte du traité explique les raisons, selon les auteurs, de ce traitement différent entre l’Ontario et le Québec.
La politique du gouvernement d’Ontario diffère considérablement de celle du Québec à ce sujet.
En Ontario, autrefois le Haut-Canada, nous avons toujours mis en pratique les principes suivis par le gouvernement britannique, depuis l’origine de la colonie, lesquels principes consistent à reconnaître aux indiens un droit de possession sur leurs pays de chasse, de même que le droit d’être dédommagés pour les cessions de terrains qu’ils seraient disposés de faire. C’est pour cela que, en outre de la rente annuelle qui leur est accordée à perpétuité, le gouvernement a toujours pris soin de leur consacrer exclusivement certaines étendues de terrains suffisantes pour parer indéfiniment à leurs besoins.
Par contre, le Québec, autrefois le Bas-Canada, a suivi la politique française, laquelle ne reconnaît aucun droit aux indiens et considère que les terres de la province appartiennent à la couronne par droit de découverte et de conquête. Il n’y a donc jamais eu de traité conclu au sujet des terres entre les indiens et le gouvernement de cette province. […]
Sa Majesté convient de plus de payer, à partir de l’an prochain, aux lieux et dates annoncés, une rente annuelle de 4 dollars à chacun des indiens. À moins d’une raison tout à fait exceptionnelle, c’est le chef de la famille qui percevra toutes les rentes.
De plus, Sa Majesté s’engage, après la signature du contrat, à remettre à chaque chef de bande un drapeau et une copie du traité.
Sa Majesté s’engage aussi à payer le traitement des instituteurs des enfants indiens, à construire les écoles nécessaires et à fournir le mobilier.
Comme on peut le constater, la formule des traités comprend automatiquement une clause de paiement pour le salaire des instituteurs et des fonds pour la construction des écoles. Ce financement, dans le cas d’Albany du moins, est de 2000$ par année pour l’école-hôpital du lieu. Il est donc beaucoup plus facile d’ouvrir des écoles sous les traités dans le Canada anglais qu’au Québec, où la formule de compensation – les réserves – n’implique aucun engagement financier du gouvernement en matière d’éducation. D’où une première explication du fait que l’éducation des enfants indiens ne représente pas une priorité au Québec puisqu’aucun financement n’est prévu à cette fin. Ce manque de volonté va durer près d’un siècle, jusqu’en 1943.
Les réserves créées par cette première mise de côté de terres selon le principe de compensation propre au Québec sont principalement situées en Mauricie, en Outaouais et sur la Côte-Nord:
- Wemotaci (1853)
- Kitigan Zibi (1853)
- Témiscaming (1853)
- Listuguj (1853)
- Betsiamites (1853)
- Mashteuiatsh (1856)
- Akwesasne (1888)
- Essipit (1892)
- Uashat (1906)
- Manawan (1906)
La Loi des terres et forêts du Québec en 1941
Il faudra attendre les amendements à la Loi des terres et forêts de 1922 (Loi concernant les terres réservées aux Sauvages, S.Q. 1922, chapitre 3) et de 1941 pour que s’amorce une deuxième vague de création de réserves autochtones au Québec. Tout comme en 1853, cette loi du Québec transfère des territoires – 330 000 acres – au gouvernement fédéral pour qu’ils soient gérés par les fonctionnaires des Affaires indiennes. Dès l’adoption de la loi de 1941, 27 nouvelles réserves autochtones sont créées, surtout durant les années 1950 et 1960 pour les Innus et les Algonquins et, durant les années 1970, pour les Cris de la baie James. La liste suivante indique les réserves créées pour chacune des communautés:
- Atikamekw: Obedjiwan/Opitciwan (1950)
- Innus: Maliotenam (1949); Natashquan (1952); La Romaine (1955); Mingan (1963); Matimekosh (1968); Pakuashipi/Saint-Augustin (1971)
- Micmacs: Gespapegiag (1957); Gespeg /occupation de territoire (2008)
- Algonquins: Pikogan (1956); Winneway (1959); Lac-Rapide (1962); Lac-Simon (1962); Kipawa (1974); Kitcisakik / occupation de territoire (1985); Wolf Lake/occupation de territoire (1985)
- Mohawks: Kanesatake/reconnaissance fédérale sans statut de réserve (1999)
- Naskapis: Kawawachikamach (1960)
- Cris: Eastmain (1962); Waswanipi (1962); Mistissini (1970); Nemiscau (1979); Waskaganish (1979); Wemindji (1979); Whapmagoostui (1979); Chisasibi (1979); Oujé-Bougoumou (1989)
- Malécites: Whitworth/confirmation à titre de réserve (1996)
En 1920, une version corrigée de la Loi sur les Indiens impose officiellement au gouvernement fédéral la responsabilité de l’éducation des enfants indiens. Curieusement, cette obligation est en grande partie ignorée pour les communautés autochtones du Québec. Toutefois, la création des nouvelles réserves au Québec ramène à l’avant-plan l’épineuse question de cette éducation. Il semble que c’est à compter des années 1940, avec la création des nouvelles réserves, que la scolarisation des enfants autochtones devient une véritable priorité au Québec. Mentionnons également que ce n’est qu’en 1943 que la loi de l’obligation scolaire pour tous les enfants de 6 à 14 ans est adoptée au Québec, sous le gouvernement libéral d’Adélard Godbout. Rappelons que cette obligation existe déjà dans la plupart des autres provinces canadiennes depuis la fin du 19e siècle. En Ontario, l’obligation scolaire est adoptée en 1891. En 1919, toutes les provinces canadiennes, sauf le Québec, possèdent une loi sur l’obligation scolaire.
En résumé, on peut donc avancer l’hypothèse que ce sont ces deux réalités combinées – la création des nouvelles réserves à compter de 1941 et la loi scolaire de 1943 – qui vont susciter la volonté, à la fois du côté du gouvernement fédéral, mais surtout du côté de l’Église catholique, d’assurer l’éducation des enfants des communautés autochtones du Québec.
La formule à trouver n’est pas évidente puisqu’il s’agira de desservir les communautés du Québec qui, pour la grande majorité, pratiquent encore leur mode de vie traditionnel. En fait, il s’agit principalement d’une forme de regroupement de familles qui ne passent que les mois d’été ensemble et qui se séparent pendant les mois d’hiver pour se déployer sur leur territoire de chasse. Les parents vont se rendre compte que la formule des écoles saisonnières – lorsqu’elles existent –, qui ne fonctionnent généralement que deux mois durant l’été, ne répond pas du tout aux exigences de la vie moderne. Plusieurs reconnaissent d’emblée que...