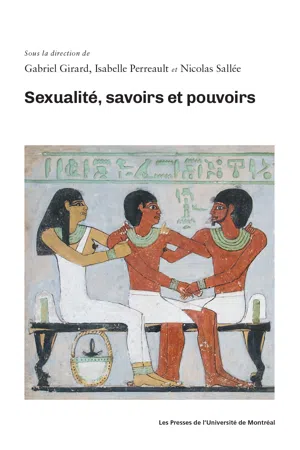![]()
Deuxième partie
Aux marges
de la normativité sexuelle
![]()
Chapitre 6
Une Sex War qui n’a pas eu lieu:
la sexologie à Montréal
Isabelle Perreault
«La sexologie n’échappe pas à cette tentation [de contrôle]. Elle a toujours soutenu qu’en révélant le sexe, en le “mettant sur la place publique”, elle le rendait plus libre. Mais de quel sexe parle-t-on? Quel est ce sexe que la sexologie prétend libérer?»
À l’hiver 2017, le colloque «Feminist Sex Wars» à l’Université Carleton réunit deux avocates canadiennes, Karen Busby et Brenda Cossman, qui présentent leur travail sur l’affaire Butler (1992). Alors que Busby représente le Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes (LEAF) et une position anti-sexe et anti-porno, Cossman revendique haut et fort le droit à publier, à diffuser et à regarder des images à caractère explicitement sexuel entre adultes consentants. En fait, cette journée revient sur le pendant canadien de la Sex War américaine qui éclate dans la foulée de la conférence Barnard à New York en 1982. De fait, de nombreux débats houleux portent sur la sexualité et plus particulièrement sur la sexualité des femmes depuis les années 1970 au sein du mouvement féministe (Rubin, 1984, 2010 et 2011; Vance, 1984). Les pratiques sexuelles qui ne collent pas à l’imaginaire érotique de la différence sexuelle semblent bel et bien poser problème. Loin d’être unique, ce cas montre une vision normative de la sexualité telle que la voient (ou la souhaitent) plusieurs féministes et chercheurs spécialistes de la sexualité. Bref, si plusieurs militants et chercheurs en appellent, au cours des années 1970 et 1980, à une émancipation sexuelle, celle-ci devrait respecter un cadre qui dépeint cette sexualité de manière relativement conventionnelle.
Pourtant, loin de porter uniquement sur la pornographie, le BDSM ou la sexualité lesbienne, la guerre du sexe s’attaque d’abord et avant tout à la place de la sexualité dans nos sociétés contemporaines. Au Québec, il faut attendre les années 1990 et même 2010 pour voir la publication, timide, d’écrits sur le lesbianisme, l’homosexualité, la pornographie et les pratiques BDSM. Cette absence, toute relative soit-elle, témoignerait à la fois d’une vision normée et normative de la sexualité, ainsi que de la reproduction d’un cadre de recherche qui maintient le concept de dimorphisme sexuel au cœur des études sur la sexualité depuis les années 1960-1970.
À la lumière des plans de cours, des écrits et des études sexologiques des universitaires canadiens-français et québécois, le sujet des pratiques sexuelles marginalisées retient peu l’attention. On pourrait arguer, non sans raison, d’une tradition intellectuelle différente chez les francophones et les anglophones nord-américains. Il n’en demeure pas moins que la documentation sur le sujet est limitée à l’époque et que les chercheurs spécialisés en études de la sexualité semblent avoir mis de côté un pan entier de la production scientifique sur la sexualité, dite hors-norme plus précisément. Cela, car tant dans le milieu universitaire canadien et américain anglophone que dans les institutions d’État, la représentation de la sexualité est largement discutée. Par exemple, dès les années 1970, dans des rapports soumis par la Commission de réforme du droit du Canada (1978) ou par Services Canada (rapport Fraser, 1985), les auteurs se demandent si la sodomie ou la pornographie sont préjudiciables pour la société. Dans le milieu universitaire franco-canadien, les études critiques de la sexualité apparaissent dans des disciplines telles que la sociologie ou la criminologie. Nous verrons pourquoi le département de sexologie a choisi de prendre une autre voie en recherche et ne s’est employé que plus tard à déplacer les frontières d’une normativité sexuelle souvent préjudiciable aux personnes sexuellement marginalisées.
Une sexologie anti-sexe ou pro-sexe?
Au moment où l’Université du Québec à Montréal (UQAM) ouvre ses portes en 1969, un module de sexologie est mis en place, lequel deviendra en 1974 un département autonome au sein de la Faculté des sciences humaines. Dès le départ, ce module a deux missions: éduquer la population à la sexualité et former, pour ce faire, des intervenants en éducation sexuelle et en clinique. Les portes des écoles secondaires se ferment rapidement aux diplômés en sexologie (1974) et, devant les pressions administratives et estudiantines de l’époque, la frange clinique se met en place de manière plus importante pour pallier les limitations des options professionnelles des nouveaux diplômés. En effet, que faire d’un diplôme de sexologie? Il faut dire que ce programme universitaire se distingue des autres programmes d’intervention sexologique dans les pays occidentaux où les gens sont d’ordinaire formés en médecine ou en psychologie avec une spécialisation sur le sujet de la sexualité. Cependant, pourquoi faire de cette option clinique une nécessité? Rappelons que le programme d’études se trouve dans les humanités et côtoie la sociologie, l’histoire et les sciences politiques. La fragile survie du département de sexologie, qui continue d’être critiqué et attaqué de toute part au cours des années 1970, pourrait bien expliquer cette position de retranchement vers la clinique et cela en dépit des thèses novatrices d’auteurs gais/ lesbiens et des féministes pro-sexe qui bousculent le champ d’études de la sexualité. La sexologie se trouve alors dans une position défensive.
Des professeurs en sexologie de l’UQAM ont publié deux documents qui nous donnent quelques pistes sur l’état de la recherche depuis la naissance du module/département. Il s’agit de la recension des écrits de Gemme, Samson et Payment (1987) et de celle de Blais et Lévy (2009). Gemme et al. insistent sur la difficulté de faire une recension exhaustive des écrits sur la sexualité. Puisque les ouvrages présents dans les bibliothèques en 1969 portent sur la psychologie (psychanalyse), la biologie (reproduction) et la religion (restriction), les professeurs Robert Gemme et Claude Crépault se rendent à New York la même année pour acheter quelque cinq cents titres. S’ajoute à cette liste l’abonnement à la revue Journal of Sex Research. Selon eux, à l’exception des sexologues Masters et Johnson, du psychologue John Money et d’autres chercheurs «isolés», peu de chercheurs publient sur la sexualité dans des périodiques sérieux.
Du côté francophone, il faut attendre les années 1970 pour voir l’arrivée de revues qui publient sur d’autres sujets que la reproduction et la contraception. Il s’agit de Fertilité, contraception et sexualité (France, 1973), des Cahiers de sexologie clinique (France, 1975) et des Cahiers de sciences familiales et sexologiques (Belgique, 1979). Au Québec, il faut attendre 1979 avec le Bulletin de l’Association des sexologues du Québec et 1980 avec la Revue québécoise de sexologie. Bref, sur un total de 2262 périodiques parus en 1987, 40,3% s’intéressent à la dimension biomédicale et 59,7% aux sciences humaines et sociales. Les sujets abordés sont nombreux et, par ordre d’importance, sont traités la contraception, la délinquance, les variations de la fonction sexuelle, l’infertilité, les maladies transmissibles sexuellement et la reproduction (52,5%), alors que l’éducation et le plaisir ne représentent que 4,5% des publications. Le sida remporte la palme avec 20,5% (482 sur 2345 articles choisis). Gemme et al. s’étonnent toutefois que seulement 1,4% des 2345 articles abordent la pornographie, un sujet qui fait grand bruit à l’époque: «Ce sujet, qui préoccupe beaucoup la presse écrite et parlée, est pratiquement ignoré dans les écrits scientifiques» (p. 94).
Sur les 3510 articles publiés dans des revues spécialisées sur la sexualité de 1950 à 2008 et recensés par Blais et Lévy en 2009 se dessinent des périodes thématiques. La période antérieure à 1987 fait voir un intérêt pour la contraception, la différence sexuelle ou le dimorphisme, les désordres sexuels (Masters et Johnson) et la sexualité préconjugale (adolescente). La période de 1988 à 1998 voit éclore des recherches sur l’orientation sexuelle, l’inceste, la pornographie, les valeurs sexuelles, les adolescents, la prévention des grossesses, le VIH/sida, le port du condom et la sexualité en situation de handicap. Ces thèmes qui émergent au cours des premières décennies du département de sexologie à l’UQAM sont en adéquation avec les champs d’intérêt de recherche des professeurs engagés.
La recension des écrits effectuée lors de cette recherche montre que les «études critiques de la sexualité» n’étaient que très peu présentes dans l’institution uqamienne avant 1989. Pourtant, à une ou deux exceptions près, ces professeurs sont tous formés en sciences sociales et humaines: éducation, anthropologie, criminologie, etc. Toutefois, ils citent des médecins et des psychologues tels que Robert Stoller, Richard Green, John Money, Masters et Johnson, travaillent et cosignent des collectifs avec eux. Ils organisent des colloques internationaux ou y assistent, comme le Congrès international de sexologie qui a lieu à Montréal en 1976 (et un autre en 2005) avec toutes les vedettes de l’heure dans le domaine, dont, encore une fois, Masters et Johnson. Or, cet hermétisme aux études critiques de la sexualité anglophones est également partagé par ces mêmes chercheurs américains, un peu comme si le bagage intellectuel des sciences humaines, plus politique, s’était perdu en cours de route.
De fait, la sexologie au Québec est plus proche des travaux cliniques behavioristes effectués aux États-Unis. Il s’agit d’une sexologie plus empirique et clinique qu’analytique, psychodynamique et positiviste comme celle que l’on retrouve en Europe continentale. Si au départ, en 1969, cohabitent une sexologie institutionnelle (recherche clinique et sociale) et une sexologie populaire (éducation à la sexualité), les sexologues de l’UQAM chercheront à justifier sur des bases scientifiques leur discipline nouvellement institutionnalisée. Il semble toutefois difficile de justifier son existence par-delà les différents courants théoriques et l’interdisciplinarité qui la traversent. Cela pose problème à bien des égards et particulièrement par le fait que chacun des chercheurs évolue en vase clos selon sa formation et ses sujets de recherche: il y a ceux qui étudient la sexualité de manière plus objective avec les méthodologies existantes, mais sans remettre en question l’objet, et ceux, plus rares, qui critiquent les normes sexuelles et appuient les mouvements militants des années 1970 ou encore les écrits critiques, notamment ceux de Michel Foucault. C’est aussi le constat d’Hélène Manseau, criminologue et professeure au département de sexologie pendant près de trente ans, lorsqu’elle affirme qu’il n’y a pas suffisamment de travaux qui tiennent compte des critiques majeures d’ordre épistémologique en sexologie (1989, p. 50).
Les ouvrages et les revues anglophones techniques, ainsi que la position fragile du département au sein de la Faculté, «la maison de verre» selon l’expression du professeur de sexologie Jean-Marc Samson, expliquent le retranchement vers une position qui favorise la recherche clinique au détriment de la recherche critique. Selon Manseau, les aspects sociaux n’ont pas été, au départ, un objet privilégié d’analyse à l’exception du relativisme culturel et de la répression sexuelle (anthropologie et criminologie). Elle ajoute que «les recherches fondamentales visant à saisir la notion même de sexe ou de sexualité ne furent pratiquement pas entreprises au cours des deux premières décennies d’existence de la sexologie universitaire, et les études théoriques visant l’approfondissement de la notion de contrôle social furent tout aussi rarissimes» (1989, p. 47).
Un aveuglement volontaire
ou une position politique assumée?
À la suite d’une recension exhaustive des écrits des professeurs de sexologie, force est de constater que l’on a que très peu étudié les sujets de l’homosexualité et de la pornographie au cours des vingt premières années du département. Blais et Lévy voient d’ailleurs la période de 1988 à 1998 comme celle qui connaît un intérêt accru pour l’orientation sexuelle et la pornographie. Néanmoins, il faut attendre les années 2010 pour que le département engage des spécialistes de ces champs. Si, rétrospectivement, les premiers sexologues universitaires en sont embarrassés, il n’empêche que les études sexologiques francophones en Amérique de Nord ont reproduit pendant longtemps les préjugés nombreux à l’égard d’une sexualité longtemps qualifiée de déviante, comme il est possible de le lire dans un texte sur l’homosexualité publié en 1970 par des chercheurs en sexologie. Ils concluent que les causes de ce phénomène pathologique sont principalement psychologiques et liées à de mauvaises attitudes parentales et leurs influences sur la libido infantile. Il faut attendre 1981 avec le numéro spécial de la Revue québécoise de sexologie pour lire des textes en faveur des diverses orientations sexuelles. Aussi, pour diverses raisons, jusqu’au tournant des années 2010, le cours Homosexualité et société n’était rattaché à aucun département de l’UQAM, mais simplement à la Faculté des sciences humaines. Même chose pour le colloque «La vie en rose» tenu en 1992.
Sur le sujet de la pornographie, ...