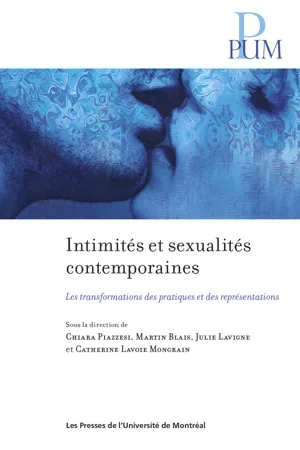![]()
PREMIÈRE PARTIE
Discours, imaginaires,
technologies
et transformations sociales
![]()
CHAPITRE 1
Vers une sémantique amoureuse intégrée:
imaginaires amoureux occidentaux
Chiara Piazzesi, Martin Blais, Julie Lavigne et Catherine Lavoie Mongrain
L’imaginaire amoureux occidental a traversé plusieurs transformations depuis le début de sa consolidation au cours du Moyen Âge. À cette époque, grâce à la diffusion des productions culturelles de la fin’amor, un code amoureux séculier commence à se former autour de l’idée de l’exceptionnalité de l’amour, de la perfection de l’être aimé, d’une relation extraconjugale d’admiration et de distance axée sur la loyauté inconditionnelle. Au cours de son évolution, ce code a favorisé la différenciation d’un domaine d’interactions sociales et, successivement, de relations interpersonnelles fondées sur le sentiment amoureux et sur ses implications morales (Luhmann, 1982). Autrefois exclu du mariage comme une source de désordre, l’amour érotique (passion et sexualité) y est intégré progressivement à partir de la fin du xviiie siècle, pour ensuite devenir le seul fondement légitime de l’institution conjugale et, corrélativement, une raison acceptable pour la dissoudre.
L’univers des relations intimes, en émergeant, a donc intégré tour à tour des institutions (telles que le mariage, le divorce, la fréquentation préconjugale, la cohabitation, etc.), des régimes de justification des conduites (la passion amoureuse, l’engagement réciproque des partenaires, le dévouement à l’autre, la tension entre amour de l’autre et amour de soi, etc.), des formes de communication (le fait de se comprendre en un regard, l’amitié entre partenaires, la sexualité comme couronnement de l’union amoureuse, la communication axée sur la résolution de problèmes, la communication par l’entremise des nouvelles technologies, etc.), des pratiques rituelles (les manifestations publiques d’amour, les petits noms que les partenaires se donnent, les soirées en amoureux, la célébration des anniversaires et les cadeaux, les textos pour se dire qu’on pense l’un à l’autre, etc.). En d’autres termes, cet univers a évolué avec la société, à la fois par rapport aux façons d’être ensemble des gens qui s’aiment et dans la manière dont les gens pensent l’amour, l’anticipent, se représentent en amour, en parlent, le chantent, l’écrivent ou le lisent, etc.
La recherche analyse ces transformations récentes des façons de penser l’amour et de le représenter dans des productions culturelles en fonction de leurs liens aux transformations des pratiques et de la société (à ce sujet, voir le chapitre de Morikawa, ainsi que ceux de Reinhardt-Becker et de Prandini pour une étude des productions culturelles).
La sémantique amoureuse contemporaine
La recherche sociologique occidentale sur l’amour et les relations d’intimité s’est développée de manière importante au moins depuis les années 1990 en tentant de comprendre les transformations qui les ont affectés. On peut organiser les nombreux débats engendrés par cette démarche en trois positions principales. La première regroupe des théories et des approches qui insistent sur le processus moderne d’émancipation des imaginaires et des conduites traditionnelles. L’individualisation croissante dans les sociétés occidentales aurait accéléré l’effritement des références normatives traditionnelles et favorisé l’ouverture d’espaces de négociation des normes de l’intimité de la part des individus. Elle aurait précipité le délaissement de l’imaginaire traditionnel, fortement imprégné de l’idéal romantique et des relations d’inégalité qu’il favorise (nous y reviendrons), au profit d’un imaginaire modernisé plus égalitaire et démocratique, ainsi que de formes d’intimité correspondantes (telles que la «relation pure», théorisée par Giddens [1992]). Dès lors, les termes des relations intimes ne seraient plus dictés par un idéal normatif universel, par les institutions religieuses ou par la communauté: ce seraient au contraire les partenaires qui les négocieraient, sur un plan d’égalité et dans le cadre d’une communication transparente et orientée vers la résolution de problèmes.
La deuxième position regroupe des conceptualisations qui envisagent l’affaiblissement des repères traditionnels dans l’intimité comme la source d’une dissolution croissante des liens intimes stables. Le détachement de la tradition serait une conséquence du capitalisme avancé, de la rationalisation qui le caractérise et de ses valeurs particulières qui pénétreraient la sphère intime. Cette perspective conçoit les individus comme mus par le désir d’autonomie et d’individualisation, ainsi que par une mentalité consumériste qui se diffuserait de plus en plus, exacerbée par les nouvelles technologies. Si la première position voit la modernisation comme une occasion d’émancipation et de création, la deuxième l’interprète plutôt comme une source de déliaison, de fragilisation des liens amoureux et de colonisation de l’intimité par les logiques de l’économie capitaliste.
La troisième position, où se retrouvent généralement des études ayant une forte composante empirique, caractérise l’imaginaire amoureux occidental contemporain et les pratiques des personnes dans des relations intimes comme relevant à la fois de repères traditionnels encore très forts et de repères qui sont en décalage par rapport à la tradition. Cette coexistence entre le respect et le rejet de la tradition se traduirait par des tensions entre normes et idéaux prônant des visions du monde souvent irréconciliables (l’intimité en tant que fusion par opposition à l’intimité comme autonomie, la monogamie par opposition à la plasticité des engagements mutuels, etc.). Les relations intimes s’organiseraient donc en fonction d’orientations normatives contradictoires, par exemple par rapport à la division du travail au sein des couples hétérosexuels ou à l’exclusivité sexuelle comme preuve d’engagement. Ces tensions se retrouveraient également dans le discours des personnes, qui peuvent justifier leurs choix en puisant tantôt dans des arguments traditionnels – par exemple les rôles genrés, l’idée du sacrifice de soi –, tantôt dans des arguments démocratiques, égalitaires et axés sur l’autonomie des partenaires (Carter et Duncan, 2018). Ces tensions émergeraient aussi dans les représentations que donnent les productions culturelles de l’intimité amoureuse (voir Reinhardt-Becker dans ce volume, chap. 6).
Ces trois approches sont limitées quant à leur capacité à décrire et à caractériser l’évolution de la sémantique amoureuse occidentale contemporaine. Les deux premières ne parviennent pas à rendre compte de la complexité empirique des relations intimes contemporaines, dont témoignent pourtant les travaux regroupés sous la troisième. Cette dernière, cependant, se limite pour la plupart à la description de la coexistence de sémantiques amoureuses opposées et des tensions qui les relient. Il manque une théorisation de cette coexistence qui permette de décrire les combinaisons entre repères traditionnels et repères antitraditionnels, qui reste proche des données empiriques disponibles et qui soit en mesure de générer des hypothèses sur la relation entre les transformations sémantiques dans la sphère de l’intimité et les transformations des sociétés occidentales contemporaines (voir la proposition de Prandini dans ce volume, chap. 8).
Nous proposons donc une quatrième approche, qui caractérise la sémantique amoureuse occidentale contemporaine comme une sémantique intégrée. Il est nécessaire d’avoir tout d’abord un aperçu des caractéristiques des deux sémantiques que la littérature considère comme entrant en compétition, soit celle de l’amour romantique et celle du partenariat, avant de pouvoir définir la sémantique intégrée et la situer par rapport aux trois dimensions principales de l’intimité amoureuse contemporaine, c’est-à-dire les sentiments amoureux, la conjugalité et la sexualité. Le rôle de la sémantique amoureuse consiste justement à instruire les personnes sur les façons de comprendre et de cadrer ces dimensions des relations intimes, ainsi que leurs interconnexions.
La modélisation des sémantiques romantique
et partenariale
On rapporte généralement les discours et les pratiques intimes dans les sociétés occidentales contemporaines à deux sémantiques principales, considérées comme distinctes et dans un rapport mutuel de cohabitation ou de compétition (aussi bien dans les représentations culturelles que dans les pratiques): la sémantique de l’amour romantique et celle du partenariat. La sémantique de l’amour romantique s’élabore entre la fin du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe, mais son influence presque hégémonique s’étend jusqu’au XXe siècle. Cette sémantique considère l’amour comme un choix qui s’appuie cependant sur le destin (les amoureux ne se cherchent pas, ils se trouvent), comme une passion incontrôlable à laquelle on ne peut pas résister, ainsi que comme la seule raison légitime du choix mutuel des amoureux. La relation d’amour est fondée sur la passion, sur l’empathie, sur la validation réciproque de l’individualité des amoureux, sur une dynamique hautement fusionnelle. L’imaginaire romantique réalise, pour la première fois dans l’histoire occidentale de l’amour, la combinaison entre amour, sexualité et conjugalité/mariage (Luhmann, 1982): l’intimité érotique est le couronnement de l’amour, que consacre le mariage éternel tant entre deux corps qu’entre deux esprits. En retour, la relation conjugale est le seul cadre légitime pour l’expression de la sexualité. On perçoit l’amour comme la chose la plus importante de la vie humaine, qui donne accès au plus grand bonheur, et aucune autre relation ou ambition ne peut prendre autant d’importance dans la vie des partenaires.
La sémantique du partenariat, héritière du «sachliche Liebe» ou «amour objectif» des premières décennies du XXe siècle (pour un approfondissement, voir Reinhardt-Becker dans ce volume, chap. 6), se développe plus spécifiquement à partir des années 1970. On la considère comme une réponse point par point aux problèmes empiriques, idéologiques et politiques engendrés par l’amour romantique (Leupold, 1983). Elle renonce à l’idée de l’amour fou, trop instable et impliquant un risque inacceptable de perte de soi, et plaide pour un amour raisonnable, plus objectif, factuel, conditionnel au bonheur, au bien-être et à la satisfaction des partenaires. L’amour partenarial rejette la fusion romantique au profit d’une autonomie relative des deux partenaires dans la relation. Il tolère, voire encourage d’autres intérêts et relations significatives en parallèle à l’amour entre les principaux partenaires, jusqu’à remettre en question l’insistance romantique et traditionnelle sur la monogamie et l’exclusivité sexuelle et sentimentale. En gagnant en autonomie vis-à-vis de ses finalités reproductives traditionnelles, la sexualité devient liée à l’épanouissement et aux besoins individuels, orientée vers le plaisir et l’expression de soi. De plus, là où la sémantique romantique promeut entre les partenaires une forme d’égalité dans la différence qui maintient des arrangements genrés traditionnels, le partenariat prescrit une relation égalitaire relativement indifférente au genre dans la distribution des droits, des tâches et des devoirs.
La sémantique amoureuse intégrée
En ce qui concerne l’amour et les relations intimes, nous proposons que le répertoire sémantique actuellement en circulation dans les sociétés occidentales intègre les repères provenant de la tradition romantique et ceux provenant de la sémantique partenariale qui, dès le XXe siècle, s’oppose à l’amour romantique et aux impasses qu’il engendre du point de vue du fonctionnement des relations intimes. Une telle intégration signifie, en premier lieu, que des repères apparemment contradictoires soutiennent de manière concomitante la production de sens dans les relations intimes; en deuxième lieu, que ces repères peuvent paraître contradictoires du point de vue savant, mais pas nécessairement du point de vue des personnes qui les mobilisent pour décrire leur vie amoureuse; en troisième lieu, que la combinaison – quoique riche en tensions – de ces repères hétérogènes peut répondre à des problèmes spécifiques que ces mêmes repères, utilisés de façon indépendante et séparée, ne sont pas en mesure de résoudre. Par conséquent, nous postulons que les règles de production de sens dans cette sémantique intégrée profitent de la réflexivité sociale développée à l’égard des problèmes empiriques engendrés tant par la sémantique romantique, associée à une normativité traditionnelle, que par la sémantique partenariale, associée à la modernisation de l’intimité. En ce sens, comme c’était le cas pour les configurations sémantiques de l’intimité qui l’ont précédée, la sémantique intégrée répond, avec les spécificités qui correspondent aux transformations sociales contemporaines, au besoin de gérer le triple processus qui caractérise l’émergence du couple amoureux formé d’individus interdépendants: un processus de démarcation des territoires personnels et partagés au sein du couple, un processus de différenciation de la relation intime à l’égard du monde extérieur et un processus d’intégration de la relation intime dans le réseau des autres relations, normes, cultures, prescriptions ou épreuves que rencontrent les acteurs sociaux en dehors du couple.
La sémantique intégrée et les sentiments amoureux
La sémantique intégrée caractérise les sentiments amoureux et le statut de l’amour dans la vie individuelle par une hybridation entre des thèmes très anciens et une posture de distanciation à leur égard. Premièrement, aussi bien dans les pratiques que dans les représentations, elle définit encore l’amour comme une passion incontrôlable – on «tombe» amoureux – justifiant alors les conduites irrationnelles, inhabituelles, les gestes dramatiques, les choix surprenants, etc. Cependant, la sémantique anticipe aussi le fait que, loin d’être ravivée par son institutionnalisation dans la conjugalité, cette flamme est rapidement éteinte par la routine et la familiarité qui s’installent dans le couple ou dans le mariage. Cette caractéristique de la sémantique de l’amour est cohérente avec l’idée préromantique selon laquelle le déclin de l’amour commence au moment de son accomplissement (Luhmann, 1982). Ce fatalisme ancien se combine, dans la sémantique intégrée, avec le constat postromantique de l’effondrement de l’idéal de l’amour éternel fondé sur un intérêt sexuel réciproque inépuisable et encadré dans une relation monogame à long terme. Cependant, les principales solutions envisagées pour pallier cet épuisement de la passion ne sont pas seulement celles du réalisme partenarial (communication, négociation, relâchement des contraintes monogames), mais aussi celles visant à raviver le désir et à interrompre la routine et la familiarité associée au dévoilement de soi qui caractérisent la communication de style «thérapeutique» (Giddens, 1992). Dans le discours contemporain, même en dehors de la sphère amoureuse, les émotions et les plaisirs intenses font office de preuve d’une vie réussie. Cette portion de l’imaginaire amoureux est donc aussi soutenue par le langage capitaliste de la consommation, tout comme par celui des services, des applications et des formes de littérature de conseil qui accompagnent les gens dans leurs efforts pour retrouver la passion du début.
En deuxième lieu, les études sur les représentations culturelles de l’intimité et celles sur les couples montrent que le pessimisme postromantique de la sémantique intégrée a des nuances résolument féministes: la mort de l’amour dans le couple semble être considérablement accélérée par les inégalités de genre, désormais de plus en plus intolérables, dans la division du travail tant domestique que relationnel, incluant celui nécessaire pour raviver la passion. La sémantique de l’amour romantique envisageait l’amour comme une force irrésistible entraînant le risque de la perte de soi, surtout pour les femmes. La littérature et les mouvements féministes ont largement critiqué cette vision romantique, parce qu’elle légitimait l’injonction à l’oubli de soi, au désintéressement et au sacrifice de soi qui frappe particulièrement les femmes dans les sociétés occidentales (Jackson, 1993). La solution envisagée par la sémantique partenariale, qui reprend l’idée classique d’une opposition entre amour-passion et amour conjugal, est celle d’une normalisation, d’un refroidissement de l’amour, d’une rationalisation qui puisse servir de base à des relations plus égalitaires. Comme les inégalités dans la répartition des tâches au sein des relations hétérosexuelles ne semblent pas s’estomper rapidement, la sémantique intégrée contient à la fois la légitimation et la critique de cette solution partenariale: elle soul...