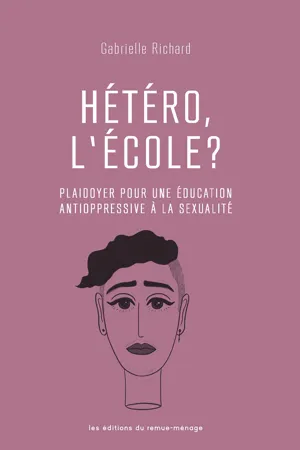![]()
Chapitre 1
Un milieu scolaire
marqué par la culture dominante
La multiplication des terminologies utilisées pour décrire les identités de genre et les préférences sexuelles ou romantiques en laisse plusieurs perplexes. Si on ne comprend pas toujours ce que désignent ces termes, c’est que les possibilités sociales et culturelles en termes d’identité sont souvent bien restrictives. Ce chapitre sera l’occasion de définir ces termes, mais aussi la façon dont les constructions sociales liées au genre et à la sexualité se jouent dès la petite enfance, au fil des interactions qui forgent les individus. Nous verrons comment, à l’approche de l’adolescence, les attentes de genre vont de pair avec la nécessité pour chacun·e de faire la démonstration de son hétérosexualité. Et l’école, où évoluent et se côtoient l’ensemble des jeunes, est l’un des principaux lieux de transmission de ces pressions normatives, qui s’exercent autant par les pairs, par le personnel scolaire, par la culture institutionnelle que par les modèles mêmes d’éducation à la sexualité. Après tout, ni la jeunesse ni le monde éducatif ne sont à l’abri des influences sociales… mais celles-ci sont-elles pour autant coulées dans le béton?
De quoi parle-t-on quand il est question de sexe,
de genre et d’orientation sexuelle?
Pour réfléchir aux messages normatifs transmis par l’école, et notamment en éducation à la sexualité, il est essentiel de définir d’abord les notions de sexe, de genre et d’orientation sexuelle, dont nous ferons largement usage ici. Si ces termes doivent être clarifiés, c’est parce qu’ils désignent des réalités qui font couramment l’objet d’amalgames. En effet, les mythes les plus répandus persistent à établir un lien de causalité entre le sexe biologique, l’identité de genre et l’attirance sexuelle d’un individu. Les mécanismes qui perpétuent ces contre-vérités sont subtils et nombreux, et contribuent à établir des hiérarchies entre les identités, quand ils ne les passent pas carrément sous silence. Trois messages normatifs retiendront particulièrement notre attention: la présentation des sexes (et des genres) sous un format binaire, la réduction du genre d’une personne à son sexe déterminé à la naissance, et l’hétérosexualité obligatoire.
Nous utiliserons le mot sexe pour désigner le sexe assigné à la naissance, et établi sur la base presque exclusive des organes génitaux externes. Les conventions sociales occidentales admettent l’existence de deux sexes, mâle et femelle. Or, l’appartenance incontestable à l’une des deux catégories ne se joue pas si clairement chez tous les individus. Environ 1,7% des bébés (Blackless et al., 2000) seraient intersexués, c’est-à-dire naîtraient dans un corps ne correspondant pas en tous points aux constructions normatives du masculin et du féminin. Les «conditions» auxquelles le monde médical réfère comme à des «variations du développement sexuel» sont nombreuses. Il peut s’agir de variations d’ordre génétique (présence de combinaisons chromosomales atypiques), anatomique (organes génitaux considérés ambigus ou de taille différente), hormonal (insensibilité des récepteurs à androgènes ou surproduction de testostérone ou d’œstrogène) ou gonadique (testicules internes ou externes, ovaires ou gonades mixtes).
Les critères pour établir si un sexe biologique est «adéquat» sont très stricts et en révèlent le caractère construit. On s’attend par exemple des garçons à ce qu’ils possèdent un pénis de taille suffisante pour la pénétration, et que leur urètre soit situé à l’extrémité de leur sexe de manière à leur permettre d’uriner debout. Le corps des filles doit présenter un clitoris de taille réduite, de même qu’un vagin permettant l’insertion d’un pénis de taille moyenne. Bref, les médecins responsables d’examiner et d’opérer les corps intersexués – car les interventions chirurgicales, bien qu’injustifiées, sont couramment imposées – s’appuient exclusivement sur des critères d’hétérosexualité pénétrative et d’identité cisgenre, présumant la nécessaire adéquation entre l’anatomie d’une personne, la manière dont elle s’identifie et la sexualité qu’elle désire. Les situations d’intersexuation montrent hors de tout doute qu’il n’y a pas de lien «naturel» entre les attributs physiques et l’identité de genre.
Le genre réfère aux distinctions sociales établies entre les individus selon les caractéristiques associées au féminin et au masculin. Les rôles de genre désignent les comportements acceptés et encouragés respectivement pour les hommes et les femmes, dans une société et à une époque donnée. L’identité de genre renvoie au genre auquel une personne s’identifie – qui peut être conforme ou non au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Quant à l’expression de genre, il s’agit des codes sociaux d’apparence ou de conduite mobilisés par une personne.
Il existe une pluralité d’identités et de configurations sexe-genre qui témoignent de la richesse et de la diversité humaine. Il y a par exemple des personnes non binaires (dont le genre n’est ni exclusivement masculin ni exclusivement féminin) et des personnes agenres (s’identifiant comme sans genre). On retrouve des femmes butch ou qui adoptent des codes sociaux (vêtements, gestuelle, comportements) associés au masculin, mais qui ne s’identifient pas moins comme femmes. Il existe des hommes «roses», que l’on désigne comme tels parce qu’ils investissent des sphères socialement considérées comme féminines (la cuisine, la domesticité, le soin, etc.). Il y a des femmes et des hommes trans qui désirent changer de sexe, et d’autres qui n’en émettent pas le souhait. De même, on peut être une personne trans non binaire, c’est-à-dire ne pas s’identifier conformément au sexe et au genre qui nous a été assigné à la naissance, sans pour autant se retrouver dans «l’autre» option disponible. Aucune de ces identités ou configurations n’est plus légitime que les autres; certaines sont simplement plus ou moins connues ou comprises du grand public.
Si la majorité des personnes qui nous entourent paraissent confirmer les normes de genre, c’est-à-dire s’identifier et s’exprimer de manière conforme au sexe qui leur a été assigné à la naissance (on dira alors qu’elles sont cisgenres), cet apparent lien de causalité ne devrait pour autant pas effacer son caractère construit. Il n’est d’ailleurs ni valorisé, ni mis en scène selon ces seules modalités dans toutes les cultures. Normal ou répandu n’équivaut pas à naturel.
L’orientation sexuelle, enfin, réfère aux attirances sexuelles et/ou romantiques ressenties par une personne. Elle est généralement conçue de manière binaire (présumant l’existence de personnes de deux sexes/genres), soit comme hétérosexuelle (dirigée envers des personnes du sexe communément dit «opposé»), homosexuelle (envers des personnes «du même sexe») ou bisexuelle (envers les «deux» sexes). Ceci dit, si l’on se permet un pas de recul face à ces catégories étanches et mutuellement exclusives, d’autres possibilités se donnent à voir. Des personnes peuvent ainsi se considérer queer (refusant les classifications de sexe, de genre et d’orientation sexuelle), pansexuelles (attirées par d’autres personnes, quelle que soit leur configuration sexe-genre) ou asexuelles (ne ressentant pas d’attirance sexuelle). Cette mise à distance permet aussi de considérer que des personnes puissent être en questionnement sur le plan de leur orientation, distinguer leurs attirances sexuelles de leurs attirances romantiques (s’identifier comme pansexuelle aromantique, par exemple), ou encore changer de préférences sexuelles ou amoureuses au fil de leur parcours et de leurs rencontres.
Si l’on commence seulement à prendre connaissance des identités LGBTQI et autres, ce n’est pas parce qu’elles n’existaient pas auparavant, mais bien parce qu’à force de répression et de contrôle social, ces communautés ont été reléguées dans l’ombre. Les autorités médicales, policières et juridiques ont, tantôt successivement, tantôt simultanément, criminalisé et marginalisé les personnes issues de la diversité sexuelle. Ces identités ne sont ni des «inventions modernes» – hormis, à certains égards, sur le plan terminologique – ni des anomalies de la nature. C’est plutôt un certain discours biopolitique qui a cherché à naturaliser l’hétérosexualité en la posant comme seule orientation sexuelle garante de la procréation, donc de la reproduction de l’espèce. Comme l’existence d’autres identités remet en question la présumée complémentarité des sexes et des genres et la nécessaire hétérosexualité, elle met en péril les assises mêmes de nos sociétés. Pourtant, si l’on y regarde de plus près, le caractère construit de ces assises se donne à voir dès la petite enfance.
Une petite enfance sous le poids du genre
Le scénario est familier pour qui a déjà attendu un enfant. «Sais-tu si c’est une fille ou un garçon?» Les spéculations vont bon train; plusieurs vont même jusqu’à faire des paris. «Si vous avez [cocher ce qui s’applique] des nausées, un ventre bien rond, des poignées d’amour, mal à la tête, envie de manger du salé, c’est que vous portez [cocher ce qui s’applique] un garçon, une fille.» Déjà, avant la naissance, la question du sexe de cet enfant est centrale dans les conversations des adultes. Les baby showers, célébrations à l’occasion desquelles les futures mères (parfois, les futurs parents) reçoivent cadeaux et conseils pour leur bébé à naître, sont une autre des incarnations patentes de cette mise en genre prénatale. Il n’est pas rare que ces fêtes se doublent d’un gender reveal party, c’est-à-dire de la révélation, souvent en grande pompe, du sexe du bébé.
Après la naissance, cet engouement pour le sexe (et le genre qui lui est assigné) est loin de s’estomper. L’offre de vêtements et de jouets, particulièrement (bien que pas uniquement) dans les grandes surfaces, confine trop souvent les jeunes enfants à l’une des deux catégories bien délimitées. Aux fillettes les vêtements blancs ou roses, les motifs fleuris et les dentelles, les slogans renvoyant à la beauté et à la douceur. Aux garçons les habits bleus ou gris, les dessins de monstres, les designs dynamiques et les slogans suggérant la force et le courage. Aux filles les jeux de rôles, le bricolage et les activités d’expression corporelle ou artistique; aux garçons les expériences scientifiques, la vitesse, le risque et les activités physiques. Hors de ces deux extrêmes, point de salut. Ce sont les stratégies commerciales qui parrainent cette bicatégorisation des sexes en indiquant qu’un même vélo peut difficilement convenir à un garçon et à sa petite sœur. Impossible, donc, pour les familles nombreuses, de penser transférer le vélo de l’aîné, bardé d’autocollants de superhéros, à la plus jeune: il faut en acheter un second. Ce sont ces stratégies commerciales qui restreignent les possibles pour les enfants qui voudraient explorer de «l’autre» côté du rayon jouets et qui se font constamment rappeler (par les affichettes, par leurs pairs ou par les adultes) qu’il s’agit d’un terrain qui leur est interdit. Ce sont elles qui limitent les adultes qui voudraient faire fi de ces divisions et les obligent à débourser des sommes conséquentes.
Bien sûr, les adultes ne sont pas que les victimes de cette tendance à la catégorisation genrée de la petite enfance, mais contribuent activement à sa reconduction. Dans une expérience connue sous le nom de Baby X, réalisée en 1975 et reprise depuis avec différents paramètres mais des conclusions similaires, des chercheuses états-uniennes ont documenté les impacts que pouvait avoir le genre d’un bébé sur la manière dont les adultes se comportaient avec lui. Une quarantaine de jeunes adultes ont été observé·e·s dans leurs interactions avec un bébé de trois mois, vêtu d’une salopette jaune. Dans la même pièce, trois jouets étaient disponibles: une poupée, un anneau de caoutchouc et un ballon de football. Le tiers des participant·e·s s’est fait dire que le bébé était une fille; le deuxième tiers, qu’il était un garçon. Le dernier tiers n’a reçu aucune information sur le genre de l’enfant. Les conclusions de l’étude montrent que les participant·e·s suggéraient davantage la poupée au bébé fille. L’inverse (proposer le ballon de football au bébé garçon) ne s’est pas avéré si clairement, les chercheuses estimant a posteriori que le ballon était un jouet difficile à manipuler pour un bébé de cet âge. Les adultes, femmes comme hommes, ont moins cherché à porter le bébé fille que le bébé garçon, ou que le bébé au genre non spécifié. Finalement, la majorité des participant·e·s à qui on n’avait pas indiqué le genre du bébé ont estimé pouvoir le déterminer, soit en évoquant la force de la préhension ou l’absence de cheveux attribuables à un garçon, soit en estimant que la rondeur et la douceur étaient indicatrices d’une fille.
Au terrain de jeu, à la table à dessin, à l’heure du conte, dans la vie quotidienne, les adultes (qu’il s’agisse des parents ou d’autres intervenant·e·s) agissent différemment avec les enfants en fonction de leur genre. Ils laissent plus spontanément les garçons se ruer dans les aires de jeu, mais demandent aux filles d’attendre qu’on boutonne leur manteau. Ils encouragent les garçons téméraires dans la prise de risques, mais exhortent les filles du même âge à «faire attention». Ils réconfortent abondamment les filles qui se font mal, mais disent aux garçons de «retourner jouer» rapidement. Ils trouvent mignons les petits garçons qui retirent leurs chaussettes dans le bac à sable, mais refusent aux filles de le faire, par crainte qu’elles ne prennent froid ou se salissent. Ces micro-interactions, banales en soi mais dommageables par leur caractère répétitif, «font le genre». Elles déterminent des manières adéquates ou inadéquates de se comporter sur la base du genre. Elles indiquent aux enfants que le genre est important, et qu’il est assorti de différents privilèges, en fonction des activités.
Bien entendu, mettre l’accent sur le fait d’être une fille ou un garçon va de pair avec une certaine sexualisation, voire hétérosexualisation, des enfants. Par exemple, entrer constamment en relation avec une petite fille en lui disant qu’elle est belle, qu’on aime ses tresses ou qu’elle est joliment vêtue lui suggère que c’est par son apparence qu’elle peut espérer attirer l’attention des adultes, voire des garçons, et qu’il faut choisir ses vêtements pour plaire à autrui. Répéter à un garçon courtois que c’est un charmeur et qu’il brisera des cœurs, c’est lui laisser savoir qu’il peut ainsi exercer un certain pouvoir sur les filles en leur prêtant attention – ce qu’il ne souhaite peut-être pas faire à son âge (ou jamais).
Face au terrain miné des interactions genrées en bas âge, les parents préoccupés par la question semblent se réfugier dans deux types d’approches. Dans la première, la parentalité féministe, on cherche à corriger les hiérarchies de genre établies au détriment des filles. Il s’agit par exemple de fournir des représentations féminines positives et diversifiées, de minimiser l’importance de l’apparence en complimentant les filles sur leur personnalité, leur athlétisme ou leur comportement, de valoriser l’affirmation des filles par la prise de parole, ou encore de sensibiliser les enfants au sexisme et à ses impacts. La seconde approche, la parentalité neutre sur le plan du genre (gender neutral parenting), cherche à aplanir les différences factices créées autour du genre. Il est alors question de mettre les intérêts des enfants au centre de toutes les décisions qui les concernent, en leur permettant de choisir parmi l’ensemble des jouets, des vêtements, des activités de loisirs, par exemple. Le travail de l’adulte consiste ici à réduire autant que faire se peut l’influence de l’entourage sur l’enfant. Ceci dit, quelle que soit l’approche qu’ils ou elles préconisent pour neutraliser au mieux les effets négatifs des assignations de genre sur leurs enfants, les parents rapportent se heurter un jour ou l’autre à un problème de taille: la scolarité.
La reproduction des normes de genre
se manifeste dès l’école primaire
La cour d’école est loin d’être exempte de messages liés à la sexualité. Plusieurs recherches de terrain démontrent comment la constante réitération de la binarité et de l’exclusivité du genre, même lorsqu’elle est informelle, a des effets sur les jeunes. L’étude de la sociologue états-unienne Barrie Thorne a révélé mieux que toute autre les règles non écrites qui scindent les enfants en sous-groupes genrés dans la cour de récréation, ou dans d’autres espaces ludiques qui leur sont consacrés. Dans ses écrits sur le gender play (littéralement, sur la dimension du genre dans les activités de loisir) – qui ont donné le coup d’envoi à ce qu’on nomme la «géographie du genre», soit l’étude de l’organisation genrée des espaces –, elle constate que la majorité des jeunes se regroupent par sexe, pratiquent des activités et fréquentent des espaces ségrégés, et ce, même lorsqu’il n’y a pas de consignes à cet égard. Les petites filles auraient ainsi tendance à prendre part à des activités en duo ou en petits groupes (corde à sauter, gymnastique, discussions) et à se tenir à proximité des adultes et du bâtiment scolaire, alors que les petits garçons joueraient plus volontiers à des sports d’équipe, dans des zones plus éloignées.
Qu’est-ce qui pousse la plupart de ces enfants à se regrouper avec d’autres camarades du même genre? On pourrait présumer en toute logique que la cour d’école ou le terrain de jeu constituent des espaces libres, qui ne demandent qu’à être investis au gré des intérêts manifestés par les jeunes qui les fréquentent. La réponse est à la fois du côté des adultes et de celui des pairs. Quoi qu’ils en disent, les adultes, qu’il s’agisse des parents, du corps enseignant ou du personnel éducatif (de surveillance ou d’intervention), ne sont pas complètement insensibles aux comportements genrés des enfants. Nombre d’études ont en effet consigné les rétroactions positives offertes aux jeunes présentant des attitudes conformes aux attentes de genre. Les adultes passeraient ainsi davantage de temps à interagir avec les enfants agissant en adéquation avec les stéréotypes de genre, ou encore leur donneraient un plus grand nombre d’encouragements (félicitations, regards attendris).
Les interactions entre pairs méritent tout autant d’être scrutées. On sait que les cours de récréation et les terrains de jeu ne sont pas que des espaces ludiques, mais constituent également des lieux d’agression. Par exemple, dès lors qu’une activité est considérée «pour les filles», un garçon qui cherche à s’y joindre est vu comme désireux de transgresser une barrière de genre et sera aussitôt remis à sa place. On dira de lui, de manière à le tourner en ridicule: «Regardez, Adrien veut jouer à la corde à sauter avec les filles. Adrien est une fille!» Si une équipe de garçons affronte une équipe de filles à un sport donné, disons le football, on observe que les interactions entre les participant·e·s deviennent rapidement instables, et présentent un haut potentiel explosif. Chacun·e cherche à se mettre en valeur dans une dynamique de séduction hétérosexuelle, que ce soit en cherchant à prendre des risques ou en tournant en dérision les rivaux ou rivales possibles (même lorsque ces personnes font partie de la même équipe sportive). Barrie Thorne rappelle que les enfants mobilisent communément le jeu («on ne fait que jouer», «on s’amuse») pour transmettre des messages genrés sérieux sur la sexualité et l’agressio...