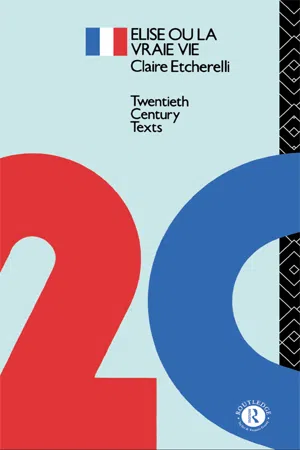
- 304 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Elise ou la Vraie Vie
About this book
Includes the full French text, accompanied by French-English vocabulary. Notes and a detailed introduction in English put the work in its social and historical context.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Elise ou la Vraie Vie by Claire Etcherelli, John Roach in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Literature & Literary Criticism. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
ELISE OU LA VRAIE VIE
PREMIERE PARTIE
Surtout ne pas penser. Comme on dit « Surtout ne pas bouger » à un blessé aux membres brisés. Ne pas penser. Repousser les images, toujours les mêmes, celles d’hier, du temps qui ne reviendra plus. Ne pas penser. Ne pas reprendre les dernières phrases de la dernière conversation, les mots que la séparation a rendus définitifs, se dire qu’il fait doux pour la saison, que les gens d’en face rentrent bien tard; s’éparpiller dans les détails, se pencher, s’intéresser au spectacle de la rue. Dehors, les passants marchent, se croisent, rentrent, partent. Il y a des ouvriers qui portent leur petit sac de casse-croûte vide roulé dans la main. Les bars dovient être pleins, c’est l’heure où l’on s’y bouscule. Ce soir, il y aura des femmes qui seront heureuses sur une terre à la dérive, une île flottante, une chambre où l’on est deux. Quitter la vitre, descendre? Dans la rue, il y aurait sûrement une aventure* pour moi. Les trottoirs sont pleins d’hommes avec leurs yeux chercheurs. Je n’aime pas les aventures. Je veux partir sur un bateau qui ne fera jamais escale.* Embarquer, débarquer, cela n’est pas pour moi. Cette image d’un bateau, je l’ai prise à mon frère, Lucien. « Je te promets un vaisseau qui tracera au milieu de la mer une route où pas un autre n’osera le suivre. » Il l’avait écrit pour Anna. Il doit être sept heures, il fait bon, c’est un vrai mois de juin avec des soirées tièdes qui font penser: « Enfin l’été…» La chaîne s’arrête à sept heures. Les hommes vont se ruer dans les vestiaires. Je commence ici ma dernière nuit. Demain je quitterai la chambre. Anna viendra chercher la clé. Il faudra la remercier. Elle ne s’étonnera pas, elle ne questionne jamais. Quand elle parle c’est toujours au présent. Elle est non point discrète ou pudique, mais idéalement indifférente. Lucien nous voulait amies, mais elle n’a besoin ni de confidente, ni de conseillère, ni de bienfaitrice. Quant à moi, j’ai perdu l’habitude. A treize ans, j’avais une amie « pour la vie »; à quinze ans, je n’avais plus que des camarades dont l’oeil devenait critique. D’ailleurs, j’étais déjà du côté de Lucien. Cette année de mes quinze ans, je lui abandonnai ma chambre. Jusqu’alors, mon frère avait dormi dans la cuisine, sur un lit que nous enlevions le matin. Pour le gagner à moi, je lui cédai ce qu’il désirait le plus, cette petite pièce carrée, ensoleillée jusqu’à midi, et qui ouvrait sur la cour. Quand la grand-mère nous vit déménager nos affaires, elle se fâcha. Pour l’apaiser, je lui promis que, désormais, je partagerais son grand lit. Cela lui fit plaisir, elle aimait parler la nuit, dans le noir. Une année avant la guerre, nous étions venus habiter chez elle puisqu’elle allait nous élever. En 40, nous traversions le Pont de Pierre* quand les premiers camions allemands arrivèrent. « Les Boches », dis-je à Lucien. Il prit le mot, le répéta partout. Il fallut lui apprendre à l’oublier. C’était le temps du collège. Nous nous disputions le soir, je le giflais, il déchirait mes papiers. Nous tracions à la craie des V sur nos chaussures; nous étions mal nourris, la grand-mère avait refusé que nous fussions placés à la campagne, elle ne voulait pas nous séparer d’elle. Aussi nous ne manquâmes pas un seul bombardement, pas une seule chaîne devant les épiceries. Chaque matin, Lucien et moi partions ensemble et, par prudence, je ne le quittais qu’à la porte de son école. Je continuai, après la guerre, à vouloir le conduire. Il me supportait à peine et je m’accrochais à lui. Comme il marchait vite, je pressais le pas. Nous traversions la place de la Victoire et ses bouquets de fleuristes. Dans chaque étalage trônaient les généraux vainqueurs. Lucien s’arrêtait, les regardait. Je m’arrêtais aussi. Il guettait cet instant, s’élançait, courait pour me perdre. Je le trouvais cynique, rusé. Je décidai que mon exemple serait pour lui la meilleure des morales.
J’étais doucement tombée dans une dévotion scrupuleuse, sévère, de laquelle je tirais tous mes bonheurs, La grand-mère n’y était pas pour grand-chose, elle nous avait enseigné nos prières, les mots péché et sacrifice, mais sa foi, comme sa philosophie, se résumait dans cette phrase qu’elle aimait à répéter: « Le Bon Dieu a une grande louche et il sert tout le monde. » Émotions et plaisirs m’étaient venus dans ces jardins du patronage, verts comme une oasis, où, chaque jeudi et dimanche, à l’ombre des religieuses calmes, s’était formé mon goût des fleurs, des napperons brodés, des teints pâles et de l’âme propre.
La grand-mère faisait encore quelques ménages dans les bureaux du port. Son principal souci restait le ravitaillement, toujours difficile. Lucien, depuis qu’il avait sa chambre, s’enfermait chaque soir. Je regrettais de la lui avoir cédée. Dormir avec la grand-mère me devenait pénible. A seize ans, je quittai le collège et commençai à travailler. Des commerçants voisins m’avaient conseillée: louer une machine à écrire, apprendre seule puisque les cours étaient au-dessus de nos moyens, et taper des copies. Plus tard, disposant d’un peu d’argent, je pourrais faire mieux. Je n’avais ni vocation ni ambition. Je rêvais de me sacrifier pour Lucien. Personne ne me guidait et je me jugeais favorisée en comparaison des filles de mon quartier qui, à quinze ans, prenaient le chemin de l’usine.
Le matin, je m’occupais de notre ménage et des courses. A midi, quand Lucien rentrait, j’étais fière qu’il trouvât une table prête, une maison rangée, des visages tranquilles, autant d’images de ce que j’appelais la vie droite, et qui se graveraient en lui, le marqueraient, lui créant l’habitude, puis le besoin de cet équilibre.
Demain, elle frappera doucement:
« C’est Anna. J’ouvrirai, nous nous saluerons.
« Vous partez? Vous n’avez plus besoin de la chambre? « Non, j’ai ramassé toutes mes affaires.
Viendra le plus difficile: remercier. Pressées l’une et l’autre de ne plus nous voir, nous éviterons les longues formules. Parlera-t-elle de Lucien?
A quatorze ans, mon frère eut deux passions: son amitié pour Henri, ce qui était sa passion noble, et des patins à roulettes, qu’il chaussait dès son retour du collège. Pendant des mois nous entendîmes chaque soir le roulement des patins le long du trottoir, dans la rue. Le dimanche, il se levait tôt, déjeunait vite, rentrait à midi pour repartir jusqu’au soir et se coucher tremblant de fatigue. Un matin, par curiosité, je me rendis derrière les Quinconces.* La brume froide effaçait le toit des maisons, les branches des arbres noirs étaient givrées et les réverbères brûlaient encore. Je m’inquiétai pour Lucien et décidai de le ramener avec moi. Je l’apeçfus seul dans le brouillard glacé, avec son petit pardessus beige qui s’arrêtait aux cuisses, ses chaussettes tirées sur les genoux et les patins aux pieds. Il avait quitté son écharpe rouge, je la vis par terre, près d’un arbre. Je le regardai, le jarret creusé, la peau de ses cuisses nues rougie, les bras en avant prêt à s’élancer. Je devinai son bonheur, ce vagabondage dans la brume, la douceur de la solitude, de la vie endormie, la sensation de la liberté retrouvée, l’ivresse de courir devant soi, sans obstacle, les yeux mouillés de froid, les mains glacées, les pieds brûlants. Je pensai à son retour dans la cuisine, la grand-mère tricotant, moi lisant, et lui flottant entre nous deux.
Plusieurs fois, j’essayai, les après-midi, de l’accompagner. Assise au milieu des mères, j’attendais six heures, patiemment, son goûter sur les genoux, trouvant toujours quelqu’un à écouter. Mais je dus renoncer même à ce plaisir, car, sur le chemin du retour, il m’accusait de le surveiller, de l’épier, de l’agacer, menaçait de changer d’endroit, de ne plus sortir si je devais le suivre partout.
La grand-mère et lui se disputaient souvent. Elle l’accablait de reproches futiles, il lui répondait avec insolence. Quelque temps encore il nous parla d’Henri, mais avec pudeur, la voix changée, timide. Cette retenue me fit sentir combien il l’aimait. Je connus cet Henri un jour, à la sortie du collège. Plus âgé que Lucien, sa froideur lui tenait lieu d’autorité. Il parlait lentement, la voix grave. Il m’intimida beaucoup, bien qu’il n’eut que dix-sept ans. Il me trouva, paraît-il, petite. A vingt ans, il est vrai, je paraissais très jeune. J’étais orgueilleuse de ma fadeur, je m’habillais sans couleurs et me satisfaisais de n’être pas « comme les autres ».
« Toi, me dit plus tard Lucien, tu n’es exceptionnelle que pour toi-même. »
Les Jeux du collège approchaient. Ils avaient lieu le dernier dimanche de mai. Henri, l’athlète entraîné, préparait la fête gymnique, et mon frère espérait en être la vedette. Il exerçait ses muscles, le soir, quand il nous croyait en bas. Il était sur d’être choisi; il m’en parlait, mais avec détachement, comme de tout ce qu’il aimait. Il n’eut pas cet honneur. Henri prit un certain Cazale, meilleur que Lucien sans doute.
« Je dois me hisser au portique et prendre la pose, m’avoua-t-il. Cazale grimpe à la perche et il commence ses acrobaties. Moi, je suis près de lui et je n’ai rien à faire qu’à l’aider deux fois a se redresser. Je sers de chandelier. Je ne jouerai pas. » Il accepta pourtant. De chaque répétition, il revenait insolent et malheureux. Il ne voulait pas du succès de Cazale, il ne voulait pas le voir saluer sous les applaudissements, voir Henri lui taper sur l’épaule et l’emmener boire après le triomphe.
En maillot bleu, il grimpa nerveusement et s’immobilisa sur la poutre. A l’instant où Cazale, qui l’avait rejoint, commençait ses exercices, nous vîmes Lucien reculer jusqu’à l’extrême bord de la planche et, comme s’il ne savait pas le danger, tomber en arrière. Tout le monde cria, se leva. Cazale descendit, tremblant. Lucien avait gagné. Cazale ne joua pas. Mon frère resta trois mois allongé, la jambe gauche cassée, un poignet fêlé, des plaies à la tête et au visage. Il ne passa pas son examen, ne retourna plus au collège. Henri ne vint jamais le voir; il envoya, une seule fois, une carte d’excuses et de voeux.
Ni lettres ni visites, rien que nous trois. Pas d’autre vue que la pierre des maisons d’en face. Il lisait. Il lui fallait beaucoup de livres. Il jouait aux dames. Il fumait. Le matin, je restais près de lui. Il m’avoua la vérité, ce désir enragé, que Cazale ne fût pas la vedette. Touchée de sa confiance je n’osai le blâmer. Je passai des semaines inoubliables. Il me parlait, m’appelait si quelque lecture l’enthousiasmait, essayait en riant de me faire partager ses goûts, ses idées qui, souvent, me choquaient. Son lit était encombré de journaux qui portaient en gras le nom de MAO-KHE. On s’y battait, mais je ne m’en souciais pas. Il n’ouvrait jamais aucun cahier, ne parlait pas de retourner au collège. Parfois il disait: « Laissez-moi guérir, marcher, et je m’engage. » La grand-mère s’affolait, elle le voyait déjà dans les rizières d’Indochine—elle disait de Chine. Mal guéri, il traîna tout un hiver.
Nos grandes tendresses étaient terminées. Elles n’avaient pas duré longtemps. Il passait à nouveau ses journées enfermé et nous menaçait, à la moindre réprimande:
« Si ça continue, je m’engage… »
Sur son mur, il avait épinglé une carte avec des drapeaux minuscules, tricolores et noirs. La grand-mère, impressionnée, n’osait plus rien lui dire. Quand il sortait le soir, je savais qu’il allait regarder les bateaux, l’eau et les réverbères du Pont qui s’y noyaient. Il n’avait pas d’argent et nous en réclamait rarement.
Deux ans après l’accident, il restait encore d’une santé fragile. Il ne s’engagea pas,* ne partit pas, il épousa Marie-Louise.
Quand Lucien paraissait le matin, je détournais la tête. Il nous disait bonjour en grognant. Il nous en voulait d’être là, d’exister, de le voir. Il nous aurait souhaitées indifférentes, aveugles, et que son apparition dans la cuisine ne nous fît même pas tourner la tête. Déjè, petit garçon, réveillé entre nos deux sourires, il se débattait: « Non, non…»
Il y avait ce moment difficile à traverser, son arrivée, sa froideur, son humeur lourde, longue à se déchirer. Il fallait ne pas faire d’erreurs, trouver le geste, le mot qui détendrait. Se lever, accomplir tous les gestes intimes du matin devant nous lui coûtait. Je l’imaginais sortant frais étrillé, souriant, d’une salle de bains. J’avais épuisé tous les moyens, la douceur, la gaieté, la moquerie, car je voulais à tout prix rendre agréable notre première heure en commun. Parce qu’il me fallait une certaine atmosphère de sérénité, de gentillesse, je voulais l’obliger à y pénétrer.
Il m’arriva de lui proposer un emploi dans les maisons qui me faisaient travailler. « Non, mais… » me rabrouait-il avec ce mépris particulier à ceux qui, n’ayant jamais travaillé, passent leur vie dans l’attente d’une occupation digne d’eux. Une seule passion l’habitait: son amour neuf. Sans copains pour ironiser, railler, vulgariser les premiers désirs, les élans, et tout ce qu’on veut dire à dix-huit ans avec le mot amour, il l’avait agrandi démesurément, transfigure. Son imagination féconde, l’indifférence qui le coupait de ce qu’il appelait «le reste» l’enfermaient entre leurs murs épais, le préservaient de nous. Quand les fenêtres s’ouvrent après les pluies de mars, il y avait eu, dans le petit matin, Marie-Louise, les bras levés, coiffant sa frange noire. Une ombre d’abord, des contours imprécis, puis, à l’approche de l’été, un visage doré par le contrejour.
La grand-mère les heurta, un soir qu’ils s’embrassaient derrière la porte de la rue. Elle se fâcha, lui conseilla de chercher des filles ailleurs que dans la maison.
Je fouillais souvent sa chambre et son linge. Mais il avait un désordre si bien organisé qu’il pouvait cacher quelque chose sans risque. Sur le mur, la carte s’empoussiérait. Il ne nous supportait plus, nous blessait de ses critiques grossières et quand il nous parlait—ce qui arrivait rarement —il se lançait dans des dissertations enflammées sur la fierté d’être, en des temps pareils, un opprimé.
« Oui, mais toi, Lucien, tu fais ce que tu veux. Jusqu’à maintenant, il est vrai, tu as choisi de ne rien faire. Je l’atteignais. Je le voyais dans ses yeux. Il m’aurait frappée avec plaisir. Alors, il retournait dans sa chambre. Devant ses yeux, la fenêtre de Marie-Louise. Il écrasait son front contre...
Table of contents
- COVER PAGE
- TITLE PAGE
- COPYRIGHT PAGE
- TWENTIETH CENTURY FRENCH TEXTS
- ACKNOWLEDGEMENTS
- INTRODUCTION
- NOTES TO THE INTRODUCTION
- BIBLIOGRAPHY
- ELISE OU LA VRAIE VIE
- NOTES TO THE TEXT