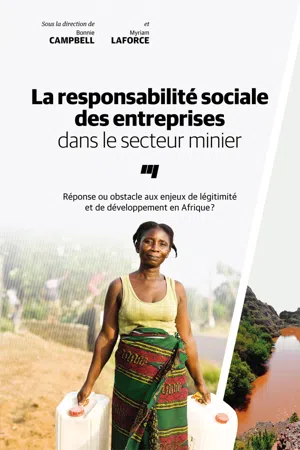![]()
CHAPITRE 1 /
Responsabilité sociale des entreprises dans le secteur minier
Quelle contribution pour le développement?
Gabriel Goyette-Côté
La mobilisation des ressources privées est au cœur des discours sur le développement depuis plusieurs années, tant du côté des États que chez les organisations internationales spécialisées. Ces acteurs soulignent l’importance des investissements privés, notamment dans l’exploitation des ressources extractives, pour assurer le développement, la croissance et la lutte à la pauvreté. On constate d’ailleurs que de plus en plus de bailleurs bilatéraux disposent de politiques relatives à la mise en valeur des ressources naturelles dans leur dispositif d’aide au développement. Cet intérêt porté au rôle du secteur privé s’est manifesté parallèlement à un virage en faveur d’une vision du développement humain et centré sur des résultats concrets en matière de lutte à la pauvreté. Une rupture s’est donc produite entre, d’une part, l’hypothèse traditionnelle selon laquelle l’amélioration des conditions de vie pourrait résulter de l’apport de l’aide au développement et, d’autre part, l’hypothèse que le développement, compris en termes de croissance économique, devrait plutôt être promu par les investissements privés (Campbell, 2005).
Avec l’adoption des Objectifs du millénaire pour le développement en 2000, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a avalisé la mise en œuvre d’un modèle de développement centré sur les conditions de vie des individus (Thérien, 2012), mais qui abandonnait toute visée transformative ou développementale structurelle à l’échelle nationale (Pogge, Köhler et Cimadamore, 2013). Dès lors, le développement, que l’on réduisait avant tout à sa dimension économique, devait être assuré par la croissance de l’activité privée, elle-même mue par des investissements privés. C’est la vision que l’on retrouve dans plusieurs des documents contemporains d’accords internationaux sur la question, par exemple le consensus de Monterrey sur le financement du développement (ONU, 2002), qui met l’accent sur le rôle des investissements privés nationaux (section A), des flux d’investissements étrangers (section B) et du commerce international (section C), avant d’aborder la question de l’aide au développement officielle (section D) et de la réduction de la dette (section E). D’autres initiatives internationales contribuent également à la consolidation de la place du secteur privé dans le développement et établissent la responsabilité sociale des entreprises (RSE) comme modalité essentielle à ce processus, dont le Pacte mondial (Global Compact) de l’ONU1 (Jenkins, 2005).
Le déclin d’une vision plus globale qui cherchait à articuler, du moins formellement, la lutte à la pauvreté et la promotion du développement a pour effet de diriger l’aide publique au développement vers les manifestations du mal-développement plutôt que vers ses causes. Elle a en outre pour conséquence d’attribuer un rôle central au secteur privé dans les dynamiques de croissance dites développementales ou antipauvreté. Cela a favorisé la réflexion sur la manière dont il fallait s’y prendre pour attirer davantage d’investissements dans et pour les pays du Sud, souvent au prix d’un nivellement par le bas des régimes réglementaires, notamment dans le cas du secteur extractif (Campbell, 2009), de même que sur la façon d’accroître la portée des investissements privés sur le développement. Dans ce second débat, la RSE reçoit une grande attention et est fréquemment citée comme la solution à privilégier en raison de sa souplesse et de son acceptabilité auprès des investisseurs.
C’est dans ce contexte que l’on a vu émerger de nombreuses initiatives en matière de RSE au niveau international, qu’elles soient générales comme le Global Compact de l’ONU et les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales ou encore sectorielles comme l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) et le Processus de Kimberley. Des stratégies en matière de développement du secteur privé et de promotion de la RSE pour le développement dans le secteur extractif émergeront aussi du côté des bailleurs bilatéraux comme le Canada, avec sa priorité thématique en faveur du secteur privé et sa stratégie Renforcer l’avantage canadien: stratégie de RSE pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger, adoptée en 2009 et récemment renommée Le modèle d’affaires canadien: stratégie de promotion de la responsabilité sociale des entreprises pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger (Affaires mondiales Canada, 2014). Cette stratégie comprend un important volet développemental dont la responsabilité incombait initialement à l’Agence canadienne de développement international (ACDI), institution incorporée en 2013 dans le ministère canadien des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD), devenu en 2015 Affaires mondiales Canada à la suite de l’élection du gouvernement libéral. Au Canada, la conviction de la centralité du secteur privé dans le développement semble profondément ancrée chez les ministres conservateurs d’alors si l’on en croit les nombreuses déclarations publiques à cet égard des ministres Oda2, Fantino3 et Paradis4 et l’importance de cette préoccupation dans les stratégies adoptées et dans les communications publiques de l’agence (voir l’encadré 1.1). Le lien est aussi clairement fait entre RSE et accroissement de la portée développementale des investissements privés, notamment dans le secteur extractif.
Puisque cet ouvrage présente certaines analyses empiriques de l’application de stratégies de RSE dans le secteur extractif en Afrique, nous chercherons ici à relever et à analyser les apports théoriques qui soutiennent que la responsabilité sociale des entreprises peut s’avérer une approche viable pour assurer que les investissements privés contribuent au développement, en précisant de quelle manière. Bien que cette contribution soit essentiellement conceptuelle et théorique, nous l’ancrerons et l’illustrerons à partir de la stratégie canadienne concernant la promotion du secteur extractif et dans le contexte des défis nommés dans le document de stratégie Vision du régime minier de l’Afrique (UA, 2009).
ENCADRÉ 1.1 / Détails des axes d’intervention de l’ACDI
I. Établir des assises économiques
•Renforcer la gestion des finances publiques à l’échelle locale, régionale et nationale
•Améliorer les cadres et les systèmes réglementaires et juridiques pour stabiliser les économies
•Aider les gouvernements et les entreprises du secteur privé à élargir leurs activités et à entrer dans les marchés régionaux et mondiaux
II. Renforcer les capacités en matière de gestion durable des ressources naturelles
•Favoriser la croissance des entreprises
•Soutenir davantage les micro, petites et moyennes entreprises, en particulier celles qui sont gérées par des femmes
•Accroître la productivité
•Accroître la disponibilité des services financiers (y compris le microfinancement)
III. Investir dans le capital humain
•Augmenter l’accès à la formation axée sur les compétences et la demande (y compris la formation en lecture, en écriture et en calcul)
•Multiplier les occasions d’apprentissage en milieu de travail (surtout en agriculture)
•Soutenir des initiatives d’apprentissage qui stimuleront la croissance des entreprises, l’expansion des marchés et la productivité
Source: ACDI, 2010.
Nous situerons d’abord l’argumentaire dans la littérature sur la RSE et son évolution, puis sur la RSE dans les pays en développement. Nous chercherons alors à voir si de telles stratégies peuvent constituer une approche valable en elle-même, notamment grâce aux contributions de Porter et Kramer (2011) et de Zadek (2006). Par la suite, nous tenterons de déterminer si la RSE a le potentiel voulu pour dépasser les limites traditionnellement identifiées en ce qui a trait à la répercussion pour le développement de l’investissement dans le secteur extractif. À cette fin, nous ferons référence à la fois à la littérature sur la «malédiction des ressources5» et aux analyses qu’ont produites l’Union africaine (UA) et la Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies (CEANU) concernant la contribution développementale du secteur extractif dans le cadre du processus de développement de la Vision du régime minier de l’Afrique, de même qu’à la littérature plus générale sur ce secteur. Finalement, nous analyserons la stratégie canadienne en matière de RSE au regard des conclusions théoriques tirées de l’exercice en cours pour tenter d’évaluer dans quelle mesure elle est susceptible d’accroître l’efficacité de l’aide canadienne, sachant que cette stratégie a été adoptée à cette fin (Brown, 2012).
1/La RSE, l’évolution d’un concept
Bien que l’intérêt du public et du monde des affaires pour la responsabilité sociale des entreprises ne date que d’une vingtaine d’années, elle est aujourd’hui solidement implantée dans les perceptions des différents acteurs politiques, sociaux et du monde des affaires. Si l’on situe normalement son émergence dans la littérature scientifique dans les années 1950 avec les travaux de Howard R. Bowen, Okoye reconnaît, dans une série d’articles de Dodd et Berle parus dans le Harvard Law Review dans les années 1930, la genèse de cette notion (Okoye, 2009). La contribution de Bowen à l’émergence de la littérature sur la RSE est particulièrement notable et mérite une attention plus soutenue, puisque l’essentiel de la réflexion à l’époque autour de ce que nous considérons aujourd’hui comme la RSE s’intéressait essentiellement à la notion de philanthropie (Carroll, 1999). Or, dans Social Responsibilities of the Businessman qu’il publie en 1953, Bowen élargit la réflexion et offre l’une des premières définitions de la RSE:
It refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society (Bowen, 2013, p. 6).
La réflexion de Bowen part d’un constat simple: l’effet des décisions des gestionnaires des plus grandes firmes se fait sentir bien au-delà de celles-ci sur la société. L’auteur s’interroge par conséquent sur le degré de responsabilité que l’on peut raisonnablement exiger de ces administrateurs quant à leurs actions. Il souligne que, bien que les gestionnaires n’aient d’obligations légales qu’envers leurs actionnaires, leurs obligations éthiques s’étendent à l’ensemble de ceux qu’ils affectent par leurs actes. Cette conception est fortement influencée par le contexte américain de l’époque où les firmes américaines, en raison de l’affaiblissement de leurs compétiteurs européens dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et de leur forte productivité relative, occupaient une place prépondérante dans l’économie mondiale (Keohane, 2005).
Les deux décennies suivantes, 1960 et 1970, sont marquées par une formalisation du concept de RSE et par un approfondissement technique de ses implications managériales (Carroll, 1999). Par exemple, dans leur ouvrage The Modern Corporation and Social Responsibility, Manne et Wallich établissent une série de critères pour déterminer ce qui constitue, ou non, de la RSE:
To qualify as a socially responsible corporate action, a business expenditure or activity must be one for which the marginal returns to the corporation are less than the returns available from some alternative expenditure, must be purely voluntary, and must be an actual corporate expenditure rather than a conduit for individual largesse (Manne et Wallich, 1972, cités par Carroll, 1999, p. 276).
Il faudra attendre les années 1980 pour voir un véritable élargissement des préoccupations s’imposer dans la littérature. Bien que la philanthropie et les enjeux éthiques conservent une grande place, la réflexion sur la RSE s’ouvre alors à de nouveaux acteurs et parties prenantes et s’intéresse à l’articulation entre RSE et politiques publiques.
Les années 1990 marquent l’émergence dans le discours de la notion de développement durable qui influencera sur le plan substantif le contenu de ce qui était associé à la RSE. La notion de développement durable acquiert de la notoriété avec le rapport Brundtland en 1987, mais c’est le Sommet de la Terre de Rio en 1992 qui marque la consolidation de celle-ci et qui explique son influence sur la RSE depuis. Au tournant du millénaire, on assiste à une institutionnalisation et à une internationalisation de cette notion. Se mettent alors en place de nombreuses initiatives internationales en matière de RSE à portée générale, dont celles notées ci-dessus, comme le Pacte mondial de l’ONU, les Principes directeurs de l’OCDE et des initiatives sectorielles (Processus de Kimberley pour les diamants liés à des situations caractérisées par des conflits et qui sera abordé dans le chapitre 4 du présent ouvrage).
Malgré ces ouvertures dans la littérature et la portée globale de notions comme la RSE ou le développement durable, Carroll souligne qu’historiquement la recherche sur la RSE demeure largement dominée par les universitaires américains et se concentre essentiellement sur son application dans les économies avancées.
[a]lthough it is possible to see footprints of CSR [corporate social responsibility] thought throughout the world (mostly in developed countries), formal writings have been most evident in the United States, where a sizable body of literature has accumulated (Carroll, 1999, p. 268).
Ce biais est encore largement présent dans la littérature contemporaine sur la RSE, même si certains auteurs soulignent que l’importance relative de la RSE est plus grande, tant pour les firmes que pour la société, dans l’environnement légal et institutionnel plus faible qui caractérise de nombreux pays dits en développement (Dobers et Halme, 2009). Empiriquement, au clivage entre pays développés et en développement s’ajoute une division parmi ces derniers. Une étude menée en 2007 dans 104 pays dits en développement montre à la fois une relation positive entre un degré important d’activités de RSE et le produit intérieur brut (PIB), et une relation négative avec un indice de corruption (Baughn, Bodie et McIntosh, 2007). Bref, Baughn relève un paradoxe important: plus la RSE pourrait constituer un complément à une faible gouvernance et plus l’environnement économique est précaire, moins elle est empiriquement présente. Enfin, la littérature actuelle sur la RSE illustre également l’arrimage complexe entre cette pratique et le développement. Une étude empirique des pratiques transnationales des firmes en matière de RSE démontre que c’est l’importance de la RSE dans le pays d’origine d’une firme qui détermine ses pratiques, plutôt que le contexte ou les besoins dans le pays où opère celle-ci (Goldberg, 2008).
Pourtant, malgré les défis soulignés ici en ce qui concerne la mise en oeuvre de stratégies de...