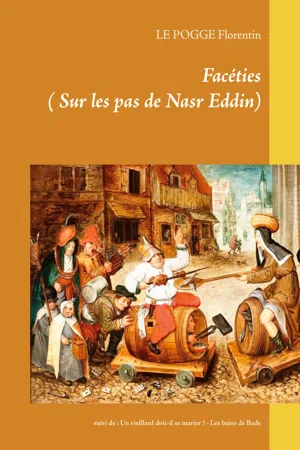![]()
LES FACÉTIES
DE POGGE
FLORENTIN
![]()
Avis aux gens prudes de ne pas censurer
le ton léger des « Facéties »
Je présume qu’il y aura beaucoup de gens qui trouveront à reprendre à ces contes, comme à des légèretés indignes d’un homme grave, et réclameront un langage plus orné, une éloquence plus grande. Si je voulais leur répondre, je dirais avoir lu que nos ancêtres, qui étaient gens sages et doctes, se sont délectés aux facéties, aux joyeusetés, aux fables, qu’ils ont ainsi mérité non le blâme, mais la louange, et je croirais avoir assez fait pour leur opinion. En effet, comment penser qu’il est honteux d’imiter en cela nos ancêtres, ne le pouvant en autre chose, honteux de passer dans le soin d’écrire ce même temps que les autres passent dans les cercles et les réunions, alors surtout que ce travail n’est pas sans gloire et peut procurer de l’agrément aux lecteurs ?
Car il est louable, je dirai même nécessaire, d’arracher à ses soins continuels notre esprit accablé de préoccupations et de chagrins, de le tourner à la gaieté, de le détendre par la plaisanterie.
Mais chercher le style dans les petits sujets, même alors qu’il s’agit de rendre une facétie textuellement ou de rapporter les paroles d’autrui, me semble le fait d’un esprit trop exigeant. Il y a des choses qui ne peuvent être décrites d’une manière ornée, qui doivent être rapportées telles que les ont dites les acteurs de l’événement.
Certains penseront que mon excuse part de mon impuissance, je leur donne raison, pourvu qu’ils racontent les mêmes histoires encore mieux que moi, ce à quoi je les engage afin que la langue latine s’enrichisse de leur fait et brille même dans les petits sujets. Pour moi, j’ai voulu voir si beaucoup de choses qui étaient regardées comme difficiles à dire en latin, pouvaient s’exprimer sans trop d’effort.
Comme ce ne sont pas les ornements du style, l’ampleur de l’éloquence, qui se trouvent ici de mise, il me suffira d’entendre dire que j’ai écrit non sans agrément. Mais arrière ceux qui s’érigent en censeurs rigides ou en juges austères ! Je veux être lu par des esprits aimables et cultivés, comme Lucilius par ceux de Cosenza et de Tarente ; si mes lecteurs sont rustiques, qu’ils pensent ce qu’ils veulent, mais n’accusent pas l’auteur qui écrivit ceci pour le délassement de l’esprit et l’exercice de l’intelligence1.
![]()
1. D’un pauvre matelot de Gaète
Le peuple de Gaète vit de la navigation. Un patron de barque de cet endroit, homme fort pauvre, quitta sa femme et son humble logis pour chercher fortune ; il revint au bout de cinq ans. Son premier soin fut d’aller voir sa femme, qui, désespérant du retour de son mari, avait lié connaissance avec un autre. II fut surpris de trouver sa maison toute réparée et fort agrandie.
— Comment, dit-il, a pu se faire tout cela ?
Elle répondit incontinent que Dieu, qui aide à tout le monde, y avait répandu sa grâce.
— Dieu soit béni qui nous a fait tant de bien ! reprit le matelot.
Voyant alors la chambre à coucher, un lit et des meubles d’une élégance au-dessus de la condition de sa femme, il demanda d’où venait tout cela. Elle répondit encore que c’était de la bonté et grâce de Dieu. Le mari remercia encore le ciel, et tandis qu’il regardait beaucoup d’autres choses qui lui semblaient nouvelles dans son ménage, voici venir un petit enfant bien joli qui avait plus de trois ans et qui caressa sa mère comme c’est la coutume des enfants. Le mari regarde et demande à qui il appartient. La femme répond qu’il est à elle et que la grâce de Dieu lui a aidé à l’acquérir.
— Ah ! pour le coup, dit-il, c’est trop de grâce de me donner des enfants en mon absence !
2. D’un médecin qui guérissait les fous
Plusieurs s’entretenaient du vain souci, pour ne pas dire de la sottise, de ceux qui nourrissent des chiens ou des éperviers pour la chasse aux oiseaux. Alors Paul de Florence : « De ceux-là s’est bien moqué un fou de Milan. » Comme nous demandions l’histoire :
Il y avait, dit-il, à Milan, un médecin qui entreprenait de guérir les fous en un certain espace de temps. Voici quelle était sa méthode : il avait dans sa maison une cour et dans cette cour une mare d’eau fétide et sale dans laquelle il liait à un pieu, tout nus, ceux qu’on lui amenait comme fous, les uns jusqu’aux genoux, les autres jusqu’à l’aine, quelques-uns plus haut encore, selon le genre de démence, et il les macérait ainsi par l’eau et par la diète jusqu’à ce qu’ils donnassent des marques de raison.
Certain jour on lui en amena un qu’il mit dans l’eau jusqu’aux cuisses. Quand il eut été là quinze jours, il pria le médecin de l’en tirer, ce qu’il obtint à condition qu’il ne sortirait pas de la cour. Le malade obéit et reçut bientôt la permission de se promener dans toute la maison. Un jour il se tenait sur le seuil, qu’il ne dépassait pas, de crainte de la mare, lorsqu’il vit un jeune gentilhomme à cheval avec un épervier et deux chiens, de ceux qu’on appelle limiers. Comme le fou ne se souvenait plus de ce qu’il avait vu pendant sa démence :
— Apprenez-moi, je vous prie, dit-il au cavalier, sur quoi vous êtes monté et à quel usage vous sert cette monture ?
— Je monte un cheval et je vais à la chasse.
— Ce que vous tenez sur le poing, comment l’appelle-t-on et qu’en faites-vous ?
— C’est un épervier pour prendre des perdrix.
— Et qu’est-ce que vous avez autour de vous ?
— Ce sont des chiens pour faire partir le gibier.
— Mais combien vous revient-il par an de ce gibier, pour la cap-30ture duquel il faut tant de préparatifs ?
— Fort peu de chose, dit le chasseur, peut-être six ducats.
— Et la dépense du cheval, des oiseaux et des chiens, à quoi monte-t–elle ?
— A cinquante.
— Holà ! dit alors le fou, allez-vous-en avant que le médecin ne rentre ; car s’il vous entendait, il vous mettrait dans la mare jus-qu’au menton.
Ce fou montra que la chasse au vol était une grande folie si elle n’avait lieu seulement de temps en temps et si elle n’était pratiquée par des gens riches, en guise d’exercice.
3. D’un Gascon qui se levait tard
Lorsque nous séjournions à Constance, il y avait avec nous un jeune homme facétieux, nommé Bonac, Gascon d’origine, qui se levait tous les jours fort tard. Comme ses compagnons lui reprochaient sa paresse et lui demandaient ce qu’il faisait si tard au lit, il répondit en souriant :
— J’écoute des plaideurs. En effet, lorsque je m’éveille, il y a devant moi deux dames, l’Activité et la Paresse ; l’une m’exhorte à me lever et à faire quelque chose, l’autre, gourmandant sa voisine, dit qu’il faut se reposer, goûter la chaleur du lit et ne pas toujours vaquer au travail. La première soutient ses raisons, et pendant qu’elles se disputent ainsi, moi, en juge équitable, sans pencher d’aucun côté, j’écoute les plaidoyers et attends que les parties soient d’accord, et c’est ce qui fait que je suis si longtemps au lit.
4. D’un Juif qui se fit Chrétien par persuasion
Beaucoup de gens engageaient un certain Juif à embrasser la foi de Jésus-Christ. Mais celui-ci ne pouvait se décider à faire le sacrifice de ses biens. Plusieurs lui conseillaient de les donner aux pauvres, parce que, selon le précepte de l’Évangile, qui est la vérité même, il lui serait rendu au centuple. Persuadé enfin, il se convertit et distribua sa fortune aux pauvres, aux malheureux et aux mendiants.
Ensuite, pendant presque un mois, il fut honorablement traité par différents chrétiens. Il fut choyé et fêté pour tout ce qu’il venait de faire. Cependant, il menait une existence précaire, et attendait chaque jour le centuple promis. Comme les gens se lassaient peu à peu de le nourrir, les hôtes se firent rares. Notre homme devint alors si misérable qu’on dut le conduire à l’hôpital, où il fut pris d’un flux de sang par le bas, qui le réduisit à la dernière extrémité. Il désespérait de jamais guérir et il avait également perdu l’espoir de rentrer dans le fameux « centuple », lorsqu’un jour, éprouvant le besoin de prendre l’air, il sortit de son lit, et s’en alla dans une prairie voisine pour soulager son ventre.
Là, lorsqu’il eut fait ses besoins, en cherchant une poignée d’herbe pour se torcher le derrière, il trouva un chiffon roulé, tout plein de pierres précieuses. Par ce fait, étant redevenu riche, il put consulter les médecins, se guérir, acheter une maison et des terres, vivre depuis lors dans l’abondance. Tout le monde lui répétait :
— Eh bien ! Est-ce que nous ne vous l’avions pas prédit, que Dieu vous rendrait tout au centuple ?
— Oui, répondit-il, mais avant, il a permis que je fasse du sang jusqu’à en mourir.
Ce mot s’applique à ceux qui sont lents à rendre ou à reconnaître un bienfait.
5. D’un imbécile qui croyait que sa femme avait deux ouvertures
Un paysan de nos campagnes, peu avisé et nullement expert avec les femmes, se maria. Or, il arriva, qu’étant au lit, la femme lui tourna le dos, mettant ses fesses au bon endroit. Le mari en eut tout de même grande satisfaction. Tout surpris, notre homme demande à sa femme si elle n’aurait pas deux ouvertures. Celle-ci fit un signe affirmatif.
— Ho ho ! reprit-il, un seul me suffit, l’autre est superflu.
La femme, qui était rusée et que le curé de la paroisse courtisait, répondit aussitôt.
— Nous pouvons faire l’aumône avec le second ; donnons-le à l’Église et à notre curé, cela lui fera extrêmement plaisir et ne te privera en rien puisqu’un seul te suffit. L’homme approuva, tant pour être agréable au curé, que pour se débarrasser du superflu. Or donc, on invite le curé à souper, on lui conte l’affaire et, le repas achevé, tous trois se couchent dans le même lit : la femme au milieu, le mari par devant, l’autre par derrière, pour qu’il prît possession de ce qui lui était offert. Le prêtre, ardent, vorace, entama le premier le morceau depuis longtemps désiré, si bien que la femme poussait des soupirs retentissants. Le mari eut alors peur qu’on empiétât sur son domaine.
— Respecte bien nos conventions, mon ami, dit-il, use tant que tu voudras de ta part, mais ne touche pas à la mienne.
Le prêtre repartit :
— Que Dieu m’en fasse la grâce ! Je n’ai nulle envie de ton bien et ne demande qu’à user celui de l’Église.
A ces mots, notre imbécile se calme, et engage le curé à jouir en toute liberté de ce qui a été concédé à l’Église.
6. D’une veuve qui, par luxure, se donna à un pauvre
L’espèce des hypocrites est, de toutes, la pire qui existe. Comme on en parlait une fois dans une réunion où je me trouvais, et qu’on disait que tout leur vient à profusion, qu’ils convoitent les dignités en dissimulant leurs convoitises, qu’ils semblent subir les honneurs malgré eux, et uniquement pour obéir à des ordres supérieurs, un des assistants dit alors :
— Ils ressemblent à un certain Paul le bienheureux, qui habite Pise, un de ceux qu’on appelle ordinairement des apôtres, qui s’asseyent devant les portes sans rien demander.
L’ayant prié de nous expliquer la ...