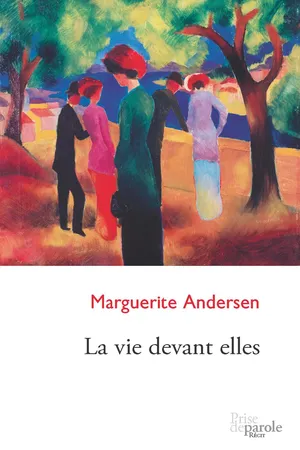La carrière
Ariane, détentrice d’un doctorat, auteure d’une thèse vite devenue un livre bien reçu et mère de deux enfants en bonne santé, commence sa carrière en remplaçant des anthropologues en congé. Un été à Lethbridge, agrémenté par une longue visite de Martin, qui n’enseigne pas durant ce semestre-là. Lui au moins a sa permanence maintenant. Un automne à St. John’s, à Terre-Neuve. Troisième épisode, un semestre d’hiver, à Sudbury, où elle enseigne pour la première fois en français. Il y a une visite de Fabien, qui photographie cette fois-ci des roches, et une autre de Martin, qui travaille à un livre sur le colonialisme et ses conséquences sur les petits États africains.
Martin reste deux mois à Sudbury. Le couple se lie d’amitié avec des francophones de la ville, les discussions se font en français. C’est un plaisir. Ariane et Martin mènent ainsi une vie presque normale durant ces quelques semaines, même s’ils sont un peu à l’étroit dans l’appartement que loue Ariane.
— Tu n’oublies pas la pilule? se rassure Martin un soir.
— Eh non.
Ils ne peuvent pas se permettre d’autres enfants.
Pour vaincre les distances, toute la famille se téléphone régulièrement. Ceux qui ont Skype se voient, les enfants voient leur père, leurs grands-parents, même Marguerite a installé le système sur son ordinateur pour qu’on puisse voir que Zézé, dont elle a accepté de prendre soin durant les absences d’Ariane, se porte bien. Tout le monde admire les enfants, qui font les clowns pour faire rire les adultes. Martin et Ariane se textent, s’envoient des courriels. Ils passent les longs week-ends et les fêtes ensemble... Mais impossible de trouver un poste plus permanent.
Knowledge as power, c’est ce que dit le slogan anglais, se lamente Ariane, mais je perds même ce que je sais, je ne sais plus où je suis ni où je vais, ce n’est pas cette vie que j’imaginais, je suis une migrante sans but, malheureuse. Désespérée. Perdue comme la Finnoise de l’aéroport de Berlin. Immobile, celle-ci voyait partir les autres, moi je pars constamment alors que les autres restent. Il n’y a que mes enfants qui me procurent une impression de permanence alors que je leur enlève la leur.
Ma mère me dit de renoncer à cette rat race, il se peut qu’elle ait raison. Martin me dit d’être patiente, mon père aussi, Fabien me dit de ne pas m’en faire, mes sœurs me disent que je mène tout de même une vie assez normale, avec un revenu pas mal respectable. Marguerite croit elle aussi en la persévérance...
Mais je suis sans espoir et donc sans force, aplatie, écrasée. Je continue d’enseigner l’« Introduction à l’anthropologie » parce que dans chaque département que je visite les profs établis se réservent les cours plus avancés, j’assiste sagement mais sans dire grand-chose aux réunions départementales, je suis les conseils des directeurs ou directrices, je rédige des articles et essaie de les publier, parce qu’on me dit que je dois avancer dans mon domaine, où pourtant il n’y aucun avancement.
Je cherche. Je lis les annonces dans les journaux, dans les revues savantes, dès que je vois quelque chose, j’envoie mon CV et je continue à attendre. Ce n’est pas ça que j’envisageais quand je me suis décidée à poursuivre mes études.
Je sais que cela arrive à beaucoup d’autres, que j’appartiens à toute une troupe de gens incapables de trouver un emploi qui soit stable. Parfois je pense que je devrais me lancer en politique, mais franchement, je les regarde faire, les politiciens, je les critique, je ne voudrais pas être des leurs. Quand je serai plus vieille, peut-être. Et même pas. Je suis trop égoïste. Pour le moment, ce n’est pas la vie en général qui m’intéresse, c’est ma vie, ma vie à moi, avec mes enfants, avec Martin, avec ma famille.
Encore heureux qu’à Sudbury on puisse vivre en français, mes enfants n’oublieront pas cette langue que j’aime. À Lethbridge et St. John’s, c’était l’anglais... Même au téléphone, avec Martin, on se parlait souvent en anglais.
Le soir, quand il n’est pas chez lui, je veux dire chez nous, je l’imagine parfois avec d’autres femmes, dans un lit, dans un restaurant, au cinéma. Je n’ose pas lui poser de questions.
Il lui dit, probablement en anglais encore :
— I have a wife and two kids.
— I want you.
— You don’t forget the pill?
— Of course not.
Il a envie d’elle. Ils font l’amour et je n’en sais rien. J’ai mal. Je me masturbe parfois.
Ou peut-être je regarde la télévision.
Je m’endors. Je dors trop. Si au moins je rêvais. Les enfants grandissent, je les amène, l’un, à la garderie, l’autre, à l’école. L’après-midi, je vais les chercher, les ramène dans le petit appartement pas cher que j’ai loué ici, au-dessus d’une pizzéria. Ils en veulent, je n’en achète pas, je prends soin de bien les nourrir.
Le soir, je leur lis des histoires, je joue avec eux, je les dorlote, on se met tous les trois dans la baignoire, je suis leur père et leur mère. Comment font les autres femmes? Comment faisait Bintou?... La femme à l’aéroport faisait-elle l’amour? Et avec qui? Où?
Parfois, mais pas très souvent, des collègues m’invitent chez eux.
— Votre mari doit vous manquer...
Ils invitent des célibataires pour que je ne me sente pas trop isolée. Je pense qu’ils sont contents quand je pars, vers dix heures, prétextant que la gardienne doit rentrer chez elle.
Je devrais organiser une soirée chez moi, mais j’ai honte de la pizzéria et du bric-à-brac qui meuble l’appartement.
Quand je regarde les nouvelles — en anglais, le soir —, il me semble que Peter Mansbridge est mon messager personnel. Je le regarde, j’aime le sourire qu’il cache sous son visage sérieux un peu trop rond. La chair de son cou pendouille légèrement, c’est peut-être pour ça qu’il reste plus ou moins immobile. Il est neutre dans ce qu’il annonce, j’aimerais le voir passionné, prenant parti.
Je clique sur Google Earth, prends le vol sans frais pour Paris, Londres, Berlin, Accra et Tamale. Je vais à Thornhill aussi, comme pour vérifier si Martin est bien rentré chez lui. Pourtant, je sais que la photo n’est pas live. Je pourrais lui téléphoner, mais je veux maîtriser mes impulsions. Être raisonnable. On s’est parlé en début de soirée.
J’ai trente-deux ans. Je voudrais être heureuse. Un peu du moins.
Je suis mécontente de moi-même. Je me trouve impatiente, exigeante, mauvaise mère parfois, trop facilement fatiguée, énervée, irritée, en colère, épuisée...
Ce n’est pas ainsi que je veux vivre.
Il faut que je trouve une solution, mais où?... Quand?...
CBC en a fini des nouvelles, je me couche, je lis quelques pages d’un roman à succès que je trouve médiocre.
J’éteins la lumière.
Je m’endors.
Le matin, ça va mieux. La routine quotidienne prend le dessus, les enfants sont joyeux, ils ont des projets pour quand ils seront avec leurs camarades. Ama emporte son crocodile en peluche, Kwabla ne peut pas se séparer du bout de couverture qu’il chérit, mais qu’il essaie de cacher dans la poche de sa salopette.
Il y a toujours de quoi rire avec eux.
Ariane arrive en classe avec deux minutes de retard, ce n’est pas grave, il y a plusieurs étudiants qui arrivent avec encore plus de retard.
Ce matin, il s’agit de discuter du travail du chercheur sur le terrain. Du premier contact avec l’Autre, ce qu’on appelle la rencontre, de la relation qui s’établit peu à peu, de la méthode et du discours anthropologiques.
— Chacun de vous, dit-elle, aura son propre labyrinthe à traverser, ses propres doutes et insuffisances à examiner.
Elle regarde son public.
— Vous, Pierre, vous ne suivrez pas le même cheminement que votre voisine, Érica. La pratique du terrain sera toujours singulière. D’après Sophie Caratini, qui travaille en Afrique saharienne, d’après moi, il n’y a pas de méthodologie générale et infaillible.
— Comment saurai-je si ma conduite...
— ... est la bonne? Vous en jugerez vous-même. Discutez-en avec vous-même dans ce qu’on appelle votre journal de bord. Regardez le détail des lignes de conduite universitaires établies pour l’anthropologie. Si vous respectez ces conditions générales visant à minimiser les risques du sujet et à les respecter, à respecter aussi la vie privée de l’individu, il reste autant de façons de faire de la recherche qu’il y a de chercheurs. L’anthropologue s’efforce d’être conscient de deux perspectives : celle du métier, positionnée selon des règles, et la sienne, inévitablement partiale.
Cinquante minutes plus tard, Ariane sort de la classe en se posant des questions sur sa propre méthode pédagogique, qui appelle à l’auto-interrogation et veut laisser toute la place à l’individu. Est-elle en train de rendre ses étudiants plus confus que nécessaire? Sa propre confusion est-elle contagieuse? Devrait-elle abandonner l’enseignement, essayer d’obtenir une petite place dans les rouages de la bureaucratie gouvernementale?
Arrive le miracle.
Jeudi matin. Une lettre aux timbres hauts en couleur attend dans le casier d’Ariane. Que lui veut donc Théa Asante, la directrice de l’Institut d’études africaines de l’Université du Ghana?
Accra, March 12, 2012
Dear Dr Boutier,
Your book, Poverty in Ghana : Women Living in Suspense, has come to my attention and that of my colleagues. We should like to hear you speaking on work during the international conference on African Women and Poverty which we are preparing for May 2013 and to which I have the pleasure and honour of inviting you today. The conference will focus on the role of African women in economic development. It is organized with the support of the UN by several departments of this University as well as by its Institute of African Studies.
Attached you will find the preliminary description and schedule of the conference, the list of its proposed participants, many of whom have already confirmed their participation, as well as a contract confirming your visit, and stipulating our obligations concerning your fee and expenses.
We would propose the title of your book as the title of your presentation and hope this will be agreeable to you.
Hoping you will be able to participate...
Ariane retient son souffle. Est-ce bien vrai? Est-ce possible? Elle relit la lettre, oui, il s’agit d’une invitation, il s’agit d’une reconnaissance de son travail, il y a des gens qui ont lu son livre et qui veulent qu’elle en parle, ils l’ont invitée, par écrit, oui, il y a même un contrat en pièce jointe, c’est sérieux, oui, elle ira au Ghana, oui, dans un an, oui! Sans plus tarder elle sort son cellulaire, envoie son consentement, respire.
Tout à coup, le monde est en couleurs, comme les timbres sur l’enveloppe de cette lettre. Sudbury est belle, même s’il fait froid et qu’on annonce une tempête de neige. Elle voudrait chanter la bonne nouvelle à tout le monde, mais il est trois heures et demie, il faudra bientôt aller chercher les enfants, leur faire un goûter, appeler Martin à Toronto...
Ariane a envie de faire des folies, les distances ont rétréci pour elle, elle a envie de mettre les petits dans la voiture et d’aller à Toronto, là, cet après-midi, tant pis s’il neige, il s’agit seulement de quatre heures et demie de route, ne pourrait-elle pas annuler son cours du vendredi matin, elle n’a jamais fait cela, she is too straight to play hooky, serait-elle capable de faire une exception? Elle aimerait surprendre Martin, tout simplement arriver à Thornhill, ce soir à dix heures, onze peut-être, les enfants dormiraient en route, seront tout étonnés de voir leur père, que dira-t-il, ou alors prendre l’avion, demain après-midi, quelle dépense, mais cela vaudrait la peine, elle fera des économies après. Oui, c’est ça, donner le cours le matin, aller chercher les enfants, s’envoler avec eux.
— Maman, maman, crie Ama dès qu’elle aperçoit sa mère devant la porte de l’éc...