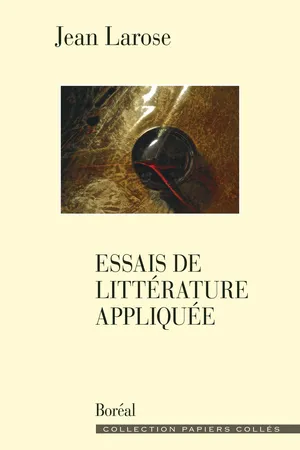Trop de tout
Je vieillis, c’est une des raisons pour lesquelles il m’est impossible de tout dire. Je ne peux dire qu’au milieu, au milieu de mon âge, au milieu de mon histoire, au milieu de mon travail. Pourtant, c’est plus fort que moi : j’essaie toujours de tout dire, mais j’ai beaucoup trop à dire, sans compter qu’il faut sans cesse redire.
Je connais bien le commandement de tout dire. Avec lui souvent m’arrive le découragement d’écrire, la tentation d’abandonner toute écriture, de ne plus rien dire du tout. Non que ces jours-là je ne puisse rien dire, mais rien ne semble pouvoir l’être comme il faudrait. Rien ne vaut en comparaison de l’art accompli et de la vérité sans art qu’il faudrait pour réellement obéir au commandement. « Écrire, disait Lyotard, est une pauvre tentative de répondre à une exigence, un essai, nécessairement manqué, de se mettre à la hauteur d’une dette émanant non d’un interlocuteur, mais d’un Autre, dont on ne sait pas ce qu’il demande, ni même s’il demande quelque chose. » Le silence de cet Autre m’intimide. Il ne demande peut-être rien mais, certains jours, il commande de tout dire. Ces jours-là, on a raté tous ses livres, on a manqué sa vie puisque ce qu’on a écrit, ce n’a pas été avec sa vie, pas un vrai don, en somme rien en comparaison de tout ce qu’il aurait fallu écrire.
Un ouvrage récent sur Marcel Proust s’intitule Tout dire, et pourtant, même Proust, qui a tant écrit, il me semble, à moi qui l’enseigne et le relis sans cesse, qu’il se serait récrié : mais non, je n’ai encore qu’effleuré mon sujet… Et le matin où il s’est enfin tu, où il a laissé tarir son flux, où il s’est laissé durement mourir, je le sens moins satisfait d’avoir tant fait que content de ne pas devoir faire plus. Il ne finira pas, il meurt sans finir, il s’évanouit dans une certaine lumière – comme Rembrandt, dont il a écrit qu’il avait fini par n’avoir pour but que de rendre une certaine lumière d’or, un certain « jour doré […] devenu pour lui toute la réalité » ; comme Bergotte aussi, qui meurt la main tendue vers le petit pan de mur jaune de la Vue de Delft : « C’est ainsi que j’aurais dû écrire… » Et ne peut-on dire de l’auteur, de Proust lui-même, qu’à l’heure de mourir « il semble que son regard soit au moment où, encore tendu sur la réalité qu’il avait essayé de saisir, [il est] déjà détaché de cet effort par la réalisation libératrice et nous demand[e] en quelque sorte », à nous qui allons survivre : « Est-ce cela ? » Y suis-je arrivé ? Ai-je donné le jour au monde unique que je portais – ce monde que je n’ai enfin plus de mots pour dire ?
C’est bien une chute dans le silence que prononce ce génie si prolixe en ces pages rares où la difficulté de dire une certaine chose se heurte en lui à la présence effective de ce qu’il appelle la pure matière. Éloquence matérielle de la matière même – symbole enfin sans mots – et de la fin muette qui, brisant les anneaux nécessaires du beau style, s’impose à lui avec une acuité hébétée, si c’est pensable, comme la seule réalité qu’il resterait à dire, celle qu’il n’a jamais su dire, qu’il ne dira pas. Aussi, Charlus enchaîné, Charlus en vérité sous le fouet, déchoit-il pour devenir pure matière.
L’intarissable Proust a donc connu lui aussi devant l’indicible une espèce d’aphasie, la tentation de croire que la vérité est au-delà des mots, dans une certaine lumière, dans la mort, dans l’abjection sexuelle. L’indicible du jour doré, du petit pan de mur jaune, de l’insensé sordide où s’avilit Charlus par la flagellation volontaire, l’a fait taire. Un symbole parfait, la pure matière, sans besoin ni possibilité de présentation ou de représentation parce qu’il est tellement tout qu’il laisse sans voix, qu’il suscite à peine un soupir : c’est ainsi que j’aurais dû… Oui, Proust, comme s’il avait su que le siècle à venir allait perdre de plus en plus sa voix d’artiste et choisir l’écriture sans art comme seule voie vraie, Proust, le plus grand styliste, a cru qu’il n’avait pas obéi parfaitement au commandement d’écrire, qu’il y avait plus et plus vrai à (ne pas) dire que ce que pouvait communiquer son beau style.
L’indicible n’est pas l’excès sexuel. L’homosexualité, la perversion sadomasochiste, par exemple, Proust les a dites aussi franchement que le fera Jean Genet, autant qu’il était possible à son époque. Je m’y arrête parce que « ces oublis, la part trouble à laquelle ils nous confrontent » – je cite le programme de votre colloque –, il me semble que trop d’écrivains s’obstinent à penser que c’est l’interdit sexuel à transgresser, le sexe à libérer. « Les marges dites et interdites », cela laisse entendre qu’il y aurait encore du refoulé, du censuré, de l’interdit dans notre culture. Sans doute, mais où ?
Dans mes cours de création littéraire, je fais parfois remarquer à mes étudiants qu’il devient de nos jours plus difficile de décrire une fleur que d’avouer ses pratiques sexuelles. Pourquoi ? Parce que la beauté des mots est devenue douteuse, sinon honteuse. Le beau style est suspect d’hypocrisie. Pour sonner vrai, il faut dire nu, dire sans manières, hurler ses affects et cracher ses abjects, et toute littérature qui n’est pas aveu du pire, viol, vomissement de tripes, écorchage, semble mentir, cacher sa vérité sous des convention dépassées. On ne vous pardonnera de décrire une jolie fleur qu’à condition que vous utilisiez un style défleuri. Que vous en fassiez une fleur de merde.
Jean Cocteau pouvait encore dire (en riant, peut-être) : « Devant sa vérité l’homme souvent recule / Qui donc ose avouer qu’il voudrait qu’on l’encule ? » Il n’y a plus d’audace à admettre ce désir-là. Ceux qui s’imaginent encore qu’ils transgressent (le verbe est devenu intransitif) en racontant leurs ébats sexuels n’ont qu’à visiter certains bars montréalais où des hommes suspendus à des sangles s’offrent à la pénétration de tout un chacun et la subissent effectivement devant tout le monde. Comparé à cela, l’aveu littéraire d’un désir sexuel est en retard d’un siècle, que dis-je, d’une civilisation. Si vous écrivez que votre désir serait de vous faire sodomiser en public, on accueillera peut-être la chose avec un certain malaise parce que, quand même, si cela se fait, la pratique en est assez restreinte, mais on vous considérera parce que vous aurez osé le dire – oubliant que ce n’est pas interdit. Par contre, si vous dépeignez la lumière de mai sur une branche de lilas ou le sourire d’un enfant qui dort, le langage dont il faudra vous servir, sa réserve, ses voiles, éveilleront le soupçon que vous écrivez orné, que vous n’écrivez pas franc, et vous passerez pour un précieux attardé d’un autre âge. Où est l’interdit ?
Étrange culture, étrange morale. D’une part, ce qui était naguère dans la marge réclame et obtient sa place dans le courant central de la culture. « Les homosexuels n’incarnent plus la race maudite du pervers sublime cher à Foucault ou à Genet, et leurs aspirations peuvent s’exprimer davantage en termes d’intégration, de couple, voire de famille » qu’en termes de pratiques transgressives. D’autre part, depuis l’adoption de cette position désormais au centre, la différence devenue normale n’a pas renoncé au profit de la marge ; il y aurait toujours de l’interdit à transgresser, du réprimé à libérer, du marginal à oser. Une fois qu’elle peut se pratiquer à l’abri de la loi, la transgression n’est pourtant qu’un jeu d’une audace sans risque. Ce qui est interdit en réalité dans cet étrange dispositif, c’est de reconnaître que ce courage est factice, ces transgressions une comédie, et qu’ils cachent autre chose, la chose réellement interdite. Adorno disait que « nos contemporains souffrent davantage de ne plus avoir d’inhibitions que d’en avoir trop ». Voilà déjà un indice.
Je pourrais d’expérience faire remarquer que ce qui fait scandale maintenant, plus que n’importe quel excès sexuel, c’est de dire que la littérature est une discipline sans égale pour former l’esprit. Je me suis fait insulter sur Internet parce que j’avais écrit qu’à l’école la littérature donne une meilleure formation que la bande dessinée. Le renvoi de la littérature dans la marge de la culture est plus réel que celui de bien des pratiques qui passent pour marginales.
Les marges interdites à la littérature me semblent donc sans intérêt pour l’écrivain. Ce qui importe, c’est l’interdit de pratiquer un certain langage, le refoulement dans la marge du langage littéraire, du langage qui essaie de dire le réel dans un monde qui, tout en commandant de tout dire, ne veut rien savoir de sa réalité et qui, pour ne pas connaître les vrais interdits, pour les renforcer même, joue à transgresser des interdits qui n’existent plus.
L’interdit aujourd’hui est de donner au malheur sa réalité dans la conscience. Mesurons la réalité de notre libération supposée non pas aux drogues que nous prenons, aux mots obscènes que nous utilisons sans souci d’une morale bourgeoise qui en réalité n’existe plus, mais à notre capacité d’« aider les hommes à prendre conscience du malheur général et de leur malheur propre qui en est inséparable ». Faire la fête, s’éclater, comme tout y invite, jouir sans frein, exprimer sans ambages ce qu’on pense n’est pas libération ; c’est enfoncer des portes ouvertes et donner la preuve d’une adaptation réussie à la société telle qu’elle est. Mais prendre conscience des souffrances qu’engendre, recouvre et interdit de dire cette culture de la transparence et de la jouissance sans entraves, voilà un vrai défi pour la littérature. Qui osera écrire le malheur, non le courage, de qui dit tout, qui montre tout, qui avoue tout sous la torture qui consiste à se faire pénétrer devant tout le monde vingt fois en une nuit ? Qui osera en faire le symbole, non de notre libération, mais de notre misère, puisque son malheur, cet homme-là ne le connaît pas, n’en est pas conscient quand il donne ses tripes au public ?
Les psychanalystes nous disent parfois : j’ai un patient qui souffre atrocement et qui ne le sait pas. Comment cet homme-là pourrait-il tout dire s’il ne connaît pas son malheur ? Ce n’est pas un hasard si le nouvel ordre idéologique refoule la psychanalyse, comme la littérature, dans une marge interdite. Comme la littérature, la psychanalyse refuse de jouer le jeu et gâche la fête – elle fait parler au lieu de pousser aux actes. Elle prétend qu’on ne sait presque rien de sa propre vérité, qu’on ne peut dire qu’à peu près son malheur ou son bonheur, et que plus on proclame qu’on dit tout, montre tout, ose tout, plus on se dupe soi-même. On ne pardonne pas à Freud d’avoir découvert qu’il est impossible de montrer ses tripes sincèrement, à moins d’un travail de parole difficile, lent, imp...