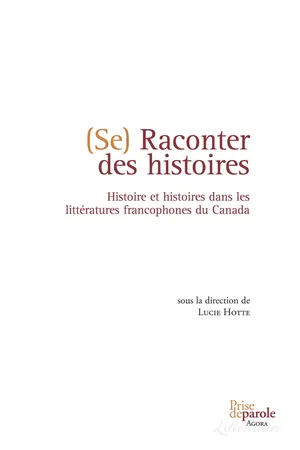LA CHANSON SATIRIQUE, LA LITTÉRATURE ET L’HISTOIRE AU XIXE SIÈCLE :
RÉMI TREMBLAY ET LE CHANSONNIER POLITIQUE DU CANARD (1879)
Jean Levasseur
Université Bishop’s
Dans la généalogie de la grande famille des sciences dites « humaines », Littérature et Histoire sont des sœurs qui se sont longtemps jalousées, sinon ignorées. Pendant que la première n’en faisait et n’en fait encore que mention, de manière souvent anecdotique, la seconde en fait le plus souvent abstraction. Le traitement et l’enseignement de l’histoire n’ont été sensiblement modifiés, au Québec, que lorsque l’école des Annales de Lucien Fevre (France) parvint finalement à faire une percée universitaire, dans les plus belles heures d’ouverture de la Révolution tranquille. Une troisième et une quatrième générations d’historiens universitaires furent alors formées, ouvertes aux possibilités offertes par l’émergence des nouvelles sciences. Les Wallot, Bernard, Roby et Hamelin côtoieront ainsi, et influenceront définitivement quelques années plus tard, une multitude de nouveaux jeunes chercheurs et historiens, tels que Gérard Bouchard, René Hardy, Normand Séguin, Fernand Harvey et Yvan Lamonde, pour n’en nommer que quelques-uns, tous passionnés par les chemins que leur présentait cette nouvelle historiographie ; car l’histoire sociale était désormais à l’honneur et, avec elle, la nécessité d’utiliser des sources nouvelles, différentes et complémentaires. Les dossiers personnels des gouverneurs, évêques et premiers ministres n’étaient désormais plus les seules archives qu’il valait la peine de consulter. Le marxisme et son idéologie sous-jacente, si forte dans les années 1970, jouèrent eux aussi un rôle important dans les préoccupations de ces générations pour les phénomènes sociaux et économiques ayant marqué l’histoire du Québec. Les objets d’étude se multiplièrent : à l’histoire traditionnelle des grands personnages et événements s’ajoutèrent ainsi celles de l’économie, des idéologies, des travailleurs et, bientôt, celles de la femme, de l’urbanité, du syndicalisme, etc. « Je découvrais avec de plus en plus d’acuité, écrira René Durocher en 1984, que l’histoire était une science sociale. C’est ainsi que la revue Recherches sociographiques m’apparaissait bien plus importante que la Revue d’histoire de l’Amérique française et qu’Albert Faucher m’en apprenait plus que Lionel Groulx. »
La littérature comme témoignage de l’Histoire n’a cependant pas encore réussi à faire ce pas. Plus intéressée dans les années 1960 et 1970 par des questions de formes et de structures que par des données de contenu, plus intéressée dans les années 1980 par la psychanalyse que par l’évolution des idées ou des mentalités, et plus intéressée depuis par de vastes et vagues questions de postmodernisme, la littérature, dans son ensemble, a choisi de ne pas monter dans le navire de l’Histoire, et ce, malgré de vaillantes réalisations ponctuelles — l’essai de Robert Major sur l’« art de réussir » de Jean Rivard (PUL, 1991), l’immense travail de Maurice Lemire dans sa tentative de réunir les institutions littéraires, réelles et tangibles, avec l’évolution de la littérature elle-même (L’histoire littéraire au Québec), etc. C’est sans doute en raison de ce manque d’études individuelles que les deux plus récents efforts de mise en perspective de la littérature québécoise (Heinz Weinmann et Roger Chamberland, Littérature québécoise. Des origines à nos jours (Montréal, HMH, 1996), destinée aux cégeps, et Histoire de la littérature québécoise de l’équipe Biron, Dumont et Nardout-Lafarge (Montréal, Boréal, 2007)), malgré leur grande valeur référentielle, demeurent des ouvrages de facture traditionnelle qui présentent une vision de la littérature québécoise foncièrement identique à celle des histoires des décennies précédentes, où les événements extérieurs à l’histoire jouent un rôle on ne peut plus modeste.
Les analyses littéraires brillent encore aujourd’hui, pour reprendre l’expression de Benoît Melançon, par « leur isolationnisme : malgré d’incessants appels à l’interdisciplinarité, il n’y a guère plus insulaire que les études littéraires, enfermées dans leur altière solitude ». En retard sur l’Histoire, la littérature a donc encore comme tâche présente et future d’analyser les cas particuliers pour, éventuellement, dépasser la démarche inductive et en arriver à intégrer cet art dans une perspective historique plus scientifique. À preuve, l’omission généralisée par les historiens des ouvrages de fiction, y compris même ceux rédigés par des personnages politiques. À peine le Charles Guérin du futur premier ministre de la province, P.J.O. Chauveau, obtient-il à l’occasion une note au bas d’une page d’un essai d’historien ; et que dire des Faux brillants, œuvre théâtrale d’un autre premier ministre, Félix-Gabriel Marchand, qui n’est, au bout du compte, jamais mentionnée et encore moins observée, étudiée ou analysée. Pour l’Histoire contemporaine du Québec, la littérature demeure en effet un étrange et anecdotique épiphénomène auquel il ne vaut pas la peine de s’attarder.
Dévastée par un certain courant français des années 1970, valorisée à l’excès par une Amérique en quête de direction, l’étude de la littérature québécoise n’a donc pu encore se départir de l’héritage hermétique des Foucault, Derrida et compagnie, en cela tout le contraire des études en Histoire, beaucoup plus influencées, elles, par des philosophes tel Karl Popper (1902-1994), pour qui « la clarté est une valeur intellectuelle, puisque sans elle la discussion critique est impossible ».
Tant au XVIIIe siècle qu’au XIXe, la poésie dite « de circonstance » est une tradition connue et pratiquée déjà dans plusieurs pays d’Europe et les journaux en font souvent un élément intrinsèque de leurs publications. Elle est considérée par les classes dirigeantes « comme un moyen de contestation redoutable », comme en témoigne l’emprisonnement, en mars 1810, de l’imprimeur du Canadien, Charles Lefrançois, en partie en raison de la publication ponctuelle dans ses pages, depuis 1807, de chansons irrespectueuses de l’autorité britannique et de son représentant, le gouverneur Craig. L’analyse du cas particulier de ce chansonnier de Rémi Tremblay, première et seule expression d’envergure du genre dans le XIXe siècle littéraire canadien-français, se propose comme une tentative de réunion d’une expression à caractère populaire (la chanson satirique) avec l’Histoire, dans un désir commun de tendre vers ce que Popper appelait la « connaissance objective », alors qu’induction et corroboration se rejoignent.
Les origines et la carrière de Rémi Tremblay
Avril 1865. Au terme de la guerre de Sécession, et après avoir échappé à l’attention des gardes de l’armée de l’Union qui le ramenaient à Fort Trumbull (New London, Connecticut) à la suite de sa désertion, le jeune Rémi Tremblay, 17 ans, avait en toute simplicité décidé de reprendre cette même route qui l’avait vu, 18 mois plus tôt, quitter Contrecœur, où il travaillait chez un marchand. Quatre-vingts kilomètres plus au sud, à Rouse’s Point, poste frontière américain, il s’était engagé dans les forces de l’armée du président Lincoln. Douze mois de combats, six mois d’incarcération dans la terrible prison sudiste de Libby, en Virginie occidentale, et, surtout, l’idée de passer les derniers trois ans et demi de son contrat comme simple petit soldat dans un coin tranquille et perdu de l’Amérique l’avaient vite convaincu qu’un retour au pays natal était préférable. Il avait donc retraversé la frontière à Rouse’s Point et était calmement, en marchant, revenu au bercail.
Son passage par Montréal fut alors pour lui l’occasion d’assister au spectacle improvisé d’un curieux troubadour européen, un certain Grosperrin, homme à la verve habile et chaleureuse. Impressionné par sa prestation, il avait même acheté quelques-unes de ses chansons, que l’artiste de foire vendait bon marché sur des feuilles volantes. Plusieurs années plus tard, l’écrivain Louis Fréchette, qui l’aura à son tour rencontré dans les rues du Vieux-Québec, dira de lui :
[…] on le rencontrait partout, dans la rue, sur la place publique, à la porte des églises, à l’embarcadère des bateaux à vapeur en été, aux abords du pont de glace en hiver, chantant à tue-tête ou récitant ses productions, faisant le boniment et distribuant ses brochures et plaquettes à droite et à gauche, moyennant deux, trois, cinq ou dix sous, suivant leur importance.
[…]
Romances de saules pleureurs, refrains bachiques, grivoiseries au gros sel, stances de céladon, satires politiques, philippiques à l’emporte-pièce, il y en avait pour les goûts les plus divers.
Fréchette lui consacra un chapitre entier dans son ouvrage de 1892 Originaux et détraqués, où, signe évident des images originales qu’il avait su lui léguer, il citait de mémoire plusieurs de ses créations. Le troubadour avait également marqué l’imaginaire du jeune Tremblay et son image, claire ou diffuse, joua peut-être un rôle dans la rédactio...