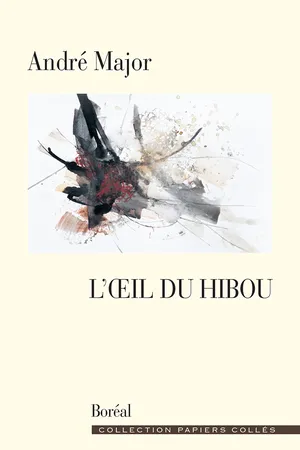![]()
2002
2 janvier – Hier, après avoir préparé un filet de porc à la portugaise, qui doit mariner de huit à douze heures avec de l’ail et des champignons émincés dans du porto, je suis allé patiner au village une heure d’un pas rapide, car il faisait – 25 oC. Guidés par la première pleine lune de l’année, nous avons effectué cette montée en moins de quarante minutes, mais une fois rendus au sommet, nous avons dû subir la forte pression d’un vent dont rien ne freinait l’erre d’aller. Notre jeune compagnon se proposait d’allumer un feu de camp, projet que son hôte et moi avons taillé en pièces. Le visage plâtré par l’air glacial, nous avons entrepris promptement la descente. Il m’a fallu une bonne tasse de chocolat chaud pour me réchauffer un peu, avant de me réfugier sous la couette.
3 janvier – Levé à sept heures, j’ai terminé la lecture de L’Hiver à Lisbonne d’Antonio Muñoz Molina. C’est une histoire d’amour doublée d’une intrigue digne de la « Série noire » : jazz, alcool, fuites et poursuites, le tout baignant dans l’atmosphère poétique d’une Lisbonne dont le narrateur dit qu’elle est « la seule patrie de ceux qui naissent étrangers ». Au cœur de cette intrigue à la fois troublante et captivante, il y a un tableau de Cézanne pour lequel de curieux personnages ne cessent de se démener. Comme toujours chez Molina, le récit est bien construit et truffé d’observations justes, mais surtout habité et porté par des personnages auxquels on finit par croire autant qu’à soi-même. Il y a là, en sourdine mais bien présent, un désespoir dont on devine qu’il n’aura pas nécessairement le dernier mot, ce qui contribue au charme subtil d’une histoire illuminée par « la lumière ocre et rose des après-midis de Lisbonne ».
Lire et revenir à ce carnet, cela me manquait depuis plusieurs jours. Après avoir fêté Noël comme il se doit, nous avons passé quatre jours à peindre l’appartement où J. vient d’emménager, à cinq minutes de chez nous. À force de respirer poussière et émanations de peinture, G. a souffert d’une rhinite allergique dont elle se remet peu à peu. La vie reprend un cours plus lent depuis que nous sommes à La Minerve, comme si nous avions trouvé refuge sur une île déserte.
La plupart des gens qu’on appelle ordinaires, il ne vous déplaît pas de les croiser, mais les écouter devient une véritable torture parce qu’une fois qu’ils vous ont donné de leurs nouvelles, souvent avec force détails, ils ne vous quittent pas pour autant. Ils n’ont plus grand-chose à dire, mais ils le disent quand même. Vous ne savez qu’inventer pour vous défiler sans demander votre reste. Encore une fois vous avez compris que vous n’étiez pour eux qu’une bonne paire d’oreilles. À la ville comme à la campagne, impossible de les éviter, le hasard les envoie à votre rencontre une fois sur deux comme pour mettre votre sociabilité à l’épreuve. Tout ce temps perdu, c’est une aumône que vous faites à contrecœur.
Une longue pratique de l’écriture tend à prendre la forme d’une conversation à bâtons rompus avec le lecteur, même si ce dernier risque de n’être qu’un des doubles de l’auteur.
Je ne sais trop comment cela m’est revenu à l’esprit, mais en me promenant tout à l’heure, je me suis rappelé le jour où j’ai avoué à un camarade ma désaffection religieuse. Après un moment de réflexion, persuadé de ne pouvoir me convaincre de mon erreur, il m’avait simplement déclaré qu’il prierait pour mon salut, à quoi j’avais répliqué : « Surtout pas ! Je me sens si léger, si libre, depuis que j’ai apostasié. » Mais je voyais bien qu’il croyait au pouvoir miraculeux de sa propre foi et qu’il m’imaginait déjà paissant avec le troupeau dont il espérait bien devenir l’un des pasteurs.
6 janvier – Quatre mois après sa parution, mon Sourire d’Anton a droit à des commentaires plutôt positifs dans le magazine Voir et dans La Presse où Réginald Martel lui accorde trois étoiles et demie sur cinq, ce qui le classe, si j’ai bien compris, entre bon et très bon. J’aurais préféré – on peut le deviner – quatre belles étoiles. Mais enfin, je lui suis reconnaissant de me donner raison en ce qui concerne cet étrange objet qu’est le Robert québécois contre Bruno Roy à qui, d’ailleurs, je viens d’envoyer une longue réponse à la leçon de morale qu’il prétend me servir. J’ai conclu mon épître en lui disant, un peu malicieusement, qu’il semblait ne pas s’adresser seulement à moi mais à d’éventuels tiers en se prenant pour un de ces maîtres dont j’ai appris à me passer. J’ai tenté de corriger les curieuses interprétations auxquelles il se livre à mon sujet, notamment quand il me reproche ma prédilection pour Tchékhov, comme si rien ne pouvait me justifier de le préférer à Anne Hébert ou comme si une telle prédilection témoignait d’un manque inadmissible de ferveur patriotique.
Par la force de la parole, prendre place au cœur du monde – une place qui ne vous a pas été réservée – pour y jouer un rôle qu’on ne vous a pas attribué.
Une phrase de Philippe Muray, tirée de son essai sur Céline, publié en 1981 : « La disparition des oppresseurs révèle l’homme comme incurable oppresseur de lui-même. » Et cette autre affirmation qui préfigure l’écrivain qu’il deviendra : « Plus il y a du monde et moins il y a quelqu’un. »
Feuilletant, comme j’aime tant le faire, les livres qui font partie de la trame de mon existence, je tombe sur le début du cinquième chapitre de Missa sine nomine, roman d’Ernst Wiechert dont je m’étais entretenu avec André Belleau, quand il habitait encore dans mon quartier et que nous avions de longues conversations sur la littérature. J’avais marqué d’un trait de plume le passage qui suit : « L’hiver est la saison des solitaires. Chez les hommes et chez les loups. Chez ceux qui vivent à la limite. Il voile la vie que l’on parcourt et dévoile celle vers laquelle on doit lever son regard… Ce n’est pas la saison des bêtes et des fleurs, c’est celle des étoiles. La neige ne sort pas de terre, elle tombe des étoiles, froide et pure comme elles. » Cela, qui m’avait déjà paru si bien convenir à notre hiver, je l’éprouve moins en ce début d’hiver gris et privé de neige. Sauf dans les Hautes-Laurentides, quand je gravis le sentier qui aboutit à ce plateau d’où, par ciel clair, on peut contempler le vaste panorama que domine la haute cime du mont Tremblant, car là-haut il y a assez de neige et d’ouverture sur la voûte céleste pour que je retrouve ce qu’évoque Wiechert. Il reste toujours quelque chose à quoi s’accrocher : un paysage qui vous enchante ou le souvenir d’un tel paysage, ou encore un plat qu’on rêve de cuisiner et dont la recette nous fait déjà saliver.
C’est après avoir relu l’incipit de Missa sine nomine que je me suis laissé reprendre par le récit de Wiechert. Je ne sais si d’autres lecteurs seraient aussi sensibles que moi à ces premiers mots : « C’était donc de ce pas qu’on allait, quand la mort vous avait touché entre les deux épaules. D’un pas léger, comme si l’on avait des ailes, mais, sous terre, quelque chose accompagnait nos pas et ce n’était ni léger ni ailé : c’était noir et pesant comme le suc du pavot. Mais que savait-il des vertus du pavot, cet homme qui marchait dans la nuit ? » Et me voilà marchant du même pas que cet homme, que je suis prêt à suivre jusqu’au bout de sa nuit.
« L’imagination comble les vides de la vie » comme le dit Constantin Paoustovski dans La Rose d’or (notes sur l’art d’écrire).
Les yeux fermés, je vois défiler les idées que je croyais miennes et qui ne sont que des idées courantes, finalement ; je les chasse de mon esprit sans ménagement. Une sorte d’indulgence me vient alors à l’égard de ceux qui débitent leurs idées pas plus neuves ni meilleures que les miennes – indulgence que je n’arrive pas à éprouver pour moi-même autant que je le souhaiterais.
13 janvier – On n’écrit pas pour soi ni pour les autres, mais pour ouvrir dans la grisaille une éclaircie où un peu de beauté – j’oserais même dire un peu de vérité – apparaîtrait comme une fleur dans la fissure du béton. Pour Elias Canetti, « on écrit, faute de pouvoir se parler à voix haute ». Il ajoute aussitôt que « parler aux autres conduit aux pires amertumes ». On écrit probablement parce qu’on arrive rarement à parler sans bredouiller et à partager avec autrui ce qui nous tient le plus à cœur.
« À quel endroit n’étoufferais-tu pas ? Pourquoi te chercher partout des racines ? Elles sont toutes si affreusement semblables. » C’est l’exilé désenchanté qui parle ainsi. Né au sein d’une famille juive qui avait fui l’Espagne pour trouver refuge dans une Bulgarie encore soumise à l’Empire ottoman, Elias Canetti rêvait d’apprendre l’allemand que parlaient ses parents entre eux. Au cours des années qu’ils passeront en Suisse, sa mère, devenue veuve, l’aidera à faire de cette langue sa seconde langue maternelle. Après avoir élu domicile à Vienne que l’Anschluss l’oblige à fuir, il séjourne à Paris, puis en Angleterre où il obtient la nationalité britannique, sans renoncer à la nationalité turque. C’est en allemand qu’il écrira un unique roman, Auto-da-fé, et Masse et Puissance, essai qui aura un retentissement durable, sans oublier des pièces de théâtre, des récits autobiographiques et des carnets où sa pensée trouve sa tonalité la plus personnelle. Quand il meurt à Zurich, en 1994, on l’enterre tout près de James Joyce. Après le Nobel, il ne pouvait sans doute rien espérer de mieux.
Le bonheur, c’est parfois le délicieux abandon à la rêverie – ou la douceur d’une main qui se pose sur votre nuque.
Canetti raconte qu’une nuit, ressentant une humiliation extrême, il voulut mourir et qu’il ouvrit Le Métier de vivre, le fameux journal de Cesare Pavese, lecture qui l’amena à conclure : « Il s’est tué pour moi […], par sa mort, il m’a fait aujourd’hui renaître. » Si l’on pouvait être utile à quelqu’un, ne serait-ce que comme garde-fou, on ne se verrait plus comme le vain personnage qu’on croit être trop souvent.
Plus loin, revenant sur sa découverte de Pavese, il dit se réjouir d’avoir en lui un « nouveau frère », mais qu’il « ne faudrait pas que cela se produise trop souvent », car on « n’apprend que de ceux qui sont complètement différents de soi », ajoutant : « La parenté vous assoupit. »
L’auteur de carnets tend à convertir l’expérience personnelle en généralité pour échapper au piège d’une certaine complaisance, tout comme il tient à rappeler le caractère subjectif des remarques d’ordre général qu’il lui arrive de faire. L’important n’est pas tant de témoigner fidèlement de celui qu’on est que de maintenir vivant le rapport entre soi et le monde – de bien faire voir et sentir ce qu’on a vu, lu ou vécu. Autrement dit, d’écrire avec justesse – cette justesse qui assure le bien-fondé de l’écriture. Quoi qu’il en soit, le carnet ne saurait être seulement un refuge. Il ne s’agit pas de sauver sa peau aux yeux du lecteur, mais de risquer de perdre la face en assumant le mauvais rôle autant que le bon dans la petite comédie humaine au sein de laquelle on se débat, comme tout un chacun, avec les moyens du bord.
Mon reniement – ou mon apostasie, si l’on préfère –, je pourrais l’attribuer à des événements précis autant qu’à mon caractère, mais chose certaine, la perte de mon innocence remonte à ma douzième année, lorsqu’un prêtre, croisé au parc La Fontaine une après-midi de juin, m’a emprisonné la main sous sa soutane pour que je le masturbe, après quoi, faisant le signe de la croix, il avait prétendu m’accorder l’absolution pour une faute dont il était pourtant l’instigateur. Tout au long de mes études collégiales, impressionné par les prêches enflammés de nos prédicateurs, j’ai eu beau me sentir coupable de ce péché sûrement mortel commis malgré moi, je n’arrivais pas à m’en confesser, sans compter qu’il s’aggravait chaque fois que je me rendais coupable d’une communion sacrilège. Personne, de nos jours, ne peut comprendre que j’aie été plongé dans ce marasme jusqu’au jour où j’ai pris la décision de rompre avec notre sainte Mère l’Église, ses œuvres et ses pompes. Ses représentants pouvaient exercer leur magistère, je n’aurais de cesse de m’en éloigner et d’en dénoncer la nocivité, quel qu’en soit le prix à payer. Expulsé du collège et empêché de poursuivre mes études collégiales, j’ai nourri l’ambition de devenir pour cette Église indigne un ennemi intraitable. Quant au Dieu dont elle prétendait être la fidèle servante, je Le lui laissais sans le moindre regret. S’il m’est arrivé à quelques reprises de rouvrir ce dossier, en essayant de faire la part des choses, ç’a été pour conclure que mon reniement d’adolescent demeurait l’acte le plus libérateur de toute mon existence. Plus tard, j’ai dû m’affranchir d’autres croyances, avec le même sentiment grisant de me purger l’esprit. C’est en écrivant que cela m’est apparu comme une nécessaire dévastation au moyen de laquelle je m’approcherais, en fin de compte, de ce qui devait être la vérité de l’existence, tragique et banale tout à la fois, puisque l’ombre de la mort plane au-dessus de toutes nos entreprises. Le scepticisme radical auquel j’ai adhéré ne m’a cependant pas durci le cœur, la bonté foncière héritée de mes ascendants paternels et maternels ayant résisté à la dévastation que je viens d’évoquer – grâce à quoi je demeure sensible au malheur de mes semblables, bien que je ne me jette plus dans la mêlée et que je ne me sente obligé qu’à l’égard de mes proches.
Ne plus lire, ce serait vivre à l’étroit, dans une chambre close, en ruminant des pensées complaisantes et, par conséquent, stériles.
La peur de l’autre aboutit parfois à la haine de l’autre sexe, d’une autre race, de n’importe quelle forme de différence. Pour qui ne peut s’épanouir que dans une relation harmonieuse avec autrui, le fanatique est un personnage énigmatique, qu’il ne lui est possible de comprendre qu’en plongeant profondément en lui-même, là où gisent les cendres d’une ...