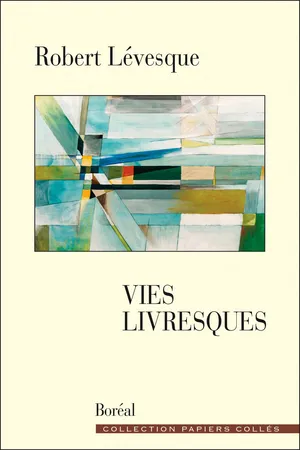La rousse
Qui est donc ce libraire qui enleva une serveuse rousse ? Apollinaire ne l’a pas dit, nous ne le saurons jamais. La kidnappée à la chevelure couleur queue de vache et son libraire ravisseur (se connaissaient-ils, allaient-ils s’enfuir, s’aimer ?) demeurent – à l’instar de l’Inconnue de la Seine et le soldat inhumé sous la place de l’Étoile – les personnages anonymes d’un étrange poème, « Lundi rue Christine », qu’on trouve dans Calligrammes, ce délice textuel sorti des presses du Mercure de France en 1918, six mois après la mort de son émerveillant auteur (c’est Blaise Cendrars qui en avait corrigé les épreuves assez casse-tête ; Cendrars qui arriva en retard au Père-Lachaise au moment où, les amis de Guillaume repartis, des marchands à la sauvette ramassaient déjà les fleurs qu’ils allaient vendre aux amoureux sur les boulevards…).
On pourrait déduire – si ce rapt de rousse par un vendeur de bouquins nous intéresse (était-ce le premier de l’histoire du monde ? le seul de la profession ?), même si une enquête sur l’affaire ancienne ne mènerait à rien – qu’il s’agissait sans doute d’un libraire germanopratin, puisque ce poème de la section « Ondes » des fameux Calligrammes serait, selon son auteur, entièrement fait de bouts de phrases entendues, brèves de comptoirs, paroles attrapées au vol – « Louise a oublié sa fourrure » ; « ces crêpes étaient exquises » ; « Écoute, Jacques, c’est très sérieux ce que je vais te dire » ; « la bague en malachite » ; « Mais, nom de Dieu, où est-ce ? » ; « La quinte major » – que transcrivit le poète d’Alcools un lundi (sans doute d’hiver, vu la fourrure oubliée par Louise) dans un café bondé de cette rue Christine si courte et coincée depuis des siècles entre la rue Dauphine et celle des Grands-Augustins, dans ce territoire qui, sur la gauche des deux rives, contenant son lot de librairies en tous genres (« le long des librairies qui se mettent en boule », écrit le piéton Léon-Paul Fargue dans les années 1930), sera, trois décennies plus tard, et pour six lustres, le champ de manœuvre où s’esquintera monsieur Delacomptée avec son cahier à spirale, ses semelles de caoutchouc et ses vaches.
On pourrait croire – j’ai le goût de clore par une hypothèse ce fait divers d’avant les années folles – que c’est Apollinaire lui-même qui a fait le coup, lui le baraqué, l’armoire à glace qui trompait sans souci la froide Marie Laurencin, le joyeux trépané à la tête bandée, l’homme au crâne ceint d’une protection de cuir qu’il appelait son appareil téléphonique ; celui à propos de qui, « lorsqu’on le regardait », écrit Soupault dans Profils perdus, « on se demandait toujours à qui l’on avait affaire » ; ce serait lui qui aurait enlevé la serveuse rousse, glissant l’exploit comme si de rien n’était dans son supposé verbatim de bistro ; la clé de l’énigme se trouve (pourquoi pas, d’ailleurs) dans le poème qui clôt ces Calligrammes, intitulé justement « La Jolie Rousse », son testament, ont pensé plusieurs de ses amis dont son pote Francis Carco, un adieu au monde humblement signifié par ce « ayez pitié de moi » final, implorant excipit, les quatre derniers mots clouant le cercueil après ceux-ci qui nous y menaient : « elle vient et m’attire ainsi qu’un fer l’aimant, elle a l’aspect charmant d’une adorable rousse, ses cheveux sont d’or on dirait un bel éclair qui durerait ou ces flammes qui se pavanent dans les roses-thé qui se fanent, mais riez de moi, hommes de partout et surtout gens d’ici, car il y a tant de choses que je n’ose vous dire, tant de choses que vous ne me laisseriez pas dire ».
Si ce n’était lui, Apollinaire, gros minet grand fureteur de librairies indépendantes et de bibliothèques particulières, ce ne serait certainement pas M. Lehec qui aurait fait le coup du rapt d’une rouquine rue Christine. M. Lehec, ce libraire « à l’érudition obligeante », selon ce qu’en disait le poète du Guetteur mélancolique, aimait les livres (plus que les femmes) au point de refuser de les vendre à n’importe qui, repoussant le client qu’il ne pifait pas, dont il ne sentait pas le désir – disciple en cela du perspicace et antique ironiste Lucien de Samosate qui, dans sa virulente diatribe Contre un bibliomane ignorant, lancée au iie siècle de notre ère, fustigeait « les acheteurs de livres incapables de les comprendre et de les juger », ajoutant que – pas trop gentil pour les premiers gars du métier – « la possession de livres ne rend pas cultivé, comme le montre l’exemple des marchands de livres ».
Apollinaire l’aimait bien, cet homme de livres, ce M. Lehec, et il allait parfois causer avec lui (de la république des lettres, ses hauts et ses dessous) dans sa boutique sise au 37 de la rue Saint-André-des-Arts. Gustave Lehec était un brave homme, selon le portrait qu’en esquisse Apollinaire dans Le Flâneur des deux rives. Depuis 1878, il était non pas en affaires mais en intelligence avec une clientèle lentement devenue amie, sûrement apprivoisée, un lectorat de choix qui comptait entre autres – ce sont du moins ceux que nomme Apollinaire dans son texte – Victorien Sardou, l’auteur dramatique très béret de velours et foulard blanc qui écrivait du prêt-à-scander pour Sarah Bernhardt, et Anatole France qui, arrivé parfois en fiacre, pouvait rester une heure si M. Lehec voulait bien lui offrir une chaise, habitude de confort au milieu des livres prise au magasin de son père, François-Noël Thibault, dit Noël France, qui avait été au siècle précédent libraire au 19, quai Malaquais, puis au 9, quai Voltaire (après avoir débuté dans le métier en 1840, à trente-cinq ans, au 6 de la rue de l’Oratoire-du-Louvre).
Noël France, le père de l’auteur des Poèmes dorés, des Noces corinthiennes et du Chat maigre, vécut dans la déception aigrie que son fils ait refusé de suivre ses traces de marchand de littérature et de prendre la succession de la librairie France (les frères Goncourt dans leur Journal l’appelaient « une librairie à chaises », car l’on pouvait y causer, feuilleter des livres sans obligation d’achat) pour se livrer plutôt à ce qu’il qualifiait de « barbouillages »… Certainement l’avait déçu ou choqué cette Légende de sainte Radegonde écrite à quinze ans par le précoce Anatole (je pense au père de Giacomo Leopardi qui qualifiait d’inepties les Canti et détestait les Operette morali de son fils…, erreur de vue paternelle plus grave s’agissant du génial poète de la mélancolie).
Mort désappointé en 1890 (d’autant plus qu’en 1867 son fils Anatole, après avoir travaillé un temps avec Leconte de Lisle à la bibliothèque du Sénat, avait eu le culot de prendre du service chez l’éditeur-libraire Lemerre au passage Choiseul, haut lieu des Parnassiens), Noël France n’aura pas su que son gribouilleur de fils ingrat se ferait une place imposante dans le monde des lettres françaises, qu’il serait admiré jusqu’à Londres, qu’il deviendrait pour quelques générations de schnoques un esprit, une conscience morale de la France (conseillant entre autres à ses contemporains de « craindre les femmes et les livres, pour la mollesse et l’orgueil qu’on y prend »), et puis – ce qui n’est pas rien – qu’il serait l’un des modèles de Bergotte, le romancier (« un des maîtres de la plume ») qui meurt affaissé sur un canapé circulaire alors qu’il est en admiration devant le petit pan de mur jaune avec auvent, ce détail lumineux de la Vue de Delft de Vermeer, page célèbre de La Prisonnière où Proust transpose et dramatise le malaise qu’il éprouva lui-même en 1921 au Jeu de paume, enfin que le fameux fils France obtiendrait le prix Nobel de littérature en 1921 et qu’il aurait droit en 1924 – comme Hugo, mais avec tellement moins de monde – à des funérailles nationales (Paul Morand, qui y était, écrit dans sa « Lettre de Paris » de février 1925 publiée dans un journal de Chicago, The Dial : « Rares étaient les hommes de lettres. Sur les bords de la Seine qu’il avait tant aimés, au pied de la statue de Voltaire, entourée, comme son œuvre, par les bouquinistes, Anatole France reçut un hommage solennel. » Dans sa lettre suivante, en mai, il dit son plaisir d’avoir lu le petit ouvrage d’un ancien secrétaire de l’illustre enterré, monsieur Brousson, qui le dépeint en « véritable père Ubu de la littérature »). Qui plus est – superbement blasphématoire rançon de la gloire, éclaboussant pavé dans la mare –, qu’il serait, son fils ingrat, l’objet d’un pamphlet imprimé au 288, rue de Vaugirard (l’adresse circonstancielle de l’Imprimerie spéciale dite du Cadavre) et placardé dans tout le Quartier latin, titré Un cadavre, où de jeunes plumes vives du mouvement surréaliste, Breton, Aragon, Drieu la Rochelle, Éluard, Soupault, Joseph Delteil, demanderaient, en suggérant évidemment de passer à l’acte : « Avez-vous déjà giflé un mort ? »
Déjà, sept ans avant que l’auteur du vite fait, bien vendu et lourdingue Les dieux ont soif ne meure, Fernando Pessoa, à Lisbonne, dissimulé derrière son fougueux hétéronyme, l’ingénieur Álvaro de Campos, écrivait dans Ultimatum l’un des articles du seul numéro de la revue Portugal Futurista saisi par la police lisboète en novembre 1917 (trésor bibliophilique sans prix) : « Dehors Anatole France ! Épicure de pharmacopée homéopathique, Jaurès-ténia de l’Ancien Régime, Salade Renan-Flaubert servie dans de la vaisselle imitation du dix-septième ! » Dans ce manifeste confisqué par les flics de l’époque pré-Salazar, il y avait un poème d’Apollinaire, « Arbre », tiré des Calligrammes, où l’un des vers était « tous les dieux terrestres vieillissent ».
Le cher lecteur vicieux impuni Valery Larbaud, dans l’une de ses « Lettres de Paris » publiées dans le New Weekly mais qu’il écrivait sur place à Londres, directement en anglais, s’étonnait poliment que « le plus célèbre survivant de tout ce groupe de romanciers qui produisirent la majeure partie de leur œuvre durant les vingt dernières années du xixe siècle puisse passer effectivement encore chez les Anglais qui le lisent pour incarner la finesse et l’esprit français ». Dans sa lettre du 18 avril 1914, il disait du dernier France paru, Les Anges, où des rebelles descendus des cieux tentent de détourner les hommes de la religion catholique, qu’« avec ses réminiscences de Milton et de Lucrèce, il a l’air d’un devoir de bon élève ». Il ajoutait : « Où est la finesse française de notre Anatole France dans cette révolte des Anges ? Ici et là, une boutade médiocre, ou même une grivoiserie ; mais où trouverons-nous un véritable trait d’esprit ? »
Moins polis, les surréalistes, eux, concluaient ainsi leur affront au cadavre de l’illustre Anatole France : « il ne faut plus que mort cet homme fasse de la poussière ».
Au début des années 1960 du siècle dernier (années Temps modernes et Tel Quel, sartriens et Hussards, Nouveau Roman et Nouvelle Vague), un Italien de vingt ans grimpe les cinq étages du vieil immeuble des éditions Julliard, rue de l’Université, pour – à bout de souffle – interroger Maurice Nadeau sur l’état du roman dans la littérature française ; Nadeau, quinquagénaire en veste de cuir, dirige alors dans un réduit mansardé les Lettres nouvelles et il dira d’emblée au jeune homme que le roman conventionnel – lui qui n’a raté que Beckett, comme Gide rata Proust – est « fini, fini ». Nadeau vient de relire pour une anthologie les livres qui étaient très en vogue quarante ou cinquante ans plus tôt, il lâche : « La seule qui s’en tire, c’est encore Colette : mais Pierre Loti et Anatole France ne disent vraiment plus rien. Aujourd’hui, personne ne serait disposé à les publier. » Ce jeune homme, Alberto Arbasino, note, puis, quand il se retrouve devant Jean Cayrol qu’il est allé rejoindre au Seuil « dans une minuscule piécette, tout en haut d’un étroit escalier pour individus maigres se déplaçant de profil », il l’entend lui dire que « nous sommes présentement au creux de la vague ». Arbasino redescend l’étroit escalier du Seuil et file aux éditions de Minuit rue Bernard-Palissy. Il grimpe, et là aussi « tout le monde doit faire attention à bien poser le pied sur les petites marches de l’escalier où ne passe qu’une toute petite personne à la fois, et en rentrant le ventre, et à ne pas pénétrer à trois là où l’on ne tient pas à plus de deux ; mais enfin nous voici pelotonné sur un petit lit de camp, dans un étroit débarras, bas de plafond et aveugle, qui sert de bureau à Robbe-Grillet, à converser dans l’obscurité avec l’auteur moustachu des Gommes, plutôt haletant car il vient tout juste de glisser le long de la rampe ». Le théoricien du Nouveau Roman lui confie que « celui qui refuse les normes, posées par d’autres avant lui, il est probable qu’il soit un bon écrivain, mais il n’est pas dit qu’il l’est, naturellement ».
Arbasino rentre en Italie avec ses carnets, où il deviendra romancier, puis député. Lire aujourd’hui ses carnets d’hier, réunis dans Paris, ô Paris, une série de textes alertes, vifs et drôles, écrits dans sa jeunesse mais publiés seulement quatre décennies plus tard à Milan, traduits en 1997 au « Promeneur », la collection que dirige Patrick Mauriès chez Gallimard, c’est l’équivalent de prendre une douche puis un bain de vapeur avec des monstres sacrés qu’il fouette et essore, Cocteau, Mauriac, Jouhandeau, Julien Green, et avec ces hommes d’édition qui bossaient haut perchés dans de tout petits ...