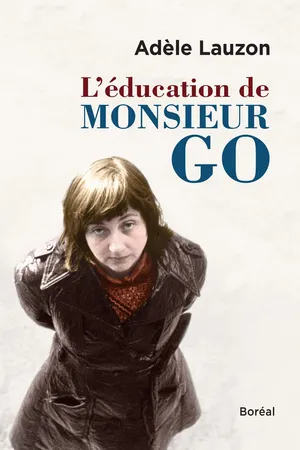chapitre 1
L’éducation d’une journaliste
L ongtemps, je me suis connu un refus total de vivre passé cinquante ans. Peu importe la façon dont je périrais – dans une guerre, dans un accident, avec le cancer –, je ne voulais pas vivre passé l’âge de cinquante ans. J’avais le culte de la jeunesse et l’horreur de la vieillesse. Même la perspective de prendre une retraite quelconque me répugnait.
Toutefois, le destin me fut clément en trompant mes souhaits un peu morbides. À cinquante ans, ce ne fut pas la mort que je rencontrai mais quelque chose d’aussi radical et de moins permanent : une crise psychotique, accompagnée d’un diagnostic de bipolarité. Cette crise mit fin à la première partie de ma vie et me fit amorcer une nouvelle étape qui me permit d’accéder largement à la guérison.
Ensuite, il y a eu des histoires d’amour. Là, j’ai pensé que je pourrais me rendre jusqu’à cinquante-cinq ans. Ma dernière histoire d’amour m’a menée à soixante-cinq ans. C’est alors que j’ai commencé à changer d’idée sur la vie en général, donc sur la vieillesse. De sorte qu’aujourd’hui, à quatre-vingt-six ans, je n’ai jamais si peu craint la mort, en même temps que je n’ai jamais autant aimé la vie.
Depuis quelques années, grâce à un petit héritage de mon père, je mène une vie paisible à lire, à écrire et à voir des amis. Un soir par semaine, généralement le jeudi, je rencontre un groupe de retraités, dont la plupart sont des chimistes, allez savoir pourquoi. Ces rencontres durent depuis très longtemps.
J’écris, je lis. Je ne sors qu’accompagnée, mais je ne refuse jamais une invitation. Grâce à Internet, je retrouve d’anciens amis dispersés aux quatre coins du monde. Quelques-uns viennent même me rendre visite à Montréal. L’actualité politique, qui désespère tant de gens, me donne au contraire l’envie de reprendre la plume et de me battre. Bref, jamais je n’ai connu une telle sérénité, un tel plaisir de vivre.
Donc, je suis d’une certaine manière « guérie » grâce aux médicaments efficaces qu’on me prescrit depuis quelques années. Et la mémoire des années passées à être vraiment malade me permet peut-être de mieux apprécier mon état actuel. Et il y a eu la rencontre avec ce chat extraordinaire, dont je vous reparlerai au moment où il apparaîtra dans cette histoire.
Il m’a paru important de me mettre à l’écriture de ce livre strictement personnel – sans aucune prétention médicale – en faisant le récit de ce point tournant de ma vie et du cheminement vers une existence plus heureuse. J’espère que mon récit servira à ce que se reconnaissent ceux qui ont connu la dépression. Je l’ai aussi écrit pour que les gens en bonne santé mentale apprennent de quelle sorte de douleur il est question.
Je suis revenue en arrière, laissant se dévider l’écheveau de mes souvenirs, pour décrire de mon mieux ce que peut ressentir ou vivre une maniaco-dépressive. Avant la psychose, je n’avais jamais été diagnostiquée comme bipolaire ; je ne pouvais ni comprendre et encore moins soigner ces gigantesques montagnes russes. La maladie a considérablement nui à ma carrière à cause de ces périodes de temps plus ou moins longues pendant lesquelles elle m’arrachait brutalement à mon travail, ce qui non seulement me faisait perdre de l’argent mais m’affublait aussi d’une fâcheuse réputation d’instabilité.
Je ne sais pas si ma maladie est d’origine familiale, mais je suis le seul membre de ma famille, avec une sœur de ma mère, à avoir été affligée de dépression. D’ailleurs, tante Gilberte a connu des attaques plus aiguës que les miennes. Ainsi, elle a fait deux tentatives de suicide dans le fleuve à Verdun ; elle est morte à l’hôpital psychiatrique Louis-H.-Lafontaine, où elle séjournait depuis longtemps.
Au début, la maladie de Gilberte ne s’est pas manifestée d’une façon si dramatique ; ma chère tante était tout bonnement curieuse, voire audacieuse. Par exemple, elle qui était simple caissière dans une banque et qui vivait dans un très modeste trois pièces avec sa mère et sa sœur apprenait le chant, jouait du piano, s’était mise à l’allemand et avait entrepris un jour de se rendre en cargo, seule femme en compagnie de l’équipage, visiter son frère. Celui-ci vivait dans un campement rustique qui avec les années allait devenir Baie-Comeau. Il était secrétaire du président de la Quebec North Shore, qui exploitait la forêt de la région pour alimenter ses usines à papier de Chicago. Le côté dépressif et le goût des entreprises dangereuses s’installèrent peu à peu chez ma tante. À la suite d’un épisode aigu, elle fut hospitalisée au Allan Memorial à Montréal, d’où elle s’évada par une froide nuit d’hiver. On la retrouva, encore vêtue de sa robe de nuit, dans un tramway au centre-ville.
L’autre sœur de ma mère, Marie-Jeanne, qu’on appelait Jean (Djean, à l’anglaise), avait dans sa jeunesse mené une vie peu conformiste et mis au monde un enfant qu’elle avait dû placer en adoption. Ce fut un tel scandale qu’on ne me mit au courant que longtemps après sa mort, même si elle était ma marraine et que j’avais été moi-même enceinte avant mon mariage.
Jean était une femme très élégante, coiffée et habillée à la mode du jour, qui avait trouvé un minimum de liberté en occupant une chambre seule dans leur étroit et pauvre logement, alors que ma tante Gilberte, celle qui devint malade mentale, ne put jamais s’offrir ce luxe : elle couchait avec sa mère dans un minuscule lit double, dans une chambre minable. Je ne connus à Jean qu’un seul amoureux, un policier qu’on lui permettait de recevoir uniquement dans la cuisine et en compagnie de membres de la famille. Monsieur Dansereau, un personnage costaud, était gentil, et je me souviens qu’il me laissait jouer avec son énorme revolver, qui n’était bien sûr pas chargé. Cette arme impressionnante me fascinait. Il n’y avait pas de télévision à l’époque, de sorte que je ne comprenais pas son pouvoir mortel. Pour moi, c’était tout simplement un gros jouet.
Jean s’était liée d’amitié chez Bell Telephone avec une compagne de travail mariée à un riche homme d’affaires. Grâce à ma tante, il nous arrivait d’être invitées chez les sœurs Halleday à Hampstead, riche banlieue de Montréal, et de déjeuner dans leur magnifique jardin ou dans leur spacieuse salle à manger. Je me demande encore comment il se fait que nous étions tous bilingues dans notre famille. Probablement un mélange d’origines irlandaises et de la nécessité de se débrouiller en anglais dans le Québec de cette époque.
Ma mère s’entendait bien avec sa famille mais elle menait avec mon père une vie beaucoup plus confortable. Elle avait été institutrice dès l’âge de dix-sept ans, jusqu’à son mariage à vingt-trois ans. Mon père l’encouragea à faire des études de médecine, ce qu’elle avait toujours souhaité, mais elle refusa la généreuse offre de son mari (rare pour l’époque) parce qu’elle estimait que son rôle dans la vie était d’être épouse et mère à plein temps. Toutefois, elle me poussa toujours, moi sa fille, à faire des études et à me préparer pour une carrière, comme ma cousine Lucette qui était médecin. D’ailleurs, mon père eut la même attitude à mon égard, sans que je m’y oppose, bien sûr.
Ma grand-mère était l’intellectuelle de la famille. Elle dévorait les livres de Garneau et de Rumilly en plusieurs volumes sur l’histoire du Québec et du Canada que nous lui offrions toujours, un à un, à son anniversaire ou à Noël. S’intéressant beaucoup à la politique, elle était une fervente libérale. Je me souviens qu’elle était une admiratrice de Sir Wilfrid Laurier.
Il n’y avait qu’un seul homme dans cette famille, mon oncle Henri Ryan, qui, après avoir quitté femme et enfants (dont Claude, qui devint un chef politique respecté, et son frère Yves, qui fut longtemps maire de Montréal-Nord), s’était réfugié à Baie-Comeau. Paula, ma mère, était assez proche de sa famille du boulevard Décarie. Et mon frère, Mario, et moi arrêtions souvent chez notre grand-mère en revenant de l’école.
Nous fréquentions très peu la famille de mon père. En fait, nous la visitions à Ville-Émard une fois par année dans le temps de Noël. Je me souviens de ma grand-mère paternelle, qui était affligée d’une forte claudication, séquelle de l’accouchement de mon père, le dernier de ses neuf enfants. L’un de ces nombreux rejetons était mon parrain, le conducteur de tramway. Je me rappelle que j’étais très fière de lui et lui vouais une grande affection. Un autre membre de cette smala était marchand de meubles à Berthier. Je me souviens qu’il était chauve et portait des lunettes. Mon oncle Omer était très grand et maigre, et aussi longtemps que je l’ai connu il a été chômeur, de même que mon oncle Sylvio, qu’on appelait Yo. Il était petit et extrêmement drôle et fumait toujours la pipe.
Mon père avait le cheveu rare et le pas vif. Il traînait toujours sur lui de gros paquets de billets de banque qu’il sortait souvent de ses poches. Bizarre façon de se rassurer. Il quittait la maison – même le dimanche – vers neuf heures le matin et rentrait le soir à onze heures. Il était propriétaire de son garage et de sa maison de campagne, mais nous avons toujours été locataires de nos lieux d’habitation urbains.
Je n’ai connu que deux des trois sœurs de mon père, la troisième étant décédée dans son enfance. L’une d’elles avait un emploi mais je ne me souviens pas où. L’autre tenait maison à cause de l’infirmité de ma grand-mère. Elle était courtisée, toujours à la maison, par un homme rondouillard portant lunettes qu’on appelait « mon oncle Bébé ». Il était toujours là, assis dans la cuisine. Mais après la mort de ma grand-mère, la famille se dispersa.
Ma tante Yvonne et mon oncle Bébé – après des années de fréquentations platoniques – se sont mariés et installés sur une ferme où ils ont fait de l’élevage. Je me souviens fort bien qu’ils avaient un important troupeau de cochons, que je nourrissais aux petites pommes vertes. Les porcs couraient à toute vitesse pour s’empiffrer. Ils faisaient mon bonheur chaque fois que nous leur rendions visite, surtout l’été.
On était fort sur les secrets dans cette famille. Ainsi, à l’âge de seize ans, j’avais invité deux camarades de l’université à passer la soirée avec moi. À un moment donné, je me rendis dans la cuisine pour demander du café à la bonne, Lucille. Je ne la trouvai pas et la cherchai sans succès partout dans la maison. Commençant à être inquiète, j’empruntai l’escalier qui descendait au sous-sol. Et c’est là que je découvris Lucille, étendue de tout son long, le corps tremblant dans une flaque de sang. N’ayant reçu aucune éducation sexuelle, j’étais trop ignorante pour comprendre qu’il s’agissait là d’un avortement. Je savais où étaient allés mes parents, alors, affolée, je leur téléphonai. Ils accoururent immédiatement et, sans me donner d’explication, ils appelèrent leur médecin de famille. Cette bonne que j’aimais beaucoup fut transportée à l’hôpital et ne revint à la maison que pour prendre ses affaires, car elle avait été congédiée. Quant à mes jeunes amis qui me visitaient ce soir-là, ils sentirent que le secret pesait désormais sur notre famille et quittèrent prestement la maison. Personne ne parla plus de ce terrible incident.
Ce n’est que des années plus tard que je compris ce qui était arrivé à ma chère Lucille. Certes, ma mère, quand j’eus dix-sept ans, m’avait procuré une sorte d’éducation sexuelle. Mais ce fut en fait quelque chose comme un cours de plomberie. En tous les cas, de quoi m’éloigner pour longtemps des relations sexuelles, voire de l’amour. Je me souviens que même le baiser me fut interdit parce que présenté comme un « péché mortel ».
Je crois que l’avortement de Lucille que j’avais tant aimée ne fut pas seulement mis au secret mais refoulé. C’est beaucoup plus tard que je regrettai d’ignorer où se trouvait celle qui m’avait été arrachée de force et d’une façon que je qualifierais de sauvage. Mais je ne l’ai jamais retrouvée.
Au cours de mes études universitaires, j’ai parfois connu des crises d’angoisse et, moins fréquemment, des périodes légèrement dépressives. À cette époque, un père dominicain ami de mes parents et psychologue de profession, croyant peut-être bien faire, m’avait initiée aux amphétamines. Pour m’aider à passer mes examens, disait-il. Je conservai longtemps cette mauvaise habitude, qui m’aidait à écrire mais me laissait à la fin de la journée dans un état physique déplorable.
Ces épisodes pénibles disparurent le jour où je pris le bateau pour me rendre en Europe, où je passai deux années à la fois sérieuses et divertissantes. Je m’offris plusieurs randonnées à travers l’Europe, fis connaissance avec le communisme et rencontrai un militant qui allait devenir mon mari. Michel était un assez beau garçon en dépit de son strabisme divergent, d’ailleurs partiellement dissimulé par d’épaisses lunettes. Après avoir fait sa licence de droit, il préparait un doctorat en économie. Mais il consacrait une grande partie de son temps à militer pour le Parti communiste et, comme moi, pour le Mouvement de la paix. C’est d’ailleurs ce qui me donna l’occasion de le rencontrer, et c’est mon zèle de militante qui le rendit amoureux de moi.
Nous avons emménagé ensemble, d’abord dans un hôtel minable d’une banlieue ouvrière de Paris, à Montrouge, puis dans une chambre de ce qui avait naguère été un bordel, le Sphinx, sur le boulevard Edgar-Quinet à Montparnasse. Je lavais les chemises de Michel dans une cuvette, à l’eau froide. Et nous préparions nos repas sur un minuscule réchaud à alco...