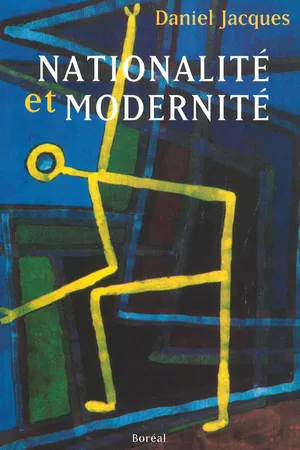![]()
CHAPITRE II
La société des individus
La pensée politique de notre temps se déploie dans l’ombre d’une tragédie. Nulle réflexion sur le sens de l’expérience démocratique et le fait national n’est le résultat d’une délibération parfaitement objective, produit d’un sujet détaché de cet enchevêtrement d’histoires à partir duquel il nous est donné de penser. Nous voilà simplement ni parfaitement déliés, ni totalement enchâssés. C’est pourquoi il demeure possible de penser, comme le rappelle Hannah Arendt, à partir des événements qui se présentent à nous. Sans le tranchant de la rencontre parfois brutale des choses et des hommes, il est difficile de se détacher de l’emprise des idées reçues. Or, s’il est un événement qui nous oblige à la pensée plus que tout autre, c’est bien, dans toute son horreur, la Shoa. Nous jugeons des affaires humaines dans l’horizon de sens défini par l’indéchiffrable inhumanité de cette tyrannie. Quoique la connaissance exacte du bien nous échappe désormais, il nous reste, dans cette nuit, une expérience certaine du mal. Aucune réflexion sur notre situation politique, encore moins sur la nation et ses rapports au pouvoir, n’est donc aujourd’hui possible qui ne renvoie, d’une façon ou d’une autre, à l’obscurité apparemment sans fond de ce déchaînement, absurde et pourtant organisé, de la volonté de puissance.
Il est à espérer que ces événements susciteront encore longtemps l’étonnement, obligeant chacun à reconsidérer la signification de notre temps. Le souvenir de ces corps mutilés, de ces êtres qu’on a voulu reconduire par la force à l’état de choses anonymes, fut et demeure tel que l’histoire paraît à nouveau privée de sens, de sorte que l’idée d’un progrès de l’humanité perd toute évidence. Il est vrai qu’un tel soupçon a surgi dans la conscience européenne bien avant l’holocauste. La Terreur, engendrée à la suite de la révolution des droits de l’homme, représentait déjà une première énigme d’importance. À cela il faut ajouter les guerres, sous Napoléon d’abord, mais plus encore la guerre inutile des tranchées de Verdun. Au terme d’un parcours pourtant déjà bien déroutant, les récits de Soljenitsyne sur le Goulag ont levé le voile sur d’inimaginables souffrances. Tout ceci laisse une amère impression, comme si la même histoire se répétait à diverses échelles et selon des contextes politiques et historiques différents. Chaque fois, tout commence dans l’enthousiasme et le défi pour se déterminer dans la désolation et l’impuissance. À cet égard, l’histoire allemande, du rassemblement de Nuremberg au procès du même nom, quoique singulière, semble porter à son terme une logique partagée. À considérer ce siècle à partir de sa fin, on a le sentiment que quelque chose se répète sous les différents visages de la politique et que ce quelque chose est lié de manière essentielle à l’idée de révolution.
L’horreur des massacres auxquels ont conduit ces tyrannies n’affecte pas que la notion de progrès, puisque, par le biais de cette conscience historique, c’est le sens même de l’expérience moderne qui est interrogé. Il est étrange que l’époque qui a vu naître le désir d’une paix universelle soit aussi celle des guerres les plus impitoyables. Tout aussi étonnant est le fait que la culture moderne, caractérisée d’abord par l’humanisme, ait pu favoriser, d’une manière ou d’une autre, les politiques les plus inhumaines. À ce propos, le rôle tenu par certains intellectuels allemands sous la République de Weimar et durant les premières années du Reich reste extrêmement problématique. Ce qui mérite notre attention avant tout, car ce sont là des choses connues, c’est le fait si singulier que notre siècle fut le théâtre d’un retour radical et violent de l’autre à une altérité naturelle ou historique. Il nous a été donné de voir comment, suite à la révélation chrétienne, les Modernes ont été amenés à mettre le fait de la similitude des hommes au cœur de leur anthropologie. Sur ce fondement, ont été institués les droits humains et les devoirs de solidarité sociale et politique. Comment, dès lors, expliquer ce renversement de toutes les perspectives qu’incarne l’inhumanité des régimes nazi et communiste ? Dans le pays de Tolstoï et dans celui de Kant, que sont devenues les exigences de l’humanisme, au moment où le Juif fut traité comme un animal et le paysan réduit à n’être qu’un atome dans le ballottement universel de l’histoire ? Quels que soient les liens entre ces dérives politiques, ce qui importe c’est le fait de ce renversement singulier qui conduit, au cours de la modernité, d’une reconnaissance initiale de la ressemblance des hommes à une affirmation brutale et volontaire de l’altérité radicale de l’autre1. Qu’est-ce qui a pu amener un officier nazi, par ailleurs cultivé, à ne voir dans l’autre qu’un autre, jusqu’à lui refuser toute humanité, sans même pouvoir — ou vouloir — reconnaître par quelle ressemblance manifeste il est lui-même, depuis toujours, uni à ce visage souffrant2 ? Voilà une question d’une immense portée, dont il faut mesurer la foncière opacité et la difficulté pour apprécier le caractère nécessairement imparfait et limité de toute réponse.
Les deux grandes tyrannies de notre siècle semblent appartenir à une même famille, comme si l’une et l’autre relevaient d’un phénomène comparable. On peut objecter à un tel rapprochement le fait qu’il occulte la singularité du nazisme, c’est-à-dire le caractère particulièrement inhumain de la destruction des Juifs d’Europe, et dissimule du même coup la destination proprement universelle du projet socialiste, confondant ainsi le goulag avec les camps d’extermination. Il est pour le moins délicat de chercher à établir une échelle dans l’horreur, ce à quoi je ne saurais me résoudre dès lors que les victimes se comptent en millions d’individus de chaque côté. Ce rapprochement entre le socialisme révolutionnaire et le national-socialisme a son origine dans le fait établi que les deux régimes ont utilisé des procédés comparables afin de parvenir à leur fin et qu’ils sont apparus à la même époque3. Comme l’ont fait remarquer plusieurs analystes, cette similitude dans les moyens ne doit pas cacher la disparité des fins poursuivies, car il y a divergence totale quant au contenu de ces politiques. Le socialisme révolutionnaire présente une visée universelle dont l’accomplissement idéal conduirait à la libération de toute l’humanité. En revanche, les révolutions fascistes et nazie ont pour objectif l’établissement d’une domination particulière devant conduire à un ordre mondial fondé sur une hiérarchie des races et des peuples. En ce sens, il y a manifestement une opposition irréductible. Le concept de totalitarisme, si utile à la défense de la démocratie libérale, ne saurait avoir de sens qu’en s’appuyant sur la démonstration qu’il existe, au-delà de cette divergence dans les fins, une parenté fondamentale, de sorte que ces deux projets révolutionnaires se révèlent possibles à partir d’une affiliation plus essentielle. À la suite de plusieurs autres, j’emprunte cette voie, en conservant toutefois à l’esprit la question de la ressemblance.
L’objet principal de notre enquête étant la nation, il faut porter toute notre attention sur l’une des deux grandes figures de la tyrannie moderne, laissant à d’autres le soin de juger de ce qu’il en est du communisme comme réalisation historique et idéal politique. En effet, il importe de comprendre les logiques conceptuelles et la sensibilité morale qui ont permis l’émergence de régimes politiques tels que le fascisme et, davantage encore, le national-socialisme pour au moins deux raisons. D’abord, ils incarnent dans l’histoire une politique du refus de l’autre qui semble se construire, dans la modernité, à l’encontre de ce qui paraît pourtant caractériser celle-ci. C’est pourquoi l’histoire intellectuelle de ces régimes demeure si problématique. Ensuite, il y va de la valeur même de toute politique fondée sur la revendication d’une différence nationale ou autre. Le destin apocalyptique de ces politiques racistes et nationalistes ayant entaché à sa suite toute figure approchée du politique, même les plus pacifiques, pourtant, de ce simple fait, foncièrement dissemblables. Dans la chute du nazisme, ce sont un peu tous les nationalismes possibles qui ont été discrédités, par voie d’association, de sorte que, aujourd’hui encore, dans le discours de certains libéraux sur la question nationale, tant en Amérique qu’en Europe, on voit poindre par-derrière l’appel aux droits de l’homme le spectre d’une telle politique raciste, spectre qui joue d’ailleurs le rôle d’un argument auquel on ne peut s’attaquer sans risquer de se couvrir du même discrédit, du même soupçon. Tant et aussi longtemps qu’une telle hypothèque pèse aussi lourdement sur l’idée de nation, on ne saurait envisager la question avec clarté.
Est-il besoin de préciser qu’il ne s’agit aucunement d’apporter une explication complète de l’avènement de ces régimes politiques ? Il s’attache à l’événement historique une part complexe de contingences qu’il appartient à l’historien d’éclaircir. Ensuite, l’événement de la Shoa, en tant qu’il reste et demeure une énigme morale, ne saurait être épuisé par la considération des causes possibles de son établissement historique. Enfin, une telle prise en charge dépasse, et de loin, les fins de cette étude. Il s’agit bien davantage de reconnaître à partir de quelle sensibilité morale et sur fond de quelles trames conceptuelles la mise en place d’une telle figure du pouvoir est devenue possible à notre époque. C’est la raison pour laquelle, bien plus que les auteurs nazis ou fascistes eux-mêmes, acteurs politiques ou idéologues rivés les uns et les autres aux mots qui donnent le pouvoir, il nous faut tourner notre regard vers ces écrivains et intellectuels, conservateurs radicaux, qui, en raison même de leur mépris pour la bourgeoisie, ont ouvert la voie aux autres, n’ayant su reconnaître l’ennemi dissimulé sous les traits de ces alliés de circonstance.
Il est d’usage aujourd’hui de réunir ces intellectuels sous le terme général de révolution conservatrice. Bien qu’ils aient suivi des chemins parfois divergents, qu’ils aient adopté une ligne de conduite fort différente face au pouvoir, certains s’inscrivant au parti national-socialiste, d’autres s’abstenant de se compromettre, ils eurent en commun une certaine posture politique et, peut-être davantage, une même inquiétude quant au destin spirituel et moral de l’Allemagne et de toute l’Europe. C’est le sens propre de cette inquiétude qui mérite, aujourd’hui encore, d’être examiné, même si plus rien de leur projet politique ne peut et ne doit subsister.
Pour saisir l’esprit de cette révolution avortée, mais révolution tout de même, du moins au regard de ses acteurs, il faut faire intervenir trois composantes distinctes. C’est le mélange de ces trois éléments qui a favorisé la création d’un totalitarisme de droite. On doit d’abord disposer d’une théorie ethnique de la nation, dont Herder, réagissant aux principes de la Révolution française, a défini les principes. Sur ce point, il existe de nombreuses études montrant quels liens unissent le romantisme allemand à l’avènement du national-socialisme, dissimulant même parfois la part de modernité propre à cette critique des Lumières4. C’est pourquoi je ne reviendrai qu’au passage sur cet aspect de la question. Il faut ajouter à cette première composante l’idée de révolution. Il est impossible de rendre compte de l’esprit de la révolution conservatrice, tout comme des mouvements fascistes et national-socialiste, sans reconnaître le rôle qu’y joue cette idée maîtresse, même si celle-ci fut transfigurée en vue d’autres fins, si ce n’est renversée quant à sa destination initiale. C’est cet amalgame de la nation, du moins une certaine idée de la nation et de la révolution, qui ouvrira la voie à une toute nouvelle figure de la politique moderne. Enfin, au terme de ce parcours, il est un autre élément essentiel qu’il faut considérer. On voit apparaître, partout en Europe, mais davantage dans le milieu intellectuel allemand, le sentiment d’un déclin possible de la culture, de l’avènement, si rien n’est fait, d’une nuit du monde qui s’annonce à l’envers des Lumières. Il n’y a pas de doute que ce puissant sentiment, qui n’est pas sans lien avec l’inquiétude engendrée par le déclin des religions établies, ait contribué grandement à créer un climat intellectuel propice à l’éclosion d’un certain radicalisme politique. Dans ce temps présumé de toutes les insignifiances, soudain la prudence politique, si chère aux Anciens, est apparue non seulement inutile, mais foncièrement dommageable.
* * *
La pensée politique de Carl Schmitt se distingue par la mise en valeur des concepts d’ennemi et d’ami, de telle sorte que ceux-ci acquièrent, dans cette perspective radicale, une portée tout autre que celle que leur attribue généralement le sens commun ainsi que la tradition de la philosophie politique. Il y va ici de la nature même du politique, puisque la désignation de l’ennemi, pour Schmitt, fonde toute figure possible du pouvoir. L’État se voit ainsi assigner pour tâche principale de donner corps, dans l’histoire, à cette distinction fondatrice. Aux yeux de Schmitt, celui qui se refuse à reconnaître ce fait originaire de la politique se refuse tout simplement à penser celle-ci. Schmitt ayant aboli toute frontière légitime entre les domaines de l’action et de la pensée, on peut conclure, sans crainte de s’égarer, que celui-ci pose un geste éminemment politique en se situant lui-même dans l’histoire des idées ; marquant ainsi ses appartenances, reconnaissant ses dettes et, enfin, affichant ses inimitiés. À ce jeu de l’ennemi et de l’ami, jeu très périlleux comme le démontrera abondamment la suite de l’histoire, Schmitt n’a pas toujours été habile. Ainsi, il a cru reconnaître dans Hobbes un allié spirituel, un maître, sans remarquer par quelle parenté essentielle celui-ci reste lié à ses ennemis libéraux5. Quoi qu’il en soit des méprises de Schmitt dans ses alliances malheureuses, voire condamnables, sur lesquelles il faudra revenir, il est un personnage à propos duquel il ne s’est pas trompé, dans lequel il a su reconnaître son adversaire de toujours. Comme il l’affirme sans équivoque dans La Notion de politique, Benjamin Constant est l’incarnation même de l’ennemi, bien davantage que Marx ou Rousseau, dans cette lutte à finir qui oppose conservateurs et progressistes depuis, à tout le moins, la Révolution française6. Dans les écrits de Constant se trouve ainsi réuni tout ce qui répugne foncièrement à la sensibilité conservatrice et révolutionnaire de Schmitt et fait, à ses yeux, la nature même de l’esprit libéral, c’est-à-dire, notamment, la valorisation du commerce au détriment de la guerre et celle de l’individualisme possessif par opposition à la communauté nationale. C’est pourquoi il importe de commencer par l’examen de la pensée de ce pacifique adversaire, puisque, laissé à lui-même, Constant ne se reconnaît aucun ennemi de cette sorte.
La pensée de Benjamin Constant témoigne d’une expérience directe de la Révolution française et procède, par retours incessants, à la singularité de l’événement. En effet, Constant s’étonne devant le déroulement de la Révolution et ses suites imprévues. Il pense dans le sillage de ces bouleversements historiques et se donne pour tâche de rendre compte des dérives politiques, apparemment insensées, auxquelles ils ont donné lieu. Voilà pourquoi la Révolution demeure à cette époque bien davantage un problème qu’une solution, n’étant pas encore devenue un idéal. Pour Constant et ses contemporains, l’essentiel est alors de terminer la Révolution et de découvrir sous quel régime de liberté et d’égalité il est possible désormais d’ordonner cette formidable puissance sociale délivrée par l’avènement de la modernité.
Au cœur de l’expérience révolutionnaire, se trouve, à la manière d’une énigme posée devant la conscience commune, le fait de la Terreur. Si Constant, en raison de ses affinités libérales, se sent en accord avec les événements de 1789, il ne peut, à l’évidence, accepter ceux de 1794. Il lui faut donc, pour sauver la révolution, lui conserver toute sa légitimité première, son sens véritable, la distinguer de la Terreur, c’est-à-dire montrer que ce violent dérapage n’était en rien inévitable et qu’il ne découle pas de l’application des principes républicains, ce qui constituerait un motif suffisant pour qu’ils soient rejetés, comme le pensent d’ailleurs les critiques légitimistes. Constant s’est donné pour tâche de répondre à ces critiques, c’est pourquoi il cherche à offrir une explication à la dérive révolutionnaire qui ne mette pas en cause toute la tradition libérale. Il est possible, pense-t-il, de redonner le pouvoir au peuple, établissant ainsi une autorité qui soit sous sa dépendance initiale, tout en étant stable et relativement autonome. Dans cette perspective, Constant tente de montrer que l’esprit de la révolution a été perverti par l’introduction d’éléments étrangers. Il y a une impureté initiale de la Terreur du simple fait qu’elle est le fruit d’un mélange instable de politiques antagoniques. Aussi le travail du philosophe, à la manière de quelque chimiste, est-il d’effectuer les analyses permettant de retrouver la forme pure de l’esprit libéral qui anima la Révolution à ses débuts et avec lequel il est possible et nécessaire, selon Constant, de renouer. C’est d’ailleurs en inventant les principes de cette chimie nouvelle de la politique qu’il est parvenu à saisir la nature de ces « réactions » politiques qui bouleversent la société de son temps.
On ne peut saisir dans quelle perspective se déploie l’argument de Constant sans examiner d’abord la conception qu’il se fait de l’histoire. À partir du fait de la Révolution, peut-être plus exactement encore de la conscience qu’en avaient ses acteurs, la question du sens de l’histoire acquiert une importance capitale. On vit alors sous la conscience aiguë qu’il y a un avant et un après la Révolution et que cet avènement d’un pouvoir sur les hommes fondé par tous les hommes qui composent la cité, à tout le moins virtuellement sans exclusion, représente une rupture irréversible dans le cours de l’histoire. Si la conscience historique moderne ne trouve pas là son fondement, puisque ses commencements précèdent ces événements, il demeure que ceux-ci ont grandement contribué à la généralisation de cette figure de la conscience, de sorte que le langage de l’histoire est devenu indispensable par la suite, tant en politique qu’en philosophie. Autrement dit, par le moyen de la conscience révolutionnaire, plus justement encore du sentiment de rupture par rapport au passé qui l’accompagne, les hommes ont acquis la conviction profonde et désormais incontournable qu’ils ont, dans l’histoire, leur lieu véritable.
À cette conscience de l’irréversibilité de l’histoire, il convient d’ajouter, puisque l’une renvoie à l’autre, l’idée que la société des hommes est leur création et qu’il leur appartient de modeler celle-ci à la mesure de leurs aspirations. Une fois établie cette sensibilité au devenir des sociétés humaines, il est inévitable qu’on en vienne à s’interroger sur le sens de ce devenir, sa direction initiale. Déjà Rousseau, dans le Second Discours, avait tracé un tableau plutôt sombre de l’histoire humaine, conduisant de l’égalité naturelle de tous à l’inégalité la plus grande. Il est vrai qu’il envisageait aussi, par un singulier retour des choses, que cette inégalité extrême donne naissance à l’égalité de tous sous la tyrannie d’un seul, simulacre malheureux de la condition naturelle, mais l’essentiel de son propos demeure dans la ligne d’un accroissement de l’inégalité. Constant, ayant derrière lui la Révolution, inverse la perspective, se plaçant, tout comme Tocqueville ensuite, au terme d’une histoire marquée cette fois par les progrès de l’égalité. L’égalité n’est plus à rechercher dans l’origine du monde, mais bien davantage dans l’avenir des sociétés humaines. Par ce renversement, Constant en vient à penser que la figure véritable de la nature humaine n’appartient pas au passé mais à l’avenir, de sorte que l’histoire ne recouvre pas celle-ci, mais opère sa réalisation effective. C’est en ce sens que, pour Constant, l’égalité est conforme à la nature véritable de l’homme, nature qu’il nous est donné de reconnaître non pas à partir de ses manifestations incomplètes, de ses inachèvements passagers, mais plutôt au moyen de ce qui se laisse entrevoir par l’examen de l’histoire. De ce point de vue général, partagé par de nombreux contemporains et successeurs de Constant, l’homme paraît se réaliser dans l’histoire et n’avoir d’existence qu’en son sein. Or, dès que l’on accepte l’idée que l’égalité représente la direction finale de cette histoire, il s’ensuit que tout ce qui s’oppose à l’institution d’une société libre et égalitaire, sous la gouverne des hommes seuls, appartient au passé et s’inscrit à l’encontre du sens même de ce devenir collectif. Puisqu’on ne saurait vraiment s’opposer à l’histoire, tout comme autrefois à la Providence, il découle de cette conviction que la compréhension de l’histoire définit un destin pour les hommes, destin inexorable avec lequel il faut, bon gré mal gré, composer. Toute opposition au projet de la liberté et de l’égalité de tous semble condamnée par avance à n’être, au mieux, qu’inutile et relève d’une méprise profonde sur le devenir de l’humanité.
Toute la pensée politique de Constant repose sur cette philosophie du présent. Il s’agit, pour lui, de penser non seulement la situation de l’homme moderne dans sa généralité, mais davantage ce qui fait s...