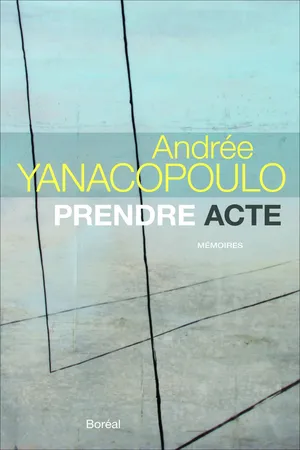![]()
MONTRÉAL
![]()
Avant Hubert
Nous sommes arrivés à Montréal, Michelle, cinq ans et demi, Christian, quatre ans, Claude, deux ans et demi, et moi, trente-deux ans et demi, au courant du mois de juin 1960 ; nous avions tous les cinq été pris par l’Immigration canadienne sur le quota martiniquais : cela faisait toujours deux sinon cinq Noirs de moins à accepter pour l’année en cours ! De nouveau, mon premier contact avec le pays où j’allais vivre se fit sur le tarmac. J’entendais autour de moi les gens parler en anglais — du moins, le pensais-je ; en fait, ils s’exprimaient en français, mais en accentuant les mots différemment de nous.
Jean avait loué un bel appartement dans ce que j’appris s’appeler un duplex, rue Grosvenor, à une centaine de mètres à peine du chemin de la Reine-Marie et donc de l’école Marie de France où irait Michelle et que jouxtait une garderie que fréquenteraient les deux garçons avant d’être inscrits au collège Stanislas.
Nous avons été chaleureusement accueillis. Je bénéficiai rapidement des services d’une gardienne, une bonne grand-mère souriante et dévouée, grâce à qui je pus être libre de sortir le soir et d’ainsi répondre aux invitations que nous firent des collègues de la faculté. J’étais constamment confrontée à des façons de dire ou de faire inconnues de moi. Lorsque nous arrivions chez nos hôtes, j’étais priée de déposer mon manteau sur le lit de la chambre conjugale, tandis que Jean laissait le sien dans la « penderie » de l’entrée. Le dîner (« souper ») commençait à six heures. J’ai d’emblée aimé et adopté le rythme des repas : midi, six heures, et une longue soirée devant soi étaient beaucoup plus agréables pour ordonner le temps que treize heures puis dix-neuf ou vingt heures qui vous obligent quasiment à aller vous coucher dès la dernière bouchée prise. Le repas terminé, hommes et femmes se séparaient en deux groupes — c’était le moment le plus ennuyeux, je n’ai pas honte de l’avouer, car je le dis sans condescendance ni mépris : ces dames ne parlaient que des enfants, de l’école, de la cuisine, etc. Je lorgnais du côté des hommes et les enviais : ils discutaient enseignement, université… Un soir, je me glissai dans la cuisine où notre hôtesse mettait un peu d’ordre. Elle vidait plats et assiettes, jetant tout aussi bien les restes que les aliments auxquels personne n’avait touché : tranches de jambon, légumes, morceaux de pain prenaient allègrement le chemin de la poubelle, à mon grand scandale… intérieur.
Vers onze heures, un petit en-cas à base de fromage d’Oka ou de cheddar, car c’était alors à peu près les seuls fromages que l’on trouvait à moins d’aller au Duc de Lorraine, et de grignotines, voire de jambon, nous était présenté — un quasi-médianoche. Nous ne rentrions jamais avant minuit et demi ou une heure du matin. Un invité, Bertrand Rioux, professeur de philosophie et frère du sociologue Marcel Rioux, me demanda une fois comment je trouvais les gens d’ici, et c’est en toute honnêteté que je lui répondis : gentils, amicaux, sympathiques, accueillants ; il opina en souriant.
Mais tout n’était pas dit, certaines choses me dérangeaient, et plus que tout, le gaspillage généralisé : les feuilles blanches dont on ne noircissait que le recto, les bas qu’on jetait au lieu de les remmailler, les plaques d’auto qu’on renouvelait chaque année, et de façon générale la consommation insouciante que l’on faisait de tout. Les biens ne demandaient qu’à être cueillis. Ainsi, quand on achetait une voiture, le prospectus n’indiquait pas la consommation d’essence tant le prix en était dérisoire. On semblait vivre dans un monde protégé, sans menace aucune, fait sur mesure pour le confort de tous. Par ailleurs, certaines pratiques avaient des relents de puritanisme : l’obligation de toujours transporter les bouteilles d’alcool dans un sac, la coutume de ne laisser jamais les cloisons des cabinets d’aisance descendre jusqu’au sol…
Bien sûr, le langage aussi me déroutait. Le livreur de lait — encore un luxe : le lait, les œufs, le beurre livrés chaque matin à domicile — me vantait un jour les grandes étendues du Québec : des centaines de milliers de mille carrés ; il avait une telle façon de prononcer « carrés » que, pénétrée de ce que j’avais entendu dire de la forte présence catholique au pays, je compris, tout en me posant des questions, « curés ». Lorsqu’on nous livra nos affaires de Martinique, je dis à un moment donné à Jean : « Veux-tu m’apporter le… ? Il doit être dans le… le truc, tu sais… ». Ravi, un des déménageurs me fit : « Ah ! vous dites “truck”, vous aussi ! » Ne parlons pas des vêtements, c’était à devenir fou : les socquettes et les chaussettes étaient des bas, les soutiens-gorge des brassières, les chemises et les chemisettes des camisoles, les gants des mitaines, etc. etc., sans oublier les panneaux publics ou certaines réclames de magasins : au moment du solde de blanc, en janvier : « Grand écoulement de blanc à la verge » ! Et un vocabulaire, bien sûr, pas toujours évident : lorsque Jean, un jour, dit qu’il avait trois gosses…
J’appris rapidement que les Québécois votaient « bleu » au Québec, « rouge » à Ottawa ; que langue et religion allaient ensemble (petite histoire : « Tu sais, dit l’un à l’autre, je vais me faire protestant. — Tu es fou, tu ne sais pas parler anglais ! ») ; que leur devise était Je me souviens : c’est bien le seul pays qui se fixe un programme statique, n’annonçant aucunement comment envisager ou façonner l’avenir. J’avoue avoir été quelque peu déconcertée par certains usages, certaines pratiques : les médecins ne venaient pas à domicile — pourtant, un malade ne peut pas toujours se déplacer, et attendre en salle d’urgence est malcommode pour lui ; à la banque, l’enveloppe d’une lettre qu’on avait reçue suffisait comme preuve d’identité, et curieusement, les Québécois répugnent encore de nos jours à accepter le principe d’une carte d’identité avec photo alors qu’ils s’étalent dans Facebook et autres « utilitaires sociaux ». Enfin, pour couronner le tout, cet oxymore amusant : le parti progressiste-conservateur, et l’inattendu, incroyable : la Révolution tranquille, telle un « silence éloquent » !
L’automne était arrivé, puis l’hiver ; je trouvais qu’il faisait froid — la Martinique était loin. J’apprendrais plus tard à distinguer le temps « frais » du temps « froid ». Mais la lumière était belle, et éclipsait sans conteste le ciel plus doux mais morne et gris qui règne souvent à cette époque à Lyon et plus encore à Paris. Montréal me faisait penser à une station de ski, pleine de soleil et de neige. Les enfants aussi s’adaptaient — et je dus m’habituer à, sans hurler, les entendre me demander, une fois que je les avais à grand-peine engoncés dans leur équipement hivernal : « Pipi, maman ! » J’appris à protéger mes chaussures et à m’habiller, j’allais écrire « chaudement » ; en fait, ce n’est que récemment que je me suis décidée à vraiment porter des vêtements adaptés au climat. Il y a une vingtaine d’années encore, donc après plus de trente ans passés au Québec, comme je devais apporter mon article au responsable du magazine Spirale et qu’il faisait près de moins trente, je me suis dit qu’avec un bon chandail sous mon manteau, des gants, mes mains bien enfoncées dans les poches et mon bonnet, je devrais aisément arriver à faire cette course d’à peine plus d’un quart d’heure. J’ai cru mourir sur place. Dans la rue, aucune voiture, aucun passant, que des demeures particulières, rien qui aurait pu me porter secours si je m’étais effondrée. Parvenue enfin à une rue commerçante, je me suis engouffrée dans un magasin ; au contact de la chaleur, les doigts se mirent à me faire très mal, mais au moins j’étais saine et sauve.
Jean enseignait au Département d’anthropologie. Assez rapidement, le nouveau directeur de celui de sociologie, Guy Rocher, se montra désireux de m’engager pour travailler en psychiatrie sociale et transculturelle et me demanda de donner un exposé sur ces questions. Je préparai, consciencieuse mais inquiète, la leçon qui devait décider de ma carrière universitaire. Elle plut et je fus engagée. Ma charge serait pour moitié de l’enseignement, sous la forme d’un séminaire de psychiatrie sociale, et pour moitié de la recherche. De plus, Guy avait pris les dispositions nécessaires auprès de la direction médicale du Allan Memorial, l’annexe psychiatrique de l’hôpital Royal Victoria, pour que je puisse y faire un « stage de rafraîchissement » comme il disait. C’est ainsi que j’ai suivi les visites du Dr Ewen Cameron et pu l’entendre ordonner une série d’électrochocs quotidiens à des malades ; j’étais plutôt effarée, et me suis dit que décidément je n’étais plus au courant de ce qui se faisait en thérapeutique psychiatrique. L’avenir devait m’éclairer sur la question.
Chercher, oui, mais quoi ? J’arrivais tout juste au pays… Deux séances furent mises sur pied, au cours desquelles des psychiatres (Yvon Gauthier, Jean-Noël Fortin), des psychologues (Thérèse Gouin-Décarie), des travailleurs sociaux, les sociologues du département acceptèrent de livrer pêle-mêle leurs impressions et leur expérience professionnelle, et d’en discuter entre eux afin de me permettre d’en tirer un sujet de recherche.
Une ou deux semaines plus tard, je téléphonai à Guy Rocher : « Je crois que j’ai trouvé : il s’agirait de vérifier cette constatation que le diagnostic de dépression est plus souvent porté du côté canadien-français que canadien-anglais, et d’essayer de comprendre quels sont ses liens avec la culture canadienne-française. » Il accepta. Le projet devait se réaliser sous l’égide à la fois du Département de sociologie en la personne de son directeur, et de celui de psychiatrie également en la personne de son directeur, le Dr Camille Laurin. Feraient équipe avec moi Michèle Roussin, psychologue, et Marquita Riel, sociologue — lesquelles allaient se révéler des collègues compétentes et intelligentes puis de fort agréables amies.
La recherche se trouva par conséquent orientée selon trois axes, à savoir 1. psychiatrique : l’incidence de la dépression est-elle élevée parmi les Canadiens français de Montréal ? 2. psychologique : les tendances dépressives l’emportent-elles dans la personnalité normale ? 3. sociologique : la perception qu’a l’individu de sa culture est-elle dépressive ?
Je me lançai avec ardeur dans ce travail, persuadée de me trouver dans le domaine nettement circonscrit de la psychiatrie sociale, et donc totalement inconsciente du guêpier dans lequel j’étais en train de m’immiscer mais sur lequel j’allais peu à peu mettre un nom : celui de la grande question politique qui mobilisait alors les esprits, à savoir celle de la domination et de — disons le mot — la colonisation des Canadiens français par les Canadiens anglais. En juin 1962, je fis à propos de ma recherche une communication au congrès de l’Association canadienne pour l’avancement des sciences ; je n’en revenais pas, la salle était comble et les couloirs grouillaient de monde.
Peu à peu, le département se meublait. Je me souviens surtout de l’arrivée de Marcel Rioux et de celle de Jacques Dofny — que leur amour commun du socialisme rendrait bientôt inséparables, en raison de quoi Hubert Aquin les surnommerait « les Marx Brothers ». Marcel était un bon vivant, rieur, toujours en train de raconter des histoires drôles que j’écoutais attentivement, car bien souvent elles me révélaient le Québec profond. En voici deux que j’ai retenues. L’une met en scène un Français tout nouvellement arrivé et un Québécois qui lui explique à quel point son pays est remarquable : « Des forêts qui n’en finissent pas, remplies d’arbres avec des troncs comme ça, serrés, denses… Et puis, c’est rempli d’animaux sauvages, des orignaux avec des bois immenses et… — Mais alors, objecte le Français, comment font-ils pour passer entre les arbres, si… — Mange d’la marde ! » Dans l’autre, un Français arrive sur la Côte-Nord ; on lui raconte les merveilleux plaisirs de l’hiver, la neige, le ski, etc. Il demande : « Et l’été, qu’est-ce que vous faites ? — Ah, ce jour-là, on se baigne ! » Les contraires s’attirent, on le sait : Jacques, tout en étant fort aimable, était souvent plutôt grave, le front barré par des préoccupations sociales.
Je décidai de faire un doctorat en sociologie et m’inscrivis à mi-temps aux cours requis. C’est de ma note en statistiques que je suis le plus fière : 92 sur 100. Je savais ce que serait mon sujet de thèse et avais commencé à y travailler : le suicide à Montréal, que j’étudierais sur les deux plans statistique et psychosociologique. De temps en temps, pour parfaire ma connaissance du Québec, je me rendais au séminaire qu’animait Albert Legrand sur la littérature du pays. Je me souviens que s’y trouvaient entre autres André Brochu et Jacques Allard, tous deux futurs universitaires et essayistes ; je retrouverai Jacques Allard plus tard, à l’occasion de l’édition critique de l’œuvre d’Hubert Aquin.
À l’été, Jean et moi fîmes un voyage en Europe centrale. C’était encore la guerre froide ; il nous avait fallu donner à l’avance, pour les pays d’obédience soviétique, l’horaire précis de nos déplacements ainsi que les hôtels choisis — et nous avions été dûment avertis de ne pas y déroger d’un cheveu.
Jean s’était fortement lié avec le criminologue Denis Szabo, et nous nous invitions souvent de couple à couple. Un soir, en arrivant chez eux, je remarquai d’emblée un homme, accoudé de son bras droit au manteau de la cheminée, qui semblait disserter brillamment ; mince, élégamment vêtu, les cheveux bruns, la moustache fine, il me fit penser au héros du livre de Guy de Maupassant, Bel-Ami. C’était Jacques Parizeau, futur premier ministre du Québec.
Szabo, donc, nous avait demandé de rendre visite à ses parents, restés en Hongrie. Nous visitâmes Munich, entièrement reconstruit à l’identique, et dans sa banlieue, ce qui restait de Dachau et de ses fours crématoires : frissonnant ; Vienne et le château de Schönbrunn. Puis nous franchîmes le rideau de fer, nous arrêtâmes à Prague, dans ce qui était alors la Tchécoslovaquie, et ce fut enfin Budapest et le Danube. M. et Mme Szabo, bien sûr, avaient perdu les conditions de vie qui avaient été les leurs ; ancien officier de la gendarmerie, appartenant à l’armée donc, lui était maintenant à la retraite ; elle, faisait partie du petit personnel de je ne sais plus quelle ambassade, et j’avais mis du temps à comprendre que lorsqu’elle disait « nous », ce n’était pas de leur couple qu’elle parlait, mais de son milieu de travail. M. Szabo nous fit connaître les environs de la capitale : le lac Balaton, si étendu et si peu profond, qui fait l’été la joie des baigneurs, Debrecen, la Puszta et les tziganes. Au retour, sur le point de franchir la frontière, nous avons éprouvé un brusque sentiment d’insécurité : et s’« ils » allaient nous garder, prétextant on ne sait quelle irrégularité ? Mais tout se passa bien.
En octobre 1963, parut, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, le premier numéro d’une revue qui se définissait comme politique et culturelle et réclamait un Québec à la fois indépendant et socialiste : Parti pris. Par la suite, elle appellerait également à une société laïque. Un de mes amis se souvient très bien du lancement du premier numéro : « Tu étais là. Quelqu’un, effaré de voir les affiches qui couvraient les murs, s’est exclamé“Mais qu’est-ce que c’est que ça ?”et tu as dit“Eh bien ! Monsieur, c’est une galerie de culture”. »
Le tournant était pris : désormais, il n’y avait plus de Canadiens français, mais des Québécois. On me demanda, en vue d’un numéro spécial intitulé « Portrait du colonisé québécois », d’écrire sur le sujet. Je comprenais de mieux en mieux l’importance de la question que j’avais choisi d’explorer : poussant un jour mon chariot dans la grande épicerie Steinberg qu’a remplacé sur Côte-des-Neiges un magasin Métro, je rencontrai le Dr Pierre Lefebvre, dont je connaissais les convictions indépendantistes. Il me dit « On attend impatiemment les résultats de votre recherche ». Là, j’étais vraiment fixée : j’étais étiquetée « indépendantiste » avant même de me l’être formulé comme tel à moi-même.
Tout donc allait bien sur le plan professionnel. Lorsque je rentrais à la maison, vers quinze-seize heures, je retrouvais mes enfants, qui m’attendaient impatiemment pour me raconter leur journée, et je travaillais tout en restant avec eux, leur demandant de continuer à jouer en essayant de me déranger le moins possible.
Ce qui par contre laissait à désirer, c’était ma vie conjugale. Elle avait commencé à se détériorer en Martinique. Je me disais que, les sentiments amoureux ayant disparu, tant que je trouverais de l’intérêt à discuter de choses et d’autres avec Jean, je tiendrais le coup à cause des enfants. Mais vivre avec lui devenait vraiment difficile et je pensais de plus en plus à le quitter. Je décidai d’aller voir un avocat. Je n’en connaissais pas, aussi ai-je demandé une adresse au consulat français. Un peu tremblante, j’ai pris rendez-vous. En place de conseils et d’aide, j’ai eu droit à un sermon sur la nécessité pour l’épouse de « supporter », de remplir l’entièreté de ses devoirs conjugaux et de s’occuper de sa progéniture. Je n’étais guère avancée.
La vie, elle, continuait. Celle à l’université, j’entends. Je lisais les nouvelles parutions relevant de mon domaine, travaillais assidûment à m...