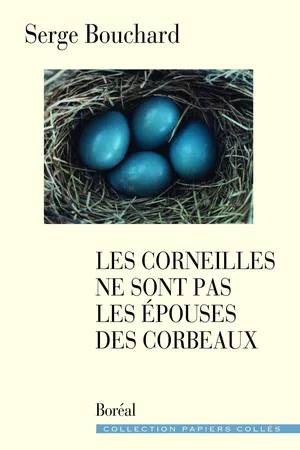![]()
Les cowboys et les Indiens
John Wayne a tué des milliers d’Indiens durant sa longue carrière de cowboy. Les figurants sioux ou comanches se distinguaient par leur habileté à rouler sous des chevaux qui, eux aussi, jouaient le rôle des abattus, des bêtes et des cavaliers qui savaient tomber raides morts au signal du metteur en scène. Malgré ces petits rôles, les Indiens aiment la country. Pourquoi ? Nous tenons là une piste, pour ne pas dire une bonne question, une question directe qui nous renseigne sur les dialogues entre les cultures dans l’histoire. Il est des affinités souterraines qui transcendent les conflits de surface. Dans le monde des Cowboys, il y a des Indiens ; dans le monde des Indiens, il y a des Cowboys.
Le Cowboy n’est pas gentil pour l’Indien, qui le lui rend bien. Mais les deux finissent par se rejoindre sur les plateaux de la liberté perdue. Plateaux de cinéma et pans de vie. Dans les deux cas, l’être libre n’est pas invité à la convention des gens bien installés. Les Cowboys savent qu’ils n’appartiennent pas au village constitué. Les Indiens savent aussi qu’ils campent autour de la société. Le Cowboy couche dans l’étable. Il entre dans le village à l’aube. Les errants se reconnaissent. Le Cowboy et l’Indien chevauchent côte à côte dans leur soif de dignité.
Ce sont des parents ennemis réunis dans leur destin commun.
Ils se disputaient la Prairie, aucun ne l’aura eue. Leur poteau de torture sera un poteau de clôture.
Les deux, le Cowboy et l’Indien, aiment les chevaux et les beaux costumes. Ils aiment les couvre-chefs, les franges, les perles, les couleurs, les mouchoirs rouges. Ils aiment l’espace sauvage. Ensemble, ils seront tristes face à l’arrivée de la locomotive, annonciatrice de la fin du monde. Le chemin de fer est une marque indélébile, la marque de la civilisation. Les Cowboys attaqueront les trains. Les Indiens attaquent les convois et les diligences. Ensemble, ils aiment le whisky. Ils sont gibiers de cavalerie.
Charles Bronson est cowboy et indien, Anthony Quinn a le visage de tous les personnages. Les traits du premier sont un modèle de métissage, slave et mongol en réalité, le fameux mariage de l’Orient et de l’Occident. Mélange ultime. Le visage du second, mexicain et indien, n’a pas besoin de commentaires. Munis de pareilles bouilles, ces acteurs incarneront les Indiens, les Mexicains, les Grecs joyeux ou les bandits polonais, les Italiens, les Français, les Sangs-Mêlés du monde entier. Gabriel Dumont, un authentique guerrier métis, les résume assez bien. Mais qui se souvient de son magnifique visage ? Ou même de son nom ?
Le fermier porte des bretelles qui l’attachent à la charrue. Quand passe l’étranger, le fermier l’abrite pour une nuit. Il soigne les chevaux du cowboy. Il donne une écuelle à la bête et une autre à l’homme. Mais le Cowboy va repartir. Ils se seront peu parlé. D’ailleurs, le Cowboy a peu de choses à dire. Le mutisme du Cowboy rejoint bien celui de l’Indien. Le solitaire est souvent patibulaire. Il serait inutile d’essayer d’exprimer l’indicible. À moins de se mettre à chanter, à faire de la musique. Mais encore, le solitaire n’est pas un virtuose. Il gratte la guitare, il souffle dans l’harmonica.
Sa ballade est légère. Il voyage léger.
L’Indien taciturne et le Cowboy de même personnifient ensemble le contraire du Don Quichotte de Cervantès. Ils ne se racontent pas d’histoires. Ils ne fabulent pas. Ils ne sont pas chevaleresques, ils ne s’inventent pas des causes. Ils savent la fin de l’histoire puisqu’ils sont la fin de l’Histoire. La veuve sera malheureuse, l’orphelin sera orphelin. Et eux s’en iront seuls dans le silence de la perte.
Sitting Bull a travaillé dans le cirque de Buffalo Bill et les guerriers iroquois faisaient le cri de guerre chez Barnum à la fin du XIXe siècle. Le théâtre de l’Ouest mettait en scène des Indiens et des Cowboys en même temps que se déroulaient les événements de Wounded Knee. Nous sommes si tragiques…
Récemment, j’étais au lac Cimon (Simo Shakaigan). Les Indiens d’aujourd’hui sont des Cowboys modernes. Il y a dans tous les Cowboys un Indien qui sommeille. Entendez cette musique de fond, une sorte de nostalgie universelle traversant l’âme des perdants. Cette musique est la consolation perpétuelle d’une peine dont personne ne veut parler.
Sous un grand chapiteau, j’ai donné une longue conférence. J’ai parlé pendant deux jours. Durant les pauses, la musique country jouait très fort. Mais au retour, l’écoute était religieuse, l’assistance nombreuse. J’avais devant moi de riches visages : une grande partie de la communauté anishinabe (algonquine) du lac Cimon. Des chapeaux de cowboy, des casquettes, des bandeaux colorés, des lunettes de soleil, des vieux visages de vieilles femmes, des petits enfants qui couraient partout et des chiens entre mes pattes de conférencier. J’avais moi-même les bottes aux pieds.
La radio communautaire de Simo Shakaigan diffuse exclusivement de la musique country. Captée par Val-d’Or en raison de la proximité géographique, cette radio est devenue la préférée des gens de Val-d’Or. Abitibiens et Algonquins se rejoignent finalement sur ce terrain.
Ma conférence terminée, j’ai parlé à mon char. Je lui ai dit : « Allez mon beau, enligne la 117, nous retournons à Montréal pour faire une émission de radio sur la country-western. »
![]()
Monsieur Germain et mademoiselle Laberge
Il ne suffit pas d’être jeune pour être humain. Il faut faire ses classes. Dans ces classes, il y a des professeurs. Le regard imprécis que nous jetons sur l’école vient de l’incapacité de notre monde à s’inscrire dans le flux du temps. Difficile de nous projeter quand tout se fige dans l’instant. Nous avons un rapport trouble avec le calendrier. Être jeune ne peut pas être un but ni même une vertu. Cela passe. Être jeune, c’est se préparer à ne plus l’être. Les professeurs sont des passeurs, ce sont les artisans de ce passage. Alors, c’est important.
Cependant, rien n’est simple. Les professeurs se retrouvent aux premières loges d’une contradiction grandissante : notre monde ne valorisant ni le souvenir ni le devenir, la jeunesse n’est plus un point de départ, mais désormais un but. Les accords et les calculs du temps ont perdu de leur importance. Il n’y a plus d’après, il n’y a plus d’avant. Alors c’est embêtant.
Retourner à l’école en septembre est déjà une leçon d’humilité. C’est le mouvement perpétuel d’une humanité qui accumule le savoir et qui se doit de le transmettre. Il faut toujours recommencer, nous sommes des êtres inachevés. Même le professeur en apprend tous les jours. Imaginez l’élève. Il faut que jeune apprenne, il faut qu’adulte montre. Rien au monde ne changera l’ordre des choses. Il est curieux de constater jusqu’à quel point l’école, qui est le lieu de toutes les tendances et de toutes les modes, constitue quand même le lieu de la continuité. L’école sera toujours élémentaire.
Dans une société superficielle, l’essentiel n’est pas le premier sujet. Nous parlons beaucoup d’éducation mais nous contournons la question. L’éducation est un budget, l’enseignement un poste et l’école un local. Nous faisons des programmes. L’hiver peut revenir et sévir. La société se remet au travail dans la certitude du devoir accompli, du moment que les enfants sont retenus à l’école. Nous ne tenons pas tellement à savoir combien difficile est le métier de professeur dont la mission consiste justement à transmettre du savoir et à allumer des réverbères. Du moment que l’enveloppe est respectée.
Nous souvenons-nous assez de l’importance de nos premières années ? L’école donne des armes et des armures, elle donne la carte routière de la vie. L’école est toujours une école de conduite. Elle donne des élans, elle fabrique du savoir-vivre. Nous n’avons pas d’autre choix que de faire la somme du passé. D’autres avant nous ont regardé les étoiles, classé les plantes, nommé les animaux, construit des ponts, fait des calculs. D’autres avant nous ont peiné, réfléchi, trouvé, expérimenté, espéré. Tout est histoire et cette histoire doit être apprise. La passion de bien faire doit être constamment reprise. Et nous avons des rêves. Les professeurs nous conduisent. Le métier d’enseignant est on ne peut plus grand.
Contre l’anonymat de la tâche, contre les paradoxes de notre monde, enseigner est un acte d’espoir. Albert Camus disait tout devoir à un seul professeur. Monsieur Germain captivait l’attention de tous les élèves. Lorsqu’il parlait, plus rien n’existait ; il faisait disparaître tous les bruits, toutes les distractions. Même les mouches s’arrêtaient de voler. On ne pouvait donc pas les entendre. La magie est la chose la plus simple qui soit, elle est si ordinaire que nous ne la voyons plus opérer. L’instituteur de Camus n’était pas flamboyant : il semble qu’il ait été profondément humain. Il parlait de sa vie, de sa jeunesse (nous avons tous une jeunesse) et il tissait des liens entre les sujets.
Camus était issu d’un quartier pauvre. Il eût été facile de le classer et de classer l’affaire. Ses chances de devenir un des écrivains les plus importants de son siècle étaient nulles. Pendant que Sartre se préparait dans sa chambre close à devenir Jean-Paul Sartre en lisant trois bouquins par jour, Camus renversait les poubelles des ruelles, se battait dans les terrains vagues, jouait au football. Mais, entre lui et son destin se trouvait un prof, monsieur Germain.
Il n’est pas facile d’être un petit enfant, il n’est pas facile d’être jeune. Toute cette vie à remonter, toute cette vie devant soi, imaginez. Quand j’étais petit, j’avais peur. C’est mademoiselle Laberge qui m’a sauvé. Je ne me souviens pas de son programme mais je me souviens de son visage. Elle respirait l’espoir du monde. Malgré les batailles dans la cour, contre la pauvreté, contre tout espoir justement, elle m’a donné le goût de ne jamais désespérer.
La vie humaine est une école permanente. Ce serait quasiment le dernier refuge de la communauté dans le passage du temps. Ici, on élève des nouveaux humains. Voici de beaux adultes en face de beaux jeunes. Serions-nous la première société dans l’histoire où le jeune n’aspire qu’à être jeune ? Difficile d’être un passeur dans une société qui nie le temps qui passe. Il n’y a aucun avantage à être adulte dans un monde où la maturité est une sorte de décrépitude. Si être jeune est la seule ambition de l’être, alors fermons l’école.
![]()
Les bibittes
Quand je rentre d’un long voyage sur la route, en été, je suis toujours heureux de voir mon pare-brise moucheté, pour ainsi dire picoté, par autant de bibittes écrasées. Dans ma tête, mes voyages se mesurent à l’importance de ce tableau de chasse sur le devant de ma machine. Plus il y en a, plus je reviens de loin. Cette vie morte est bien huileuse, elle tache sans bon sens. Elle se récure mal, comme si ces traces de vie cherchaient à s’imprimer pour de bon. Malgré tout, je voudrais bien voir le squeegee qui toucherait à mes bibittes. Pas question d’effacer d’un seul coup les marques de mes tournées. Ces mouches sont les miennes et je tiens à prendre le temps d’apprécier ce qu’elles représentent. Ce sont des signes des temps et, qui plus est, des temps que l’on traverse.
Le monde est rempli de bibittes. Peu importe que votre automobile soit luxueuse ou ordinaire, les bibittes ne font pas la différence. Dans le pare-brise, sur le pare-chocs, elles cognent, elles beurrent, elles cherchent à lutter contre nous. Jamais on n’a vu un brûlot essayer d’éviter une collision avec un camion. Dans l’ordre de l’hécatombe, l’essuie-glace devient un essuie-sang. Routiers, nous connaissons tous ce combat dégoûtant contre cette sorte de purée. Une mouche, c’est gras.
Fendre l’air revient à fendre un rideau de bibittes qui, la nuit surtout, se prennent un élan pour mieux embrasser la lumière de nos phares. Les bibittes qui font cela passent de vie à trépas sans souffrir, nous l’imaginons bien. L’impact doit être tel que la souffrance n’a pas le temps de se faire sentir. De plus, ces impacts répétés, quoique menus, ont à coup sûr une micro-influence sur la consommation d’essence. Il suffirait de trouver le poids d’un maringouin moyen, après piqûre, pour le multiplier par le nombre de bibittes au pouce carré imprimées sur le nez d’une voiture ; nous pourrions ensuite mettre cette somme en relation avec le poids moyen de l’automobile la plus vendue, compte tenu de sa vitesse moyenne et de la vitesse pareillement moyenne de la bibitte de référence, sans oublier la température de l’air, l’importance du vent ainsi que la reconstitution virtuelle des angles de collision. Notre connaissance de la résistance de l’air s’en trouverait enrichie.
Si je refaisais ma vie, j’entreprendrais une thèse de doctorat sur la diversité des bibittes que l’on retrouve sur le nez des voitures en été. Papillons, mouches noires, brûlots, mouches à chevreuil, frappe-abord, libellules, maringouins, je ferais des cohortes, des types et des classes, je concevrais un programme et tirerais des conclusions. Certaines bibittes meurent sans le vouloir. Elles ne tiennent pas à se faire écraser mais il arrive qu’une voiture les frappe inopinément. Ce sont des accidents. D’autres se suicident carrément. Nous sommes en présence de bibittes malheureuses qui se sont mirées dans l’étang qui les aura vues naître. Elles se trouvent laides à mourir et se cherchent un mur pour en finir. D’autres encore, la majorité peut-être, sont simplement victimes de leurs croyances. Elles croient en ces lumières vers lesquelles elles s’élancent. Un maître mouche leur aurait jadis expliqué que ces feux-là mènent à la terre promise des bibittes, une plage dans le ciel où des millions d’humains à sang chaud dorment nus sur le sable et où les bibittes sont si grandes que personne ne les tue.
La découverte de ces phénomènes tient à nos excès de vitesse. Les bibittes meurent de notre mobilité. Nous filons jour et nuit et elles sont là, dans le chemin. Lorsqu’il y a une éclosion de mouches noires autour d’une flaque sauvage, les mouches se mettent à voyager. Elles traversent des distances incroyables à la recherche d’une peau à piquer et de sang à sucer. Quand elles croisent une route fréquentée, elles se divertissent et elles se préparent à la collision sacrée. Nos machines attirent les bibittes. Pour des raisons inexpliquées, il y a un lien entre les moustiques et la mécanique.
Voilà la nouvelle nature sauvage qui rapatrie les cours à scrap dans le giron de ses grands paradis. Le crotale aime le métal, le homard aime les chars, le porc-épic gruge les filins électriques et les plus beaux papillons rêvent aux lumières des usines et aux flammes des raffineries. Les oiseaux viennent manger les bibittes écrapouties sur les capots des vieilles carcasses. Oui, les oiseaux mangeurs de mouches viennent picosser les radiateurs encore tièdes de nos machines au repos. Vivement la vie. Car ce n’est pas demain que la vie va mourir. Les bibittes, c’est connu, nous survivront. Le réchauffement de la planète les arrange assez.
L’été ramènera toujours le temps du pare-brise moucheté. Je suis heureux quand je tue mes premières bibittes, au printemps. Cela me dit que je roule encore. C’est un signe, une marque, une bonne nouvelle par rapport aux cycles de notre vie. Avons-nous le respect de tout ce qui nous frappe quand nous nous transportons ?
Il y a un univers dans chaque bibitte. L’écrapoutissement d’un univers, cela, quand même, donne à penser.
![]()
Je suis en vacances
Il faut que nos vies soient bien dures pour attacher une si grande importance aux vacances. Jamais, peut-être, le monde n’aura traîné pareille fatigue. Nous sommes riches comme personne ne l’a été avant nous. Nous sommes confortablement installés, bien intentionnés, nous sommes bons. Nous devrions crier de joie, chanter notre bonheur, publiciser le paradis terrestre. Mais non : nous traînons notre lassitude comme un poids que nos ancêtres eux-mêmes n’auraient pas porté, eux qui bûchaient à la sciotte, lavaient les couches à la main, marchaient d’une place à l’autre, se faisaient souffri...