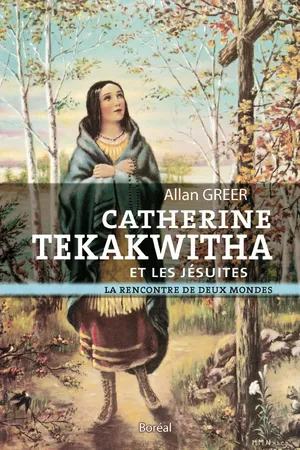![]()
CHAPITRE 1
Une belle mort
Il lui rend visite tous les jours, alors qu’elle se prépare à mourir.
Cela se passe au printemps 1680, pendant la période appelée carême chez les catholiques ; Catherine est à peine capable de se dresser sur sa couche, à même le sol de la maison longue recouverte d’écorce. D’ordinaire, elle reste seule avec son mal, allongée près d’un feu de braises ; à côté d’elle, deux récipients, l’un en bois sculpté contenant sa portion quotidienne de bouillie de maïs, l’autre en écorce avec un peu d’eau. Ce village d’Iroquois chrétiens au bord du Saint-Laurent, n’est peuplé que d’une poignée de femmes, d’enfants et de vieillards. Durant la journée, tout le monde s’affaire dehors, à ramasser du bois de chauffage ou à préparer la terre pour les plantations du printemps. La plupart des hommes, et nombre de femmes, se trouvent encore à plusieurs jours de voyage vers le nord ou l’ouest, dans leurs campements de chasse le long de la rivière des Outaouais et de ses affluents. Ils reviendront à Pâques, chargés de peaux de castor et d’autres fourrures, pour s’acquitter de leurs dettes envers les marchands français de Montréal. Puis il y aura des cérémonies solennelles à l’église, ainsi que des réjouissances. Mais, en ce moment, Kahnawake (ou le Sault Saint-Louis, nom que lui donnent les Français) est plutôt tranquille.
Catherine, que l’on connaît aussi sous son nom agnier (mohawk) de Tekakwitha, est âgée d’environ vingt-quatre ans. Elle vient d’un village situé au bord de la rivière des Hollandais (Mohawk), à l’extrémité orientale de l’Iroquoisie, dans ce qui constituera beaucoup plus tard l’État de New York. Une attaque de variole, dans son enfance, l’a laissée fragile, et les habitudes de châtiment, de pénitence et d’ascèse qu’elle a acquises au début de la vingtaine n’ont pas amélioré sa santé. Après avoir accepté le baptême chrétien, elle a suivi, en 1677, le mouvement migratoire vers le nord entre son pays natal et le village de la mission jésuite de Kahnawake/Sault Saint-Louis. Là, elle s’est jointe à un groupe d’Iroquoises chrétiennes qui ont renoncé à une sexualité active et au mariage, tout en soumettant leur corps à une discipline sévère marquée par le jeûne, la flagellation et l’exposition délibérée à la douleur du feu et à l’inconfort du froid. La vie est précaire pour tous les Amérindiens, en cette époque du « contact » où abondent guerres et épidémies, et le fait d’ajouter des épreuves volontaires fera de Catherine l’une des nombreuses personnes à mourir jeunes. En février, elle est affaiblie par « une fièvre lente avec un grand mal d’estomac accompagné de fréquents vomissement » ; au début d’avril, il ne semble y avoir aucun espoir de rétablissement.
Son seul visiteur régulier, durant la journée, est le père Claude Chauchetière. Ce jésuite de trente-quatre ans, originaire de Poitiers, est venu au Canada trois ans plus tôt, aussi connaît-il suffisamment la langue que parle Catherine pour communiquer avec elle. Claude et Catherine sont arrivés à Kahnawake à peu près en même temps et ils ne sont plus des étrangers, mais avant la maladie de Catherine ils se connaissaient peu. En général, missionnaires et autochtones convertis mènent leur vie séparément à Kahnawake ; de plus, Chauchetière n’a pas baptisé Catherine et il n’est pas son confesseur. Cet honneur revient au prêtre breton Pierre Cholenec, à peine plus âgé et plus expérimenté que Claude. En sa qualité de missionnaire le plus jeune de Kahnawake, Chauchetière a pour tâche de rendre visite aux Amérindiens malades et mourants, de les encourager à demeurer fidèles à leur baptême en cette heure critique, de les mettre en garde contre le recours désespéré aux « jongleurs » (chamans) païens, tout en guettant le moment où il faudra les faire transporter à l’église pour leur donner les derniers sacrements.
Les attentions de Claude envers la jeune malade n’ont rien de routinier. Il se sent attiré auprès d’elle. Il vient plus souvent et demeure plus longtemps que nécessaire. Catherine semble toujours contente de le voir, rapportera plus tard le prêtre. Elle écoute ses paroles ou se joint à lui dans la prière, mais elle ne se plaint jamais de son état. Parfois, il arrive avec une bande d’enfants à ses trousses, et elle les regarde avec intérêt tandis qu’il leur montre des images qu’il a dessinées pour illustrer les scènes de la vie de Jésus ou décrire les terreurs de l’enfer. Les écrits de Chauchetière seront très explicites sur le fait que ces rencontres ont beaucoup plus d’importance pour lui que pour elle.
Qu’y a-t-il donc chez cette jeune « sauvagesse » qui le fascine tant ? Ce n’est rien de ce qu’elle dit ou de ce qu’elle fait durant ces visites, car il ne prend jamais la peine de noter ses paroles, et retient plutôt les soupirs et les regards sincères qui ponctuent ses prières silencieuses. Réservée et obscure au sein de la collectivité, jusqu’à une époque récente, Catherine est l’une des nombreuses Iroquoises qui ont pratiqué jusqu’à l’extrême la prière et la pénitence. Déjà, peu de temps avant sa maladie fatale, le père Cholenec l’a qualifiée de « plus fervente » de toutes et, dans une lettre confidentielle à ses supérieurs, il a mentionné qu’une lumière mystérieuse l’entourait quand elle se flagellait. Les Français et les chrétiens iroquois commencent à croire que la jeune femme timide et modeste possède des pouvoirs spirituels particuliers, et Chauchetière en trouve une confirmation dans le calme tranquille avec lequel elle fait face à la douleur et à la mort.
Claude semble avoir été attiré vers la cabane de Catherine par une sorte de nécessité intérieure qui l’a rendu sensible à son aura de sainteté. Nous avons tendance à imaginer les jésuites de la Nouvelle-France comme des hommes déterminés, dotés d’une personnalité équilibrée et d’une confiance inébranlable en eux-mêmes et dans leur mission reçue de Dieu, pourtant Claude Chauchetière correspond très peu à cette description, particulièrement au cours du printemps 1680, lorsque sa confiance en lui-même atteint le point le plus bas de toute son existence. Depuis son arrivée au Canada, brûlant de l’idéal évangélisateur, il a connu les plus grandes difficultés à faire face aux réalités de la vie de missionnaire auprès des Amérindiens. Le temps semble n’avoir qu’aggravé son trouble et son angoisse. Depuis un an, il est aux prises avec « une grande affliction intérieure » qui l’a conduit au bord du désespoir. Mais, comme Chauchetière en viendra à comprendre les choses rétrospectivement, la rencontre de Catherine le transforme complètement. Quelque chose dans la sérénité de la mourante commence à atteindre le jésuite éperdu et centré sur lui-même, puis à le ramener des sombres profondeurs du doute.
Ce n’est pas ainsi que les choses auraient dû se passer. Il est le colonisateur qui s’adresse à la colonisée ; l’homme qui parle à la femme, le prêtre à la laïque, l’homme instruit à l’illettrée, l’être en santé à la malade, le civilisé à la sauvagesse : chaque aspect de leur rencontre le pousse à considérer Catherine comme inférieure à lui. Toute exemplaire qu’ait été sa conduite depuis sa conversion, elle demeure ce que les missionnaires se plaisent à appeler « une enfant dans la foi », encore dangereusement près de la nature et de cet environnement du Nouveau Monde pétri de péché. Lorsque les jésuites du XVIIe siècle brandissent l’Amérindien innocent et ingénu comme un reproche à l’égard des élégants pécheurs européens, leur stratégie rhétorique repose sur une hypothèse généralement acceptée selon laquelle le christianisme est la vérité absolue et les croyances indigènes, l’erreur. On croit que les idéaux de la vie urbaine, de l’ordre civil et des manières raffinées, tenus en haute estime en Europe depuis l’antiquité gréco-romaine, s’appliquent à l’ensemble de l’humanité. Cette conviction est profondément enracinée dans la culture et la mentalité de Chauchetière. Sa propre raison d’être, en tant que missionnaire, et, bien sûr, celle de l’ensemble de l’entreprise coloniale dont il est un rouage, relève d’une hiérarchie élémentaire : sur les plans religieux et culturel, les autochtones des Amériques ont besoin de l’aide, de l’encadrement et de la direction des chrétiens d’Europe.
Plus tard, Claude Chauchetière en arrivera à voir en Catherine sa supérieure en matière de spiritualité et à considérer sa rencontre avec elle comme un temps de transformation, mais au moment où il est assis dans la maison longue de Catherine, un observateur de passage ne verrait en lui qu’un jésuite de plus en train de rôder au chevet d’une Amérindienne malade, bientôt mourante. Un jésuite vivant et une autochtone mourante : un exemple parmi tant d’autres de la scène qui se joue au XVIIe siècle dans les tipis et les maisons longues de tout l’Est de l’Amérique du Nord.
La mort est l’un des grands thèmes de l’histoire de la mission des jésuites auprès des Amérindiens de la Nouvelle-France. Les dirigeants de la Compagnie de Jésus ont à l’origine conçu leur mission en Amérique du Nord comme une entreprise pour apporter la paix, le bonheur et la vie éternelle aux pauvres autochtones ; pourtant, les écrits des missionnaires du Canada se teintent rapidement d’une sensibilité morbide. Bien sûr, en bons chrétiens, tous les jésuites ont été formés au memento mori, cette pratique qui consiste à méditer sur la fragilité et sur la brièveté de la vie, afin de contrer la tendance naturelle à se laisser prendre par la futilité et la vanité du monde. Mais, dans cette Amérique déchirée par la guerre et décimée par la maladie, ils rencontrent la mort de tous côtés, non comme procédé imaginatif visant à élever l’esprit, mais comme réalité terrible inscrite dans les corps : des Indiens malades, blessés et mourants (l’Autre qu’ils étaient venu sauver, maintenant moribond) se présentent à tout moment sur leur chemin, alors que des récits de jésuites martyrisés (rappels de la vulnérabilité du moi corporel) les horrifient et les fascinent tout à la fois. Les épidémies et les affrontements violents qui accompagnent habituellement la colonisation ne sont jamais bien loin quand les missionnaires avancent au même rythme que la pénétration commerciale et impériale française le long du Saint-Laurent et jusque dans les Grands Lacs et la vallée du Mississippi. « Sans doute nous portions avec nous le malheur, admet le père Jérôme Lalemant, puisque partout où nous mettions le pied, ou la mort, ou la maladie nous suivait. »
En passant à travers des villages autochtones jadis prospères, soudain transformés en mouroirs et en charniers, les missionnaires s’empressent de baptiser les mourants. Quelquefois, ils essaient de guérir les malades en distribuant du sucre, des raisins et d’autres substances médicinales, mais leurs motifs sont franchement stratégiques ; il s’agit de gagner la confiance des Amérindiens et de battre à leur propre jeu les chamans adorateurs du Diable. Ce qui compte vraiment, c’est la moisson d’âmes. Pour un jésuite, chaque personne gravement malade est le prix d’un concours dont l’enjeu est le plus élevé qui soit : ou bien elle mourra hors de l’Église et sera plongée dans des tourments éternels, ou bien elle confessera ses péchés, entrera au bercail et vivra pour toujours dans le bonheur parfait. Sachant par expérience que les convertis bien portants s’écartent de la voie chrétienne une fois baptisés, ce qui représente une issue plus déplorable que le simple refus du baptême, les jésuites éprouvent une satisfaction particulière à baptiser les moribonds. Au début de l’histoire de la mission en Nouvelle-France, Jean de Brébeuf exprime des sentiments que d’autres jésuites du XVIIe siècle décriront à leur tour : « La joie qu’on a quand on a baptisé un Sauvage, qui se meurt peu après, et qui s’envole droit au Ciel, pour devenir un ange, certainement c’est une joie qui surpasse tout ce qu’on se peut imaginer : […] on voudrait avec la souffrance de dix mille tempêtes pouvoir aider à sauver une âme, puisque Jésus-Christ pour une seule âme aurait volontiers répandu tout son précieux sang. »
Si les adultes mourants sont particulièrement prisés, les nouveaux-nés le sont encore davantage, puisque, contrairement à leurs parents païens, ils sont trop jeunes pour avoir péché. « C’est le fruit le plus assuré que l’on cueille en ce pays », écrit un jésuite chez des Iroquois non convertis, « où il est à souhaiter que les enfants meurent avant l’usage de la raison ». Les bébés malades exercent un attrait irrésistible sur ces missionnaires, qui les cherchent partout sur leur chemin. Cependant, les parents non chrétiens du pays natal de Tekakwitha sont déterminés à garder leurs petits hors d’atteinte. Contrairement aux Hurons, évangélisés une génération plus tôt, les Iroquois ne croient pas nécessairement que le baptême cause la mort, mais ils ont certes le sentiment que les missionnaires désirent voler les âmes de leurs enfants. Peut-être perçoivent-ils quelque chose dans le comportement de ces hommes capables d’écrire : « Il est à souhaiter que les enfants meurent », énoncé qui donne froid dans le dos. Du point de vue des jésuites, cette résistance des parents est un défi qu’il faut surmonter grâce à la ruse ou à l’ingéniosité. Guettant le moment où un nouveau-né est laissé seul, ils s’arrangent parfois pour le baptiser subrepticement. Lorsque les adultes se mettent à organiser une garde jour et nuit autour de l’enfant, le père Jean de Lamberville décide de cacher dans sa manche un morceau d’éponge humide. Il demeure auprès d’une famille inquiète une journée entière et une soirée, attendant son heure ; puis, pendant que les adultes discutent de la fièvre du petit garçon, évaluant ses chances de guérison, le missionnaire sort sa main pour toucher le front du malade, tout en marmonnant à voix basse des paroles en latin. En se retirant, et pour expliquer pourquoi le front de l’enfant est humide, il déclare qu’il « avait une fièvre fort ardente et qu’il était tout en sueur ». Sachant que l’enfant est sur le point de mourir et que son âme sera bientôt avec le Christ, Lamberville sourit intérieurement devant cette victoire durement gagnée.
En passant en revue les réalisations des missions iroquoises de l’année, la Relation de 1679 rapporte qu’« ils ont mis au ciel plus de 200 âmes d’enfants, et d’adultes malades, tous morts après le baptême ». Bien sûr, les jésuites désiraient ardemment baptiser des personnes en bonne santé afin de poser sur terre les fondations d’une société autochtone catholique, tout en continuant de peupler le ciel par « dépôt direct ». Mais chaque fois que nous sommes tentés de considérer ces missionnaires uniquement comme des agents de l’assimilation culturelle européenne, il faut nous rappeler qu’ils avaient tendance à évaluer leur succès sur un tout autre plan.
La mort de l’Amérindien est l’un des thèmes majeurs des écrits des jésuites de Nouvelle-France ; tout comme la mort du missionnaire — réelle, anticipée, appréhendée et désirée. Avant même que le père Isaac Jogues devienne le premier martyr jésuite, lorsque les Agniers le tuent en 1646, les Relations des jésuites s’attardent sur les dangers de vivre dans un pays déchiré par la guerre, au milieu de peuples que leurs auteurs estiment « barbares ». Le Canada apparaît comme une terre de « croix », où les autochtones résistent au message de l’évangile et où les missionnaires doivent affronter des épreuves continuelles et le danger omniprésent d’une mort dans la souffrance, le sang et les flammes. Voilà ce qui le rend attrayant aux yeux des hommes enclins au mysticisme : une occasion de renoncer à soi-même pour participer aux souffrances du Christ. En 1633, au début de l’histoire des missions de Nouvelle-France, le père Paul Le Jeune, rendant compte du meurtre d’un Français par un Algonquin, fait remarquer : « Voilà comme nos vies sont peu assurées parmi ces Barbares : mais nous trouvons là-dedans une puissante consolation, qui nous met hors de toute crainte, c’est que mourant de la main des Barbares en venant procurer leur salut, c’est imiter en quelque façon notre bon Maître, à qui ceux-là même donnèrent la mort, auxquels il venait apporter la vie. » Quelque temps avant d’être brûlé, torturé et exécuté par les conquérants Iroquois, Jean de Brébeuf médite sur la mort dans son journal intime : « Je sens en moi un grand désir de mourir pour jouir de Dieu. Je sens une grande aversion de toutes les choses créées qu’il faudra quitter à la mort. C’est en Dieu seul que repose mon cœur. »
L’historien Philippe Ariès soutient que le christianisme européen de cette époque, dans sa version protestante comme dans la catholique, a engendré une nouvelle façon d’appréhender la mort et le fait de mourir. Alors que la culture chrétienne du Moyen Âge embrassait la vie et la chair, tenait la mort en horreur et cherchait plutôt à préparer les mourants à quitter la vie et tous ses plaisirs, la nouvelle sensibilité se caractérise par la présence envahissante de la mort dans la vie : « La mort est donc fondue dans l’être fragile et vain des choses tandis qu’au Moyen Âge elle venait du dehors. » Ariès brosse un portrait lugubre de cette sombre époque, soutenant que les auteurs religieux craignaient la vie et l’existence corporelle davantage que la mort et que leur mélancolie menaçait constamment de les entraîner au fond du précipice, dans le néant existentiel. Il est certain que Jean de Brébeuf a connu la tentation du désespoir, d’un désespoir devant lequel la mort est un soulagement. Claude Chauchetière, lui aussi, a connu des moments de désolation, durant lesquels sa vie lui a paru insensée et coupée de Dieu. L’un et l’autre trouveront dans la mort une issue à ce tourment intérieur : dans le cas de Chauchetière, c’est la mort d’une Iroquoise qui lui appo...