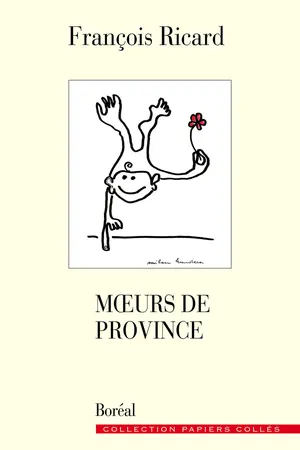Lettre à l’ami reparti
Mon cher L***,
Ainsi, vous êtes retourné vivre en France.
Ayant choisi de quitter Paris où vous habitiez depuis vingt-cinq ans et d’immigrer chez nous en bonne et due forme, vous aurez vécu à Montréal, tout près de nous, avec nous, pendant quatre belles années, vous intégrant à notre milieu d’une manière exemplaire, vous montrant constamment attentif à la vie et à la littérature d’ici, généreux de votre temps, ouvert, bâtissant de solides amitiés et nous faisant profiter, surtout, de votre culture, de l’infatigable vivacité de votre esprit, de votre rire, de votre présence à la fois stimulante et réconfortante, toutes choses dont nous ne vous remercierons jamais assez. Puis vous avez décidé de mettre fin à l’expérience. Je sais que vous n’avez pas pris cette décision de gaieté de cœur, mais votre départ m’a désolé, et vous me manquerez, vous me manquez déjà beaucoup.
Pourquoi étiez-vous venu vous établir ici, je ne l’ai jamais très bien compris. À l’époque où vous prépariez votre immigration, vous vous en souvenez, je vous prévenais : Montréal est une ville agréable, certes, le Québec est une terre accueillante, la vie y est calme et gentille, les gens sont adorables, nos tempêtes de neige superbement poétiques, et l’activité culturelle est un feu roulant de fêtes et de spectacles ; mais au point de vue intellectuel, ou en fait de vie littéraire, c’est le désert ou presque. Au début peut-être, cette tranquillité aurait pour vous quelque chose d’édénique, vous reposant de la foire parisienne dont vous me disiez tant de mal, vous donnant le sentiment de vous trouver dans un milieu moins frivole et plus authentique ; mais à la longue, tout cela risquerait de vous ramollir, de vous envelopper dans une sorte de demi-coma bienheureux et de vous rendre plus ou moins semblable à nous, provinciaux repus et indolents, habitués à se satisfaire de peu et à vaincre sans péril. J’exagérais un peu, évidemment, histoire d’éprouver votre résolution et de vous faire réfléchir. Mais votre confiance était plus forte que mes craintes et vous avez tenu bon, ce dont je vous ai su gré, car en venant vous établir chez nous, vous me forciez en quelque sorte à me réconcilier avec mon propre milieu et à le voir d’un œil moins déprimé. Mais il reste que je n’ai jamais été parfaitement convaincu de la justesse de votre choix – je veux dire : de sa justesse pour vous, car pour nous, votre présence parmi nous était et n’a jamais cessé d’être une bénédiction.
C’est pourquoi, je peux vous l’avouer maintenant, si votre retour en France me chagrine, il ne me surprend pas vraiment, puisqu’il confirme d’une certaine manière, à mes yeux, ce que je vous avais dit de mon pays (auquel pourtant je suis foncièrement, passionnément attaché) et de ma société (pour laquelle je n’éprouve pas du tout le même attachement, je dois dire). Je ne vous demande pas si j’avais tort ou raison de vous mettre en garde, ni pour quelles raisons vous avez décidé de repartir, car vous me répondriez que ce sont des raisons avant tout professionnelles, et je vous croirais, bien sûr, même si je soupçonne qu’il y a peut-être, qu’il y a probablement autre chose… Quelque chose que vous ne souhaitez pas me dire, parce que l’amitié, la discrétion ou la simple politesse vous en empêchent. Et au fond, il est sans doute préférable qu’il en soit ainsi.
Aussi, cher ami, au lieu de vous demander pourquoi vous êtes reparti, j’aimerais plutôt que vous me rappeliez un peu pourquoi vous étiez venu. Qu’aviez-vous en tête – et dans le cœur – lorsque vous avez formé la résolution, après plus d’un quart de siècle de vie et de travail à Paris, de rompre avec tout ça et de vous embarquer pour notre beau Québec ? Pourquoi nous aimiez-vous au point de vouloir si fort vous établir chez nous ? Cela nous ferait du bien de le savoir.
À moins que vous ne préfériez que nous bavardions de choses et d’autres, comme les « accommodements raisonnables » (ce débat burlesque auquel vous avez eu droit pendant votre séjour et qui repart maintenant de plus belle). Ou encore, si vraiment vous êtes prêt à tout, on pourrait discuter du réchauffement de la planète et du refroidissement de nos âmes.
En tout cas, tâchons de garder le contact.
Salut et fraternité (comme disait Péguy).
P.-S. – Depuis votre départ, je redécouvre une chose que votre présence et votre esprit si authentiquement cosmopolite m’avaient un peu fait oublier, soit le provincialisme du petit milieu dans lequel je vis. Ou plutôt, ce que j’appellerais son néoprovincialisme, car il s’agit d’une forme de provincialisme qu’on ne voyait guère autrefois, ni ici ni ailleurs, mais dont le monde actuel a permis l’éclosion et offre un grand nombre d’exemples, ici comme ailleurs. Jadis, on disait que la province, par rapport à la capitale, était plus conservatrice, plus guindée, réfractaire aux nouveautés et aux expériences, et toujours plus ou moins en retard, avec son attachement au sol, au passé, à ce que Michelet appelait ses « préjugés envieillis ». Dans les provinces, notait Stendhal, « tout va lentement, tout se fait peu à peu, il y a plus de naturel ». Aux yeux des métropolitains, cette lenteur était généralement un objet de moquerie ou de pitié. Mais voilà que la vieille opposition s’est inversée, et que c’est maintenant la province, ce sont maintenant les sociétés plus ou moins éloignées du centre et sans grande influence sur le reste du monde qui incarnent le mieux l’avant-garde. On pourrait même dire qu’elles sont l’avant-garde de toutes les avant-gardes, dans la mesure où les idées nouvelles, loin d’y rencontrer la résistance têtue de jadis, y sont accueillies au contraire avec un enthousiasme (parfois appelé courage ou audace) et une unanimité qu’on ne voit guère au même degré dans les sociétés où ces idées, la plupart du temps, ont été inventées. La province, autrefois, souffrait du complexe de l’arriéré, du démodé. Elle est devenue aujourd’hui le terrain par excellence de l’innovation et de la rupture avec le passé, et c’est par là qu’on pourrait le mieux la définir, je crois : la province est le lieu où les idées nouvelles fleurissent et se réalisent avec le moins de retenue, de la manière la plus péremptoire et la plus assurée qui soit, favorisées par le besoin général (c’est-à-dire l’obligation) d’aller toujours plus vite, de se trouver toujours en avance, émancipé, libre de tout ce qui pourrait ressembler à un tabou ou à une hésitation, et prêt à toutes les aventures, surtout dans le domaine moral et symbolique. C’est un peu tout cela, d’ailleurs, qui fait les petits et grands bonheurs de la vie de province…
Praline et les hassidim
Je voudrais proposer aux faiseurs de dictionnaires l’introduction dans notre belle langue française de deux mots nouveaux, aux sens voisins mais différents : murayen (ou murayien ; j’hésite encore sur l’orthographe) et murayesque. Le premier, qui s’emploierait uniquement comme adjectif, renverrait soit à la singularité des livres de Philippe Muray (on parlerait du style murayen, de l’humour murayen, voire de l’œuvre murayenne), soit, dans un sens plus large, à un certain regard sur les choses, à une certaine attitude de l’esprit et de la sensibilité dont les écrits de Muray offrent jusqu’ici l’unique exemple. Dire de quelqu’un qu’il a une vision murayenne du monde, ou d’un livre qu’on y perçoit des accents murayens, ce serait dire de l’un ou de l’autre que sa manière de considérer l’existence ou la société se caractérise par une lucidité impitoyable, le refus de toute compromission comme de tout attendrissement, un mépris souverain de toutes les formes de bêtise, et surtout un humour aussi irrésistible que dévastateur. Mais il est à craindre, dans le monde où nous sommes et où Philippe Muray n’est plus, que ce mot ne tombe rapidement en désuétude.
Ce qui n’est pas du tout le cas du vocable murayesque, promis au contraire à un très bel avenir. Formé sur le modèle de quelques autres termes maintenant admis par l’usage, comme « dantesque », « moliéresque », « donquichottesque », « ubuesque » ou même « rocambolesque », ce nouveau mot pourrait s’employer aussi bien comme adjectif (« Cette scène est murayesque ») que comme substantif (« Le murayesque n’est pas absent de cette scène »). En guise de définition, je proposerais ceci : Digne de figurer dans un roman, un essai ou un poème de Philippe Muray. Le murayesque, en d’autres mots, désignerait cette catégorie de l’existence et de la société contemporaines dont l’auteur de L’Empire du Bien, des Exorcismes spirituels et d’Après l’histoire a été le découvreur et l’infatigable explorateur. On pourrait donc dire, pour formuler autrement notre définition et en faire voir l’extension quasi illimitée : le murayesque, c’est, dans le monde qui nous entoure, ce qui déclencherait la verve et l’hilarité de Philippe Muray.
Mais trêve de généralités. Rien ne vaut une illustration concrète pour bien saisir le sens d’un mot. En voici une :
Soit une grande ville multiculturelle d’Amérique du Nord. Pour faire court, appelons-la Montréal. Soit, dans cette ville comme dans toutes les villes multiculturelles du monde, un gymnase situé au milieu d’un quartier dans lequel le nombre d’artistes ou d’intellectuels par kilomètre carré, la quantité de livres par appartement et le niveau de conscientisation idéologique (donc d’agnosticisme) sont parmi les plus élevés de la ville. Dans ce gymnase, deux ou trois fois par semaine, des clients, très majoritairement de sexe féminin et dont la moyenne d’âge avoisine les cinquante ans, viennent suer sang et eau en répétant pendant des heures des mouvements qui n’ont aucune utilité dans la vie, comme pédaler à fond de train sur des vélos immobiles, courir sur des tapis qui roulent en direction inverse de leur course, soulever et abaisser des poids qui reprennent aussitôt leur position initiale, ou chevaucher toutes sortes d’appareils compliqués qui n’ont d’autre fonction connue que d’être chevauchés. Elles disent, les usagères du gymnase, qu’elles font cela pour des raisons de santé, histoire de garder la forme, d’assouplir les muscles, d’améliorer le cardio, bref, d’être mieux dans leur peau et, ainsi, de rester des citoyennes productives, aimables et autonomes. Mais il ne faut pas être grand clerc pour comprendre que ce qui motive aussi leurs gesticulations, ainsi que les autres souffrances volontaires que s’infligent tant d’autres femmes du même âge, comme le jeûne, l’épilation par électrolyse ou les chirurgies plastiques, ce sont au fond des choses aussi simples et peu branchées que le désir de maigrir et la nécessité de raffermir des chairs en voie d’affaissement accéléré, c’est-à-dire le besoin de rester belles et désirables malgré les ans. On ne saurait le leur reprocher, bien sûr, d’autant que ces efforts, la plupart du temps, restent vains, ce qui les rend encore plus méritoires.
Mais revenons à notre ville multiculturelle. Soit, donc, juste à côté dudit gymnase dont il n’est séparé que par une ruelle large d’à peine cinq mètres, un bâtiment servant à la fois de synagogue, de lieu de rencontre et de salle d’étude pour la communauté hassidique des environs, une communauté liée au courant dit Satmar, lequel se distingue par son refus acharné du changement et une méfiance inconditionnelle à l’égard des idées et des mœurs modernes, que celles-ci soient le fait de Juifs ou de gentils. Établie dans le quartier depuis des générations, cette communauté réussit à vivre dans une autarcie presque complète, fermement repliée sur elle-même et contente de son sort. Il s’est établi entre elle et son voisinage non hassidique une sorte d’entente cordiale basée sur ce que des édiles vertueux appellent respect ou tolérance, mais qui est en fait une parfaite ignorance mutuelle, exempte de part et d’autre de toute hostilité (au moins déclarée) comme de toute velléité de rapprochement. Pendant que la vie du quartier, autour des hassidim, bat son plein comme si ceux-ci n’existaient pas, on les voit, eux, vêtus comme des nobles polonais du dix-neuvième siècle, coiffés de leur shtreimel d’où pendent les péote soigneusement frisées, se diriger tranquillement vers la synagogue, accompagnés de leurs épouses au port modeste et de leur innombrable et pâle progéniture, faisant eux aussi comme si le monde qui les entoure n’existait pas. Quand un hassid croise un goy, il baisse la tête ou regarde ailleurs ; et le goy fait de même. Dans son for intérieur, sans doute, chacun déplore la vie et l’allure de l’autre, mais n’en dit mot, sauf à ses proches. Entre les deux communautés, celle des hassidim et celle des citoyens modernes, la pa...