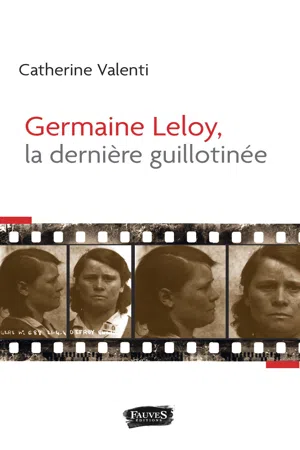![]()
1.
Une France marquée par la guerre
L’affaire Leloy se déroule entre le 10 décembre 1947, jour où Germaine Leloy ôte la vie à son époux, et le 21 avril 1949, date de son exécution à la prison d’Angers. En cette seconde moitié des années 1940, la France n’en a pas encore fini, loin de là, avec les conséquences du second conflit mondial. Si la plus grande partie du territoire français a été libérée à la fin de l’été 1944, si la guerre est officiellement terminée depuis le 8 mai 1945, ses stigmates sont cependant encore largement présents dans la vie quotidienne des Français.
Un difficile retour à la démocratie
Au plan politique tout d’abord, le rétablissement de la démocratie, après la parenthèse du régime de Vichy, s’est avéré compliqué. Alors qu’en 1944-45, l’atmosphère était encore à l’union nationale, le climat politique s’est rapidement dégradé, et l’illusion lyrique des premiers mois qui ont suivi la Libération a cédé la place au retour des affrontements politiciens. Les Français ayant massivement rejeté, en octobre 1945, l’hypothèse d’un retour pur et simple à la Troisième République, une assemblée constituante s’est mise en place. Elle est dominée par les trois grandes forces politiques issues de la Résistance : le Parti communiste, la SFIO et le MRP.
Les relations entre la Constituante et le chef du gouvernement provisoire de la République, le général de Gaulle, sont très vite assez mauvaises. De Gaulle, nouvel homme fort du pays, auréolé de son rôle dans la Résistance extérieure, est partisan d’un renforcement du pouvoir exécutif, et s’oppose à la vision parlementaire qui domine alors largement au sein de l’assemblée constituante dont les députés ont commencé à travailler sur un projet constitutionnel. Le 20 janvier 1946, pensant provoquer un électrochoc, le général de Gaulle a démissionné de ses fonctions à la tête du gouvernement : il espère créer dans le pays un vaste mouvement d’opinion, qui le rappellerait au pouvoir et lui permettrait dès lors d’infléchir les décisions de l’assemblée.
Mais son espoir est déçu : s’ils sont majoritairement désappointés par son départ, les Français ne se soulèvent pas pour autant, et le général entame alors une longue traversée du désert. La Constituante a désormais le champ libre pour élaborer une nouvelle constitution. Elle accouche d’un premier projet qui prévoit l’existence d’une Chambre unique qui concentrerait l’essentiel des pouvoirs. Mais le MRP est hostile à cette formule, et les Français la rejettent à 53 % par référendum le 5 mai 1946. Une seconde assemblée constituante est donc désignée, qui élabore un second projet, résultat cette fois d’un compromis entre SFIO et MRP. Ce projet est adopté de guerre lasse par les électeurs au mois d’octobre 1946.
Le nouveau régime qui entre alors en vigueur, celui de la Quatrième République, ne suscite guère l’enthousiasme des foules, car il paraît n’être qu’une Troisième République-bis : « un président élu par les deux Chambres et qui n’a guère de pouvoir autre que de nommer le président du Conseil, et une Chambre des députés souveraine qui investit le gouvernement, peut le renverser et l’interpeller (motion de censure) quand bon lui semble. » Bon an mal an, la démocratie a néanmoins été rétablie en France, et Vincent Auriol, ancien résistant, est élu à la présidence de la République le 16 janvier 1947.
Les conséquences socio-économiques de la guerre
Si les villages du Maine-et-Loire, comme l’ensemble de la France rurale, ne sont sans doute guère intéressés par la question des institutions et les soubresauts de la politique nationale, les conséquences socio-économiques de la guerre s’y font néanmoins largement sentir, comme sur tout le reste du territoire. A la fin du premier conflit mondial, seuls les départements du nord-est de la France, théâtre des combats ou lieux de l’occupation allemande, avaient souffert des ravages de la guerre. A l’issue du conflit de 1939-1945 en revanche, les destructions « sont beaucoup plus diffuses et se prolongent jusqu’aux principales infrastructures, volontairement endommagées à l’extrême fin du conflit, par un camp ou l’autre, le plus souvent pour des raisons stratégiques (4 000 ponts fluviaux, 7 500 ponts routiers, 115 gares, 1 900 ouvrages d’art, 22 000 km de voies de chemin de fer). » Partiellement puis totalement occupée par l’ennemi à partir de novembre 1942, la France tout entière a été affectée par les conséquences du conflit.
La vie quotidienne est de plus rendue très difficile, à la fin des années 1940, par le maintien des restrictions alimentaires, qui se poursuit bien au-delà de la fin du second conflit mondial. Instaurée le 1er juillet 1941, la première carte de rationnement concernait les produits textiles ; un mois plus tard, c’était au tour du tabac de faire l’objet d’une mesure similaire ; à la fin de l’année 1941, tous les produits alimentaires étaient désormais concernés. Or la France, ruinée par la guerre, peine à retrouver après 1945 les niveaux de production qui étaient les siens avant 1939. La « carte de pain », qui avait été supprimée en mai 1945, a dû être rétablie en décembre de la même année, alors même que le pain reste l’aliment de base des Français. Les pénuries sont toujours massives, et les tickets de rationnement restent en place, au grand dam de l’opinion qui aspire à un rapide retour à la normale.
La presse régionale et nationale se fait l’écho, tous les jours ou presque, de l’évolution de la situation sur le front des restrictions alimentaires. Le quotidien Le Monde y consacre ainsi régulièrement des articles. Le 21 mars 1946, le journal répercute l’initiative d’Henri Longchambon, ministre du ravitaillement, qui étudie un projet de retour à la liberté de vente des œufs : « Néanmoins, afin de protéger la classe la plus défavorisée de la population contre la hausse des prix que cette mesure entraînerait, le ministre envisage un “rationnement social” qui assurerait une distribution minimum, à un prix fixé, pour un ou deux dixièmes des consommateurs qu’on appelle au ministère “les économiquement faibles”. Ce régime de quasi-liberté serait appliqué aux autres denrées au fur et à mesure du retour de l’abondance. » Mais le retour de l’abondance se fait attendre, et les restrictions se poursuivent encore pendant plusieurs années.
La situation commence progressivement à s’améliorer à partir de la signature par la France du plan Marshall, le 3 avril 1948, et l’octroi par les Etats-Unis de 2,7 milliards de dollars. En mars 1949, Le Monde hésite cependant à se réjouir : « Le secrétaire d’État aux affaires économiques, M. Pinay, a annoncé hier à l’Assemblée nationale des nouvelles alléchantes. Voici, d’après le compte rendu analytique, quelles ont été ses paroles : “La liberté ne peut être rendue que lorsque la production est suffisante. Elle va sans doute être donnée à partir du 1er avril aux voitures automobiles, au verre à vitres, aux textiles et aux produits laitiers.” » La prudence est de mise, car les espoirs ont souvent été déçus : « L’homme dans la rue se demande s’il n’en sera pas une fois de plus pour sa courte joie. » C’est finalement le 1er décembre 1949 que disparaissent les derniers tickets de rationnement encore en vigueur sur le sucre, le café et l’essence.
Seul le programme économique et social du Conseil national de la Résistance, qui commence à être mis en place dès 1945, peut donner quelque espoir aux populations : ce sont les débuts de l’Etat-providence, concrétisés par l’instauration emblématique, en octobre 1945, de la Sécurité sociale. Il n’est pas sûr cependant que sa création ait immédiatement changé la vie des Français, notamment ceux qui vivaient en dehors des villes. Par bien des aspects, la France rurale de la fin des années 1940 a peu évolué depuis l’entre-deux-guerres, voire depuis le XIXe siècle. A la campagne, la vie est parfois difficile, le confort souvent sommaire. Si l’après-1945 est marqué par un recul de l’activité agricole, cela n’est pas encore sensible dans les années qui suivent immédiatement la fin du conflit.
Les Leloy, un couple de petits commerçants
Le couple Leloy appartient pleinement à cette France rurale, celle des petits paysans, mais aussi des petits artisans et commerçants. Albert et Germaine Leloy ont d’abord été de petits exploitants agricoles. Après leur mariage en 1937, ils co-exploitent pendant quelques années la ferme des parents d’Albert à Montigné-les-Rairies, village de 400 habitants environ situé à une quarantaine de kilomètres au nord-est d’Angers. Leur situation est alors assez classique : c’est celle d’un jeune couple qui n’a pas encore les moyens de s’établir à son propre compte, et exploite en commun la ferme familiale où plusieurs générations cohabitent sous le même toit. Il semble que le couple ait ensuite quitté la ferme parentale pour s’employer pendant un an ou deux comme domestiques agricoles : leur patron de l’époque sera interrogé au moment de l’enquête. En 1944, Germaine et Albert Leloy s’installent dans leur propre ferme, située à Baugé, mais l’exploitation ne rapporte pas suffisamment et ils ont du mal à joindre les deux bouts, ce qui les incite à changer d’activité.
En décembre 1946, grâce à un emprunt bancaire de 400.000 francs, le couple achète un fonds de commerce de bois et charbons. Situé à Baugé, il appartenait à un sieur Coutard qui souhaite se retirer des affaires et le cède aux Leloy. Ces derniers font également l’acquisition d’un camion américain destiné à assurer les livraisons, et conservent le jeune commis employé par Coutard, Raymond Boulissière, qui seconde Albert dans ses tournées. Ainsi Albert Leloy n’est-il pas un « bûcheron », contrairement à ce qu’indiqueront différents journaux une fois que le crime aura été perpétré et que l’affaire aura éclaté, mais bien un commerçant, qui vend un produit vital à une époque où, dans la plupart des foyers ruraux, on se chauffe encore au bois ou au charbon.
Germaine pour sa part ne se contente pas du rôle passif de femme au foyer, d’autant plus que le couple n’a pas d’enfants : si elle ne participe pas aux livraisons, elle aide son mari à charger et décharger bois et charbon, n’hésitant pas à mettre la main à la pâte pour faire fonctionner la petite entreprise. Sans être dans la gêne ‒ ils possèdent un camion, et ont les moyens de salarier un commis ‒, les Leloy sont cependant loin d’être des nantis. Ce sont d’anciens fermiers, qui comme beaucoup, n’ont pas réussi à vivre du produit de la terre et se sont reconvertis dans le commerce. Le logement qu’ils occupent est des plus modestes : sise dans la partie nord de Baugé, au carrefour des rues Jean Georges, Marthe de la Beausse et Lofficial, leur maison est la dernière du village avant le cimetière. Elle est composée d’une seule pièce en rez-de-chaussée, de petites dimensions ‒ 15 m2 environ ‒ qui sert à la fois de chambre, de salon et de cuisine, les WC se trouvant dans un petit débarras attenant. Leur cadre de vie est semblable à celui de millions d’autres Français à la même époque, dans un pays où la population urbaine a dépassé la population rurale seulement une vingtaine d’années auparavant.
C’est ce couple de Français très moyens, semblables à des centaines de milliers d’autres, qui va se retrouver propulsé sur le devant de la scène locale par les effets d’un fait divers sordide mais, lui aussi, tristement banal.