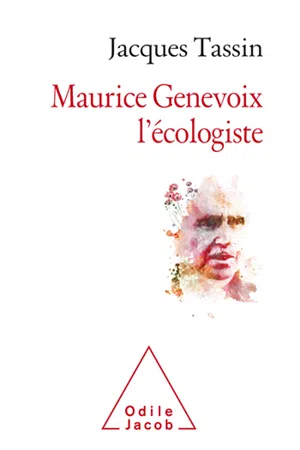Le message de Genevoix est plein d’espoir : la clé de notre salut est entre nos mains. Mais cette clé ne peut ouvrir de portes que si nous restons du côté de la vie. L’écologie ne peut plus se cantonner aux réflexions qu’imposent les technosciences et l’économie. Nous ne pouvons plus nous satisfaire d’une écologie à distance, froide, excessivement rationnelle. Nous avons besoin d’une écologie de la joie. C’est ce qu’en substance, nous proposait déjà Genevoix, dont le prix Goncourt Raboliot, exultation prémonitoire du sentiment de nature qui s’empare de nous aujourd’hui, aura bientôt cent ans…
Il suffit du mal-être de la vie citadine puis, brusquement, d’une pandémie inattendue, pour nous ramener à notre corporéité et à notre insertion dans la toile du vivant, à ces réalités d’un monde tangible, d’un monde d’en bas. Notre esprit a beau nous retenir à distance des réalités terrestres, notre corps nous y ramène. Cette réincorporation de notre existence procède d’un réancrage organique et sensible qui, année après année, creuse son sillon. Le principe de réalité nous invite à ne plus rester décollés du concret, perdus dans les nuées des mondes idéels, et à ne plus considérer l’écologie comme une manière d’être ou de dire, mais comme une manière de faire et d’éprouver. Il s’agit de s’en remettre, semblait souffler Genevoix à l’oreille de ses lecteurs, une véritable écologie du désir.
Cela étant, il n’existe jamais de modèle absolu extérieur à nous-même. Tout comme L’aventure est en nous1, titre de l’un des nombreux ouvrages de Genevoix, l’écologie est aussi en nous. Aussi ne pouvons-nous tenir pour modèle absolu la manière de cet écrivain d’avoir été au monde et de l’avoir pensé. S’il s’affirmait terre à terre, les pieds dans la glèbe, enfoncés dans le terroir, cet écrivain dit naturaliste n’a lui-même jamais revendiqué de modèle, ni même d’adhésion aux mouvements et aux représentations de l’écologie, encore moins d’en être une icône ; d’autant qu’à son époque, ce terme était encore peu utilisé. « Je plaide ? Je me défends de l’avoir jamais fait2 », prévenait, à l’encontre de toute tentative de récupération de son œuvre, celui qu’indisposaient l’idéologie et le prosélytisme. Les pages qui suivent n’ont pas davantage vocation de récupérer le personnage de Genevoix, mais de le présenter sous un jour peu connu, peut-être même inattendu tant cet écrivain est inlassablement renvoyé à son témoignage de guerre et à son étiquette régionaliste.
Au reste, Maurice Genevoix n’affectionnait guère les néologismes, pas même celui d’écologie (du grec oikos, « maison », et logos, « science ») que le biologiste allemand Ernst Haeckel forgea en 1866 pour désigner les conditions d’existence du vivant. De fait, ce terme n’apparaît nulle part dans son œuvre. Genevoix voyait cela plus simplement. Il n’aimait rien tant que ce qui anime le monde et lui confère une âme. L’ancien officier de 1914 se prolongeait d’autant mieux en chaque être qu’il y avait perçu, par-delà le foisonnement des formes de vie, une manifestation unifiée de la mort. C’est par elle que se dévoile l’universalité de la vie, écrivait-il dans les Routes de l’aventure : « La grande “ombre” dont parlait Homère, on peut la reconnaître aux prunelles d’une perdrix qu’on ramasse, une goutte de sang au bout du bec, comme je l’ai reconnue tant de fois, à l’instant où le regard s’en va, dans les yeux des jeunes soldats tués3. » La vie est diverse, mais la mort est une.
Au lendemain du décès de l’ancien secrétaire perpétuel de l’Académie française, Valéry Giscard d’Estaing, alors dans la dernière année de son mandat de président de la République, adressait à la veuve Suzanne Genevoix et à ses filles Sylvie et Françoise un télégramme touchant. Le « meilleur ambassadeur » de la langue et de la culture françaises y apparaissait aussi comme « le premier de nos écologistes4 ». Mais s’il était le premier d’entre eux, alors faut-il ajouter qu’il l’était autrement.
Il était en effet, bien au-delà de l’étiquette désuète de chantre de la nature qui lui est conférée, un homme entièrement voué à la joie d’être vivant et de participer du monde vivant. Il n’y a d’autre devoir, écrivait Diderot, que celui d’être heureux. Genevoix l’était par nature. Il se dépeignant lui-même comme un homme qui « n’a cessé de porter en lui le sentiment pathétique de la vie, de la merveille qu’est la vie, de la richesse du monde, qui nous est quotidiennement donné5. » Au terme d’un brillant parcours de normalien, mutilé dans sa chair et dans son âme lors de la Grande Guerre, puis atteint en décembre 1918 de la grippe espagnole, enfin rendu aux rives de la Loire où il était né et avait grandi, Genevoix avait reconnu, dans les dispositions les plus simples conduisant à « admirer, comprendre et aimer6 », dans ces accords secrets qui nous unissent à la Terre, les plus essentielles des joies qui s’offrent aux hommes, de même qu’une « source intarissable de poésie7 ».
Ce n’était pas là renoncer aux forces de l’intellect et aux grandeurs de l’esprit, mais les dompter pour mieux les ajuster à notre constitution vivante. Genevoix avait ainsi inauguré la fin des grands partages, la sortie de cette modernité qui creusait de larges et dangereux fossés entre nature et culture, vie et mort, humain et animal, sauvage et domestique8. Il se manifestait en lui, selon l’aphorisme de Jean d’Ormesson, une coexistence « de l’homme de la nature et de l’homme de culture9 », expression qui n’est pas sans rappeler l’épitaphe gravée sur la tombe de Rousseau : « Ici repose l’homme de la nature et de la vérité. » Le champion universitaire dont parlait Kessel, normalien cacique de sa promotion, lauréat du Goncourt, précoce défenseur de la culture française, demeurait ancré à la nature. Et s’il n’a jamais fait de politique, c’est sans doute parce qu’à ses yeux, cet art de la citoyenneté aurait dû s’élargir à l’ensemble des lieux qu’occupent les formes du vivant par-delà les villes et les États, des terroirs à la Terre.
Aimer assez la vie pour l’aimer aussi chez les autres
Né en 1890, issu d’une famille où abondaient les pharmaciens, l’élève de Châteauneuf-sur-Loire était prédestiné à une carrière médicale ou paramédicale. Il était familier du vocabulaire s’y rattachant et s’intéressait à l’organisation du corps humain. Mais les postures de la science d’alors s’accordaient mal à son regard sur le monde, porté par une sensibilité peu commune, même s’il ne lui échappait pas que depuis Darwin, le mouvement des sciences tendait à réinscrire l’homme dans le cadre de la nature.
S’il ne dénigrait pas la démarche scientifique, il lui reprochait son recours trop exclusif à la raison, ses certitudes et son aplomb. Il ne se satisfaisait pas de la prise de distance certes nécessaire à l’objectivité scientifique, mais maladroite et myope lorsqu’il s’agissait de se pencher sur le vivant. Il ne lui échappait pas non plus, devenu secrétaire perpétuel, que les donations et les dotations allaient bien davantage du côté des sciences, notamment de l’Académie des sciences, que de la littérature10. Il ne pouvait alors se douter qu’aujourd’hui, cette même académie serait largement desservie au bénéfice de la recherche scientifique privée.
S’il faut raison garder, c’est donc qu’il faut aussi la surveiller. Et s’il faut demeurer raisonnable, alors faut-il aussi se montrer maisonnable11, faire véritablement de l’oikos grec notre maison, et de l’écologie un art d’habiter le monde. Mais celle-ci n’en a pas vraiment pris le chemin : comme l’observe le philosophe Emanuele Coccia, l’écologie et l’économie sont des jumelles siamoises qui partagent les mêmes concepts et les mêmes cadres épistémologiques12. Il n’a pas davantage échappé à Maurice Genevoix que l’écheveau des relations qui structure le vivant disconvient à l’ordre de la quantification : « Ainsi, la vie des créatures libres tend-elle, en dépit de l’homme, vers un équilibre qui échappe aux statistiques et aux calculs13. » La vie est irréductible au nombre.
Faut-il en déduire que tournant le dos à une carrière scientifique pour répondre à une vocation de poète, Genevoix ne nous proposait qu’une vision décalée de réalités trop magnifiées et esthétisées ? Ce serait ne pas comprendre le terme de poète qu’il revendiquait, non pas comme faiseur de vers ou rêveur d’autres univers, mais comme doté d’une intuition de l’invisible. La poièsis est autant création que révélation. Elle ne s’oppose pas à la science mais la complète. C’est parce qu’il s’affirmait comme étant de ceux pour qui un monde existe en dehors de soi que Genevoix se disait poète. Il avait, par-delà le sentiment d’immersion au monde, d’appartenance au continuum du vivant, le goût inné de la convivialité et du devenir ensemble, aspiration que partagera la zoologue et philosophe Donna Haraway14.
« C’est la mort qui a levé le voile », confia-t-il à Jacques Chancel lors de l’émission Radioscopie du 20 février 1969. Car sur le front de la Meuse où il combattit de septembre 1914 jusqu’à sa triple blessure du 25 avril 1915, deux balles entrant dans son bras gauche désormais mutilé, une autre dans sa poitrine, la vie flamboyait comme en contrepoint de la mort. L’une et l’autre s’y côtoyaient selon des appartenances mutuelles, moins en dissemblance qu’en harmonie, de sorte que la découverte des réalités insondables de la mort révélait, dans le même temps et dans la même mesure, d’équivalentes réalités de la vie.
Et si la guerre destructrice emportait dans son mauvais souffle les hommes, les chevaux et les arbres, il subsistait toujours, accessibles aux sens et au cœur, la déclamation d’un loriot, l’éclosion d’une anémone au revers d’un trou d’obus, le faufilement furtif d’un troglodyte sous un buisson, ou l’étreinte de deux cantharides indifférentes au feu déversé du ciel. Ces êtres, Genevoix les connaissait depuis l’enfance. Il les avait accueillis et conservés, intacts, dans les limbes de sa mémoire. Il les avait ainsi durablement contemplés et aimés : ainsi en était-il d’un officier qui « aime assez la vie pour l’aimer aussi chez les autres15 ».
Son récit de guerre est parsemé d’évocations d’êtres qui souffrent et ne sont pas toujours des hommes. Ce sont ces chevaux qui agonisent comme dans La Boue : « Plus poignant que ces plaintes humaines, le hennissement d’un cheval pantelait sous les étoiles16. » Ce sont ces chats faméliques qui se traînent aux abords des tranchées, le bétail égaillé jusqu’au cœur des villages, la petite chouette du clocher de l’église en ruine des Éparges, qui adjoint sa détresse à celle des soldats. Mais les arbres souffrent aussi. Et sous les lèvres du valet de chien Brout, dans Forêt voisine, Genevoix dépeint la dévastation d’une forêt prise sous les assauts de la guerre : « J’ai vu l’obus éclater au plein fût des hêtres, de grands beaux arbres lisses d’écorce qui éclataient avec l’obus et dont le cri était terrible. Bientôt, autour de la tranchée, il n’y avait plus de futaie : rien que des coutons d’arbres fracassés à mi-hauteur, et le flanc déchiqueté des cassures qui rougissait à l’air et à la pluie. Et les canons frappaient toujours, fouissaient du boutoir aux racines, arrachaient les souches par lambeaux17. »
Aveugle, la guerre ne distingue pas les êtres vivants les uns des autres. Clairvoyant, Genevoix ne les différencie pas davantage.
Du moins, s’il refuse de dissoudre entièrement l’homme dans la nature, il revendique une appartenance commune. Son regard sur les plantes, et pas seulement sur les arbres, se manifeste des décennies avant que la biologie végétale considère le végétal comme inscrit dans le même phénomène de la vie sur Terre, phénomène qui se poursuit au sein des lignées descendantes d’une même cellule originelle, en vertu duquel tous les êtres vivants sont apparentés les uns aux autres. Se montrer autant attentif aux arbres au cœur même de la guerre, et souffrir avec eux lorsque les obus les déchirent, comme le révèlent aussi plusieurs passages de Ceux de 14, relève d’un avant-gardisme étonnant. On sait qu’il a fallu attendre la fin des années 2010 pour que l’arbre soit considéré puis popularisé, avec La Vie secrète des arbres de Peter Wohlleben, comme une figure sensible du vivant. Genevoix, lui, n’avait pas attendu.
Habiter la Terre
Maurice Genevoix se gardait de toute théorie, chapelle ou idéologie. Il plaçait la vie avant l’homme, et loin devant l’idée ; non pas selon une hiérarchie de valeurs risquant de conduire à une forme d’écocratie, mais en reconnaissance du primat de cette vie dont nous sommes animés. Il faisait sienne la tirade de Shakespeare : « Il y a plus de choses sur la terre et sous le ciel, Horatio, que n’en peut rêver votre philosophie18. » Ce n’est pas par l’esprit que l’on entre au monde mais par l’engagement de tout son être, au fil d’une expérience sensible qui se vit « à hauteur d’homme ».
Pour être entré à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, y avoir fréquenté les esprits les plus éclairés et en être sorti au plus haut rang, Genevoix fut en mesure de poursuivre ses réflexions pa...