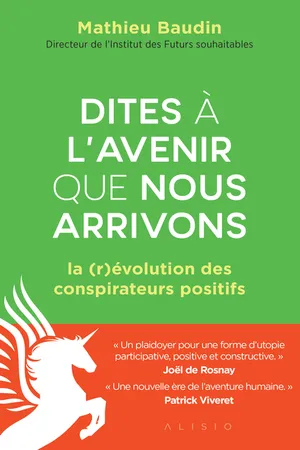L’ART D’IMAGINER LE FUTUR
Depuis toujours, l’humanité a essayé d’anticiper le futur, ne serait-ce que pour éviter de le subir.
La Pythie de Delphes qui, dans l’Antiquité, rendait ses oracles au pied du mont Parnasse, nous rappelle combien jadis le futur était important. Prophétesse, elle donnait des éléments de réponse à celles et ceux qui la consultaient. Notre langue porte d’ailleurs encore la trace de la difficulté de l’exercice… Ne dit-on pas d’un propos qu’on ne comprend pas, dans une discussion, une table ronde ou un débat télévisé, qu’il est « sibyllin » ? Or, les sibylles, comme la Pythie de Delphes, étaient des prophétesses inspirées par les dieux, s’exprimant dans un langage souvent des plus énigmatiques. L’art d’imaginer le futur, dès l’origine, n’est en effet pas chose facile. Il ne s’agit pas de donner des réponses simples à des problèmes simples, mais plutôt de livrer des interprétations répondant à des problèmes plus ou moins bien formulés. Malgré cela, à cette époque, aucun stratège d’aucune armée n’aurait eu l’idée saugrenue d’intervenir sans, au préalable, consulter des augures. J’ai en tête cette phrase de Cicéron, au Ier siècle av. J.-C., dans son dialogue philosophique De Divinatione24 : « Indiquez-moi, s’il se peut, une nation, une cité qui ne se gouverne point par des pronostics tirés des intestins des animaux, ou par les interprètes des prodiges ou des éclairs, ou par les prédictions des augures, des astrologues, des sorts ; ou bien montrez-m’en une qui n’ait pas recours aux songes et aux vaticinations, qui nous viennent, dit-on, de la nature. »
En ces temps anciens, on recourait à la pégomancie – l’art de lire le futur dans les sources et dans l’eau des fontaines –, à l’ophiomancie – dans les mouvements des serpents –, à l’acutomancie – dans les épingles –, ou encore à la molybdomancie – dans le plomb. Aujourd’hui, on peut regarder cela avec un peu de tendresse, ou avoir l’impression que les décisions se prenaient parfois au doigt mouillé. C’était le temps du fatalisme, du fatum, où l’on était à la merci du jeu de puissances supérieures et où notre unique interface avec le destin consistait à soudoyer des augures pour tâcher d’influer sur ce qui était déjà écrit, sur ce qui nous attendait. De cette longue période subsistent aujourd’hui quelques traces. Ne cherche-t- on pas encore à sonder la psyché humaine grâce à l’encromancie ? – même si, pour faire plus sérieux, ce procédé est appelé test de Rorschach. Bien actuels aussi, la sérendipité et les synchronicités*1, ces petits riens qui apparaissent et semblent répondre à nos problématiques en cours, par exemple lorsque l’on redécouvre dans notre bibliothèque un livre dont le titre répond en partie à notre questionnement.
C’est à la fin du Moyen Âge, et plus encore à la Renaissance, que la science et la notion de progrès qui lui est associée firent entrer l’Humanité dans un autre temps. On se mit à développer les liens entre les causes et les conséquences : si l’on connaissait les unes, peut-être pouvait-on connaître les autres… Et à comprendre les deux, peut-être tout maîtriser. Un temps d’orgueil. C’est la naissance de la théorie du déterminisme – selon laquelle le principe de causalité relie une succession d’événements –, qui a largement structuré la pensée des XIXe et XXe siècles et la philosophie de l’histoire de Karl Marx. On en conserve la trace aujourd’hui, lorsque, dans un débat politique, un commentateur avance par exemple que les jeunes de banlieue ont très peu de chances d’être ministre, ou les filles ou fils d’ouvriers de devenir professeur d’université… Orgueil, donc, que d’essayer de se départir du fatalisme en le remplaçant par du déterminisme.
LE TEMPS DES INCERTITUDES
Le troisième temps dans le traitement du futur est celui où nous sommes encore actuellement – le temps de l’après-Seconde Guerre mondiale. Hiroshima, Nagasaki et la guerre froide qui s’ensuivit ont avéré, dès cet instant, la capacité qu’avait l’homme à annihiler sa propre humanité. À la faveur de cette folie, il suffisait qu’un homme, d’un côté ou de l’autre du rideau de fer, appuie sur un bouton rouge pour nous faire disparaître… La bombe atomique et la puissance dont elle est porteuse nous ont alors plongés dans une ère d’incertitudes qui se sont renforcées avec la crise écologique, par la prise de conscience qu’au-delà des stratégies et offensives militaires, notre simple mode de vie pouvait nous conduire aussi, en partie, à notre fin. C’est le sens de l’anthropocène*2, cette nouvelle ère géologique dans laquelle nous sommes entrés, où nous découvrons et mesurons les conséquences possibles et mortifères de nos propres actions sur la biosphère. Cependant, « incertitude », comme nous le rappellent les scientifiques, ne veut pas dire que nous ne savons rien. Cela signifie simplement que nous ne savons pas tout, et qu’il faut faire avec.
Dans ces années d’après-guerre, des philosophes nous ont proposé différentes pensées pour répondre à cette problématique : Gaston Berger*3, avec la prospective, mais aussi Hans Jonas*4, qui développa le principe « responsabilité », véritable prélude au discours du développement durable. La prospective naît donc dans l’après-guerre, un temps où il fallait reconstruire un monde que nous nous étions savamment appliqués à détruire. Ce temps a été traversé par ce qu’on appellerait aujourd’hui des « disruptions » mécaniques et technologiques, comme l’ont été l’essor de l’aviation longs courriers, l’énergie nucléaire civile, ou encore les prémices de la conquête spatiale.
C’est dans ce contexte que Gaston Berger utilise pour la première fois le terme de « prospective ». L’adjectif « prospectif » existait alors, mais pas la prospective en tant que telle. L’idée de Gaston Berger était d’éclairer les décideurs afin qu’ils agissent à l’aune des possibles conséquences de leurs choix. D’entrée de jeu, la prospective est énoncée comme « une philosophie de l’action ». Il ne s’agit pas d’une méthode statistique de probabilités sur ce qui pourrait advenir, mais d’un prétexte à questionner celle ou celui qui va agir à la lumière des éventuelles conséquences de ses actions. Dans la rubrique « carnet mondain », il est intéressant de noter que Gaston Berger est le père du chorégraphe Maurice Béjart, de même que l’un des grands penseurs de la prospective dite « à la française », Bertrand de Jouvenel25, a eu une longue aventure amoureuse avec l’écrivaine Colette dans les années 1920. Deux anecdotes qui nous rappellent que, dès l’origine, prospective et art sont intimement liés.
DE LA DIFFICULTÉ D’ANTICIPER
Chaque fois que l’homme a essayé d’anticiper le futur, il semble avoir rencontré sensiblement les mêmes difficultés. Cela m’évoque les célèbres illustrations du dessinateur Villemard, qui, en 1900, donnait une vision de l’an 2000 où la machine, généralement au centre, diminuait le labeur ou augmentait le plaisir de l’être humain, rendant sa vie en tout cas plus confortable. Vision machiniste du progrès, comme peut-être la nôtre l’est actuellement avec la technologie. En regardant ces illustrations, une chose saute aux yeux : les vêtements restent ceux de l’époque de l’artiste, tout comme l’atmosphère paisible qui semble régner dans les rues et les maisons. Face à cela, deux théories d’historiens s’affrontent. La première imagine que les protagonistes se jugeaient si élégants qu’ils croyaient leur style indémodable. La seconde avance qu’il est difficile de s’extraire des contingences où nous nous sommes construits pour essayer de voir neuf dans un monde où tout est à réinventer. Ce que confirme aussi d’ailleurs la présence récurrente, sur ces dessins, de domestiques servant des bourgeois présumés, témoignant du fait qu’il est difficile d’imaginer un futur structuré par un ordre social différent. C’est bien là, je pense, la grande difficulté de l’exercice, quelle que soit l’époque. Ainsi, quand, à la fin du XXe siècle, pour son film Le Cinquième Élément, Luc Besson demande au couturier Jean-Paul Gaultier d’imaginer les vêtements du futur, celui-ci, avec tout son génie créatif, conçoit des uniformes asymétriques, phosphorescents, fluorescents… mais qui restent des uniformes, faits de matières et de formes. Il n’a pas imaginé qu’à l’avenir, nous puissions être vêtus, par exemple, de champs magnétiques réagissant à l’émotion de celle ou de celui qui nous regarde. Comme souvent dans ce type d’exercice, les projections nous renseignent plus sur l’origine de la pensée que sur la destination. Il s’agit souvent d’une réalité « augmentée » de ce que l’on connaît déjà. Or, tout l’art et la beauté de l’exercice sont précisément de s’extraire de ce qui nous a construits pour essayer de « voir neuf ».
Prévoir l’avenir est un art aussi difficile que périlleux. On se trompe souvent, parfois à dessein. Mais le futur a ceci de surprenant que le simple fait d’en discuter influe sur la destinée du sujet traité. Lorsque Bison futé, l’oracle autoroutier, nous augure un samedi noir, et que nous reportons de ce fait notre départ à dimanche, influant ainsi sur la couleur de ladite journée, peut-on dire alors que Bison futé s’est trompé ? C’est bien là que réside toute la marge de manœuvre de l’art de la prospective.
L’HOMME AU CENTRE DE TOUTE CHOSE
Voilà plus de 20 ans que je fais des allers-retours dans les futurs. Impatient, j’ai parfois le désir de m’y rendre plus vite. D’autres fois, j’ai envie d’aller dans le passé pour retrouver certaines choses que l’on gagnerait à redécouvrir, ici et maintenant. Mais la plupart du temps, je me dis que nous vivons une période incroyable, puisque nous avons la chance de participer, en conscience, à une renaissance. Bien sûr, la Renaissance a déjà existé dans l’histoire de l’humanité, une période historique qui fut une construction a posteriori. Ce sont en effet les Modernes qui, une fois installés dans leur époque, ont décidé qu’entre eux et le sombre Moyen Âge avait existé une « zone tampon », période de métamorphoses : la Renaissance. Même si, au Quattrocento, quelques humanistes italiens emploient déjà le terme de Rinascità, peu de « renaissants » se sentent en renaissance le temps de la Renaissance. Ils vivent au contraire plutôt une période de grande crise, troublée par les guerres de Religion, et notamment par la réforme protestante, véritable révolution bouleversant tous les cadres qui les avaient structurés. Des pans entiers des architectures installées depuis longtemps sont ainsi questionnés, de manière cultuelle autant que culturelle, par la science, la notion de progrès, les nouvelles découvertes…
Plusieurs événements transforment alors notre perception du monde. De Sumer à Carthage, de Louxor à Sparte, le bassin méditerranéen était alors la matrice de notre histoire. Voilà qu’avec les grandes découvertes, nous réalisons que le monde est bien plus vaste que celui qui nous a structurés jusque-là. Nous découvrons de nouveaux territoires, des terrae incognitae qui sont en réalité des continents entiers. Nous avons même de la chance, nous y découvrons de l’or, ce qui n’est pas la même chose que si nous avions découvert du plâtre… Le monde aurait été différent. S’installe ainsi l’idée que le monde est non seulement plus grand, mais aussi bien plus fastueux que ce que nous aurions pu imaginer. C’est ici que se structure l’idée d’une croissance infinie dans un monde infini.
La place de l’homme est alors, elle aussi, réinterrogée pendant cette période. Tandis qu’auparavant, nous étions l’objet du jeu de la fatalité de puissances supérieures, voilà qu’à la Renaissance, nous nous émancipons. Démiurges, maîtres et possesseurs de la nature, nous nous plaçons au centre de toutes choses. Ainsi, et pour une longue période, l’homme se positionne au centre de la Terre, laquelle se trouve au centre de l’univers. Il fallut batailler pour parvenir à imposer une nouvelle conception de la place de la Terre. Giordano Bruno*5 mourut pour en avoir exprimé l’idée, et Galilée*6 fut contraint de se dédire. Si l’idée d’une Terre qui n’était pas le centre de l’univers parvint cependant à se propager, l’être humain resta, quant à lui, toujours à la place centrale qu’il avait choisi d’occuper.
UN PARMI LES ÉGAUX
Beaucoup de choses se sont jouées pour nous durant la Renaissance, que ce soit dans le domaine des arts, de l’architecture ou des sciences… Nous gardons encore la mémoire de cette période faste où l’on redécouvrit l’antique qui se trouvait pourtant sous nos yeux. Les penseurs grec...