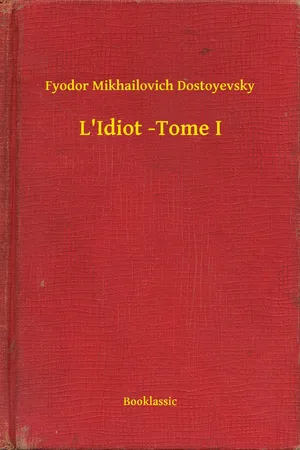Il était environ neuf heures du matin ; c’était à la fin de novembre, par un temps de dégel. Le train de Varsovie filait à toute vapeur vers Pétersbourg. L’humidité et la brume étaient telles que le jour avait peine à percer ; à dix pas à droite et à gauche de la voie on distinguait malaisément quoi que ce fût par les fenêtres du wagon. Parmi les voyageurs, il y en avait qui revenaient de l’étranger ; mais les compartiments de troisième, les plus remplis, étaient occupés par de petites gens affairées qui ne venaient pas de bien loin. Tous, naturellement, étaient fatigués et transis ; leurs yeux étaient bouffis, leur visage reflétait la pâleur du brouillard.
Dans un des wagons de troisième classe deux voyageurs se faisaient vis-à-vis depuis l’aurore, contre une fenêtre ; c’étaient des jeunes gens vêtus légèrement[2] et sans recherche ; leurs traits étaient assez remarquables et leur désir d’engager la conversation était manifeste. Si chacun d’eux avait pu se douter de ce que son vis-à-vis offrait de singulier, ils se seraient certainement étonnés du hasard qui les avait placés l’un en face de l’autre, dans une voiture de troisième classe du train de Varsovie.
Le premier était de faible taille et pouvait avoir vingt-sept ans ; ses cheveux étaient frisés et presque noirs ; ses yeux gris et petits, mais pleins de feu. Son nez était camus, ses pommettes faisaient saillies ; sur ses lèvres amincies errait continuellement un sourire impertinent, moqueur et même méchant. Mais son front dégagé et bien modelé corrigeait le manque de noblesse du bas de son visage. Ce qui frappait surtout, c’était la pâleur morbide de ce visage et l’impression d’épuisement qui s’en dégageait, bien que l’homme fût assez solidement bâti ; on y discernait aussi quelque chose de passionné, voire de douloureux, qui contrastait avec l’insolence du sourire et la fatuité provocante du regard. Chaudement enveloppé dans une large peau de mouton noire bien doublée, il n’avait pas senti le froid, tandis que son voisin avait reçu sur son échine grelottante toute la fraîcheur de cette nuit de novembre russe à laquelle il ne paraissait pas habitué.
Ce dernier était affublé d’un manteau épais, sans manches, mais surmonté d’un énorme capuchon, un vêtement du genre de ceux que portent souvent, en hiver, les touristes qui visitent la Suisse ou l’Italie du Nord. Une pareille tenue, parfaite en Italie, ne convenait guère au climat de la Russie, encore moins pour un trajet aussi long que celui qui sépare Eydtkuhnen[3] de Saint-Pétersbourg.
Le propriétaire de cette houppelande était également un jeune homme de vingt-six à vingt-sept ans. Sa taille était un peu au-dessus de la moyenne, sa chevelure épaisse et d’un blond fade ; il avait les joues creuses et une barbiche en pointe tellement claire qu’elle paraissait blanche. Ses yeux étaient grands et bleus ; la fixité de leur expression avait quelque chose de doux mais d’inquiétant et leur étrange reflet eût révélé un épileptique à certains observateurs. Au surplus, le visage était agréable, les traits ne manquaient point de finesse, mais le teint semblait décoloré et même, en ce moment, bleui par le froid. Il tenait un petit baluchon, enveloppé dans un foulard de couleur défraîchie, qui constituait vraisemblablement tout son bagage. Il était chaussé de souliers à double semelle et portait des guêtres, ce qui n’est guère de mode en Russie.
Son voisin, l’homme en touloupe[4], avait observé tous ces détails, un peu par désœuvrement. Il finit par l’interroger tandis que son sourire exprimait la satisfaction indiscrète et mal contenue que l’homme éprouve à la vue des misères du prochain :
– Il fait froid, hein ?
Et son mouvement d’épaules ébaucha un frisson.
– Oh oui ! répondit l’interpellé avec une extrême complaisance. Et remarquez qu’il dégèle. Que serait-ce s’il gelait à pierre fendre ! Je ne m’imaginais pas qu’il fît si froid dans notre pays. J’ai perdu l’habitude de ce climat.
– Vous venez sans doute de l’étranger ?
– Oui, je viens de Suisse.
– Diable, vous venez de loin !
L’homme aux cheveux noirs sifflota et se mit à rire. La conversation s’engagea. Le jeune homme blond au manteau suisse répondait avec une étonnante obligeance à toutes les questions de son voisin, sans paraître s’apercevoir du caractère déplacé et oiseux de certaines de ces questions, ni du ton négligent sur lequel elles étaient posées. Il expliqua notamment qu’il avait passé plus de quatre ans hors de Russie et qu’on l’avait envoyé à l’étranger pour soigner une affection nerveuse assez étrange, dans le genre du haut mal ou de la danse de Saint-Guy, qui se manifestait par des tremblements et des convulsions. Ces explications firent sourire son compagnon à diverses reprises, et surtout, lorsque à la question : « Êtes-vous guéri ? » il répondit :
– Oh non ! on ne m’a pas guéri.
– Alors vous avez dépensé votre argent en pure perte.
Et le jeune homme brun ajouta avec aigreur :
– C’est comme cela que nous nous laissons exploiter par les étrangers.
– C’est bien vrai ! s’exclama un personnage mal vêtu, âgé d’une quarantaine d’années, qui était assis à côté d’eux et avait l’air d’un gratte-papier ; il était puissamment bâti et exhibait un nez rouge au milieu d’une face bourgeonnée. – C’est parfaitement vrai, messieurs, continua-t-il ; c’est ainsi que les étrangers grugent les Russes et soutirent notre argent.
– Oh ! vous vous trompez complètement en ce qui me concerne, repartit le jeune homme sur un ton doux et conciliant. Évidemment, je ne suis pas à même de discuter, parce que je ne connais pas tout ce qu’il y aurait à dire sur la question. Mais, après m’avoir entretenu à ses frais pendant près de deux ans, mon médecin s’est saigné à blanc pour me procurer l’argent nécessaire à mon retour.
– Il n’y avait donc personne qui pût payer pour vous ? demanda le jeune homme brun.
– Hé non ! M. Pavlistchev, qui pourvoyait à mon entretien là-bas, est mort il y a deux ans. Je me suis alors adressé ici à la générale Epantchine, qui est ma parente éloignée, mais je n’ai reçu aucune réponse. Alors je reviens au pays.
– Et où comptez-vous aller ?
– Vous voulez dire : où je compte descendre ? Ma foi, je n’en sais encore rien…
– Vous n’êtes guère fixé.
Et les deux auditeurs partirent d’un nouvel éclat de rire.
– Ce petit paquet contient sans doute tout votre avoir ? demanda le jeune homme brun.
– Je le parierais, ajouta le tchinovnik[5] au nez rubicond, d’un air très satisfait. Et je présume que vous n’avez pas d’autres effets aux bagages. D’ailleurs pauvreté n’est pas vice, cela va sans dire.
C’était également vrai : le jeune homme blond en convint avec infiniment de bonne grâce.
Ses deux voisins donnèrent libre cours à leur envie de rire. Le propriétaire du petit paquet se mit à rire aussi en les regardant, ce qui accrut leur hilarité. Le bureaucrate reprit :
– Votre petit paquet a tout de même une certaine importance. Sans doute, on peut parier qu’il ne contient pas des rouleaux de pièces d’or, telles que napoléons, frédérics ou ducats de Hollande. Il est facile de le conjecturer, rien qu’à voir vos guêtres qui recouvrent des souliers de forme étrangère. Cependant si, en sus de ce petit paquet, vous avez une parente telle que la générale Epantchine, alors le petit paquet lui-même acquiert une valeur relative. Ceci, bien entendu, dans le cas où la générale serait effectivement votre parente et s’il ne s’agit pas d’une erreur imputable à la distraction, travers fort commun, surtout chez les gens imaginatifs.
– Vous êtes encore dans le vrai ! s’écria le jeune homme blond. En effet, je suis presque dans l’erreur. Entendez que la générale est à peine ma parente ; aussi ne suis-je nullement étonné qu’elle n’ait jamais répondu à ma lettre de Suisse. Je m’y attendais.
– Vous avez gaspillé votre argent en frais de poste. Hum… Au moins on peut dire que vous avez de la candeur et de la sincérité, ce qui est à votre éloge… Quant au général Epantchine, nous le connaissons, en ce sens que c’est un homme connu de tout le monde. Nous avons aussi connu feu M. Pavlistchev, qui vous a entretenu en Suisse, si toutefois il s’agit de Nicolas Andréïévitch Pavlistchev, car ils étaient deux cousins de ce nom. L’un vit toujours en Crimée ; quant à Nicolas Andréïévitch Pavlistchev, le défunt, c’était un homme respectable, qui avait de hautes relations et dont on estimait jadis la fortune à quatre mille âmes[6].
– C’est bien cela : on l’appelait Nicolas Andréïévitch Pavlistchev.
Ayant ainsi répondu, le jeune homme attacha un regard scrutateur sur ce monsieur qui paraissait tout savoir.
Les gens prêts à renseigner sur toute chose se rencontrent parfois, voire assez fréquemment, dans une certaine classe de la société. Ils savent tout, parce qu’ils concentrent dans une seule direction les facultés inquisitoriales de leur esprit. Cette habitude est naturellement la conséquence d’une absence d’intérêts vitaux plus importants, comme dirait un penseur contemporain. Du reste, en les qualifiant d’omniscients, on sous-entend que le domaine de leur science est assez limité. Ils vous diront par exemple qu’un tel sert à tel endroit, qu’il a pour amis tels et tels ; que sa fortune est de tant. Ils vous citeront la province dont ce personnage a été gouverneur, la femme qu’il a épousée, le montant de la dot qu’elle lui a apportée, ses liens de parenté, et toute sorte de renseignements du même acabit. La plupart du temps ces « je sais tout » vont les coudes percés et touchent des appointements de dix-sept roubles par mois. Ceux dont ils connaissent si bien les tenants sont loin de se douter des mobiles d’une pareille curiosité. Pourtant, bien des gens de cette espèce se procurent une véritable jouissance en acquérant un savoir qui équivaut à une véritable science et que leur fierté élève au rang d’une satisfaction esthétique D’ailleurs cette science a ses attraits. J’ai connu des savants, des écrivains, des poètes, des hommes politiques qui y ont puisé une vertu d’apaisement, qui en ont fait le but de leur vie et qui lui ont dû les seuls succès de leur carrière.
Pendant le colloque, le jeune homme brun bâillait, jetait des regards désœuvrés par la fenêtre et semblait impatient d’arriver. Son extrême distraction tournait à l’anxiété et à l’extravagance : parfois, il regardait sans voir, écoutait sans entendre et, s’il lui arrivait de rire, il ne se rappelait plus le motif de sa gaîté.
– Mais permettez, avec qui ai-je l’honneur… ? demanda soudain l’homme au visage bourgeonné en se tournant vers le propriétaire du petit paquet.
– Je suis le prince Léon Nicolaïévitch Muichkine, répondit le jeune homme avec beaucoup d’empressement.
– Le prince Muichkine ? Léon Nicolaïévitch ? Connais pas. Je n’en ai même pas entendu parler, répliqua le tchinovnik d’un air songeur. Ce n’est pas le nom qui m’étonne. C’est un nom historique ; on le trouve ou on doit le trouver dans l’Histoire de Karamzine[7]. Je parle de votre personne et je crois bien, au surplus, qu’on ne rencontre plus aujourd’hui nulle part de prince de ce nom ; le souvenir s’en est éteint.
– Oh je crois bien ! reprit aussitôt le prince : il n’existe plus aucun prince Muichkine en dehors de moi ; je dois être le dernier de la lignée. Quant à nos aïeux, c’étaient des gentilshommes-paysans[8]. Mon père a servi dans l’armée avec le grade de lieutenant après avoir passé par l’école des cadets. À vrai dire, je ne saurais vous expliquer comment la générale Epantchine se trouve être une princesse Muichkine ; elle aussi, elle est la dernière de son genre…
– Hé hé ! la dernière de son genre ! quelle drôle de tournure ! dit le tchinovnik en ricanant.
Le jeune homme brun ébaucha également un sourire. Le prince parut légèrement étonné d’avoir réussi à faire un jeu de mot, d’ailleurs assez mauvais.
– Croyez bien que mon intention n’était pas de jouer sur les mots, expliqua-t-il enfin.
– Cela va de soi ; on le voit de reste, acquiesça le tchinovnik devenu hilare.
– Eh bien ! prince, vous avez sans doute étudié les sciences pendant votre séjour chez ce professeur ? demanda soudain le jeune homme brun.
– Oui… j’ai étudié…
– Ce n’est pas comme moi, qui n’ai jamais rien appris.
– Pour moi, c’est tout au plus si j’ai reçu quelques bribes d’instruction, fit le prince, comme pour s’excuser. – En raison de mon état de santé, on n’a pas jugé possible de me faire faire des études suivies.
– Connaissez-vous les Rogojine ? demanda subitement le jeune homme brun.
– Je ne les connais pas du tout. Je dois vous dire que je connais très peu de monde en Russie. Est-ce vous qui portez ce nom ?
– Oui, je m’appelle Rogojine, Parfione.
– Parfione ? Ne seriez-vous pas membre de cette famille des Rogojine qui…, articula le tchinovnik en affectant l’importance.
– Oui, oui, c’est cela même, fit le jeune homme brun sur un ton de brusque impatience, pour interrompre l’employé auquel il n’avait pas adressé un mot jusque-là, n’ayant parlé qu’avec le prince.
– Mais… comment cela se peut-il ? reprit le tchinovnik en écarquillant les yeux avec stupeur, tandis que sa physionomie revêtait une expression d’obséquiosité et presque d’effroi. – Alors vous seriez parent de ce même Sémione Parfionovitch Rogojine, bourgeois honoraire héréditaire[9], qui est mort voici un mois en laissant une fortune de deux millions et demi à ses héritiers ?
– D’où tiens-tu qu’il a laissé deux millions de capital net ? riposta le jeune homme brun en lui coupant la parole, mais sans daigner davantage tourner son regard vers lui. Et il ajouta, en s’adressant au prince, avec un clignement d’œil :
– Je vous le demande un peu : quel intérêt peuvent avoir ces gens-là à vous aduler avec un pareil empressement ? Il est parfaitement exact que mon père vient de mourir ; ce qui ne m’empêche pas de retourner chez moi, un mois plus tard, venant de Pskov, dans un état de dénuement tel que c’est tout juste si j’ai une paire de bottes à me mettre. Mon gredin de frère et ma mère ne m’ont envoyé ni argent ni faire part. Rien : j’ai été traité comme un chien. Et je suis resté pendant un long mois à Pskov alité avec une fièvre chaude.
– N’empêche que vous allez toucher d’un seul coup un bon petit million, et peut-être ce chiffre est-il très au-dessous de la réalité qui vous attend. Ah Seigneur ! s’exclama le tchinovnik en levant les bras au ciel.
– Non, mais qu’est-ce que cela peut bien lui faire, je vous le demande ? répéta Rogojine en désignant son interlocuteur dans un geste d’énervement et d’aversion. – Sache donc que je ne te donnerai pas un kopek, quand bien même tu marcherais sur les mains devant moi.
– Eh bien ! je marcherai quand même sur les mains.
– Voyez-vous cela ! Dis-toi bien que je ne te donnerai rien, même si tu dansais toute une semaine.
– Libre à toi ! Tu ne me donneras rien et je danserai. Je quitterai ma femme et mes enfants pour danser devant toi, en me répétant à moi-même : flatte, flatte…
– Fi, quelle bassesse ! dit le jeune homme brun en crachant de dégoût ; puis il se tourna vers le prince. – Il y a cinq semaines, je me suis enfui de la maison paternelle en n’emportant, comme vous, qu’un petit paquet de hardes. Je me suis rendu à Pskov, chez ma tante, où j’ai attrapé une mauvaise fièvre. C’est pendant ce temps-là que mon père est mort d’un coup de sang. Paix à ses cendres, mais c’est tout juste s’il ne m’a pas assommé. Vous me croirez, prince, si vous voulez : Dieu m’est témoin qu’il m’aurait tué si je n’avais pris la fuite.
– Vous l’aurez probablement irrité ? insinua le prince, qui examinait le millionnaire en touloupe avec une curiosité particulière.
Mais, quelque intérêt qu’il pût y avoir à entendre l’histoire de cet héritage d’un million, l’attention du prince était sollicitée par quelque chose d’autre.
De même, si Rogojine éprouvait un plaisir singulier à lier conversation avec le prince, ce plaisir dérivait d’une impulsion plutôt que d’un besoin d’épanchement ; il semblait s’y adonner plus par diversion que par sympathie, son état d’inquiétude et de nervosité le poussant à regarder n’importe qui et à parler de n’importe quoi. C’était à croire qu’il était encore en proie au délire, ou tout au moins à la fièvre. Quant au tchinovnik, il n’avait d’yeux que pour Rogojine, osant à peine respirer et recueillant comme un diamant chacune de ses paroles.
– Il est certain qu’il était courroucé contre moi, et peut-être n’était-ce pas sans raison, répondit Rogojine ; mais c’est surtout mon frère qui l’a monté contre moi. Je ne dis rien de ma mère : c’est une vieille femme toujours plongée dans la lecture du ménologe et entourée de gens de son âge ; si bien que la volonté qui prévaut chez nous, c’est celle de mon frère S...