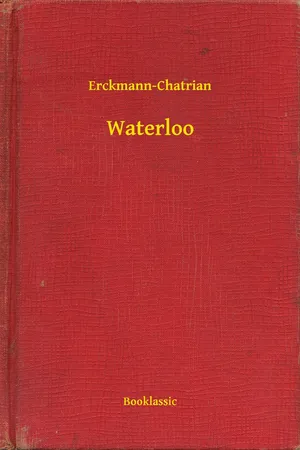Je n’ai jamais rien vu d’aussi joyeux que le retour de Louis XVIII, en 1814. C’était au printemps, quand les haies, les jardins et les vergers refleurissent. On avait eu tant de misères depuis des années, on avait craint tant de fois d’être pris par la conscription et de ne plus revenir, on était si las de toutes ces batailles, de toute cette gloire, de tous ces canons enlevés, de tous ces Te Deum, qu’on ne pensait plus qu’à vivre en paix, à jouir du repos, à tâcher d’acquérir un peu d’aisance et d’élever honnêtement sa famille par le travail et la bonne conduite.
Oui, tout le monde était content, excepté les vieux soldats et les maîtres d’armes. Je me rappelle que, le 3 mai, quand l’ordre arriva de monter le drapeau blanc sur l’église, toute la ville en tremblait, à cause des soldats de la garnison, et qu’il fallut donner six louis à Nicolas Passauf, le couvreur, pour accomplir cette action courageuse. On le voyait de toutes les rues avec son drapeau de soie blanche, la fleur de lis au bout, et de toutes les fenêtres des deux casernes les canonniers de marine tiraient sur lui. Passauf planta le drapeau tout de même, et descendit ensuite se cacher dans la grange des Trois-Maisons, pendant que les marins le cherchaient en ville pour le massacrer.
C’est ainsi que ces gens se conduisaient. Mais les ouvriers, les paysans et les bourgeois en masse criaient : « Vive la paix ! À bas la conscription et les droits réunis ! » parce que tout le monde était las de vivre comme l’oiseau sur la branche, et de se faire casser les os pour des choses qui ne nous regardaient pas.
On pense bien qu’au milieu de cette grande joie, le plus heureux c’était moi ; les autres n’avaient pas eu le bonheur de réchapper des terribles batailles de Weissenfelz, de Lutzen, de Leipzig, et du typhus ; moi, je connaissais la gloire, et cela me donnait encore plus l’amour de la paix et l’horreur de la conscription.
J’étais revenu chez le père Goulden, et toute ma vie je me rappellerai la manière dont il m’avait reçu, toute ma vie je l’entendrai crier en me tendant les bras : « C’est toi, Joseph !… Ah ! mon cher enfant, je te croyais perdu ! » Nous pleurions en nous embrassant. Et depuis nous vivions ensemble comme deux véritables amis ; il me faisait raconter mille et mille fois nos batailles, et m’appelait en riant : le vieux soldat.
Ensuite, c’est lui qui me racontait le blocus de Phalsbourg ; comment les ennemis étaient arrivés devant la ville en janvier, comment les anciens de la République, restés seuls avec quelques centaines de canonniers de marine, s’étaient dépêchés de monter nos canons sur les remparts ; comment il avait fallu manger du cheval à cause de la disette, et casser les fourneaux des bourgeois pour faire de la mitraille. Le père Goulden, malgré ses soixante ans, avait été pointeur sur le bastion de la poudrière, du côté de Bichelberg, et je me le figurais toujours avec son bonnet de soie noire et ses besicles, en train de pointer une grande pièce de vingt-quatre ; cela nous faisait rire tous les deux et nous aidait à passer le temps.
Nous avions repris toutes nos vieilles habitudes ; c’est moi qui dressais la table et qui faisais le pot-au-feu. J’étais aussi rentré dans ma petite chambre, et je rêvais à Catherine jour et nuit. Seulement, au lieu d’avoir peur de la conscription, comme en 1813, alors c’était autre chose. Les hommes ne sont jamais tout à fait heureux ; il faut toujours des misères qui les tracassent ; combien de fois n’ai-je pas vu cela dans ma vie ! Enfin, voici ce qui me donnait du chagrin :
Vous saurez que je devais me marier avec Catherine ; nous étions d’accord, et la tante Grédel ne demandait pas mieux. Malheureusement, on avait bien licencié les conscrits de 1815, mais ceux de 1813 restaient toujours soldats. Ce n’était plus aussi dangereux d’être soldat que sous l’Empire. Beaucoup d’entre ceux qui s’étaient retirés dans leur village vivaient tranquillement sans voir arriver les gendarmes ; mais cela n’empêchait pas que, pour me marier, il fallait une permission. Le nouveau maire, M. Jourdan, n’aurait jamais voulu m’inscrire sur les registres, sans avoir cette permission, et voilà ce qui me troublait.
Tout de suite à l’ouverture des portes, le père Goulden avait écrit au ministre de la guerre, qui s’appelait Dupont, que je me trouvais à Phalsbourg, encore un peu malade, et que je boitais, depuis ma naissance, comme un malheureux, mais qu’on m’avait pris tout de même dans la presse ; – que j’étais un mauvais soldat, qui ferait un très-bon père de famille, et que ce serait un véritable meurtre de m’empêcher de me marier, parce qu’on n’avait jamais vu d’homme plus mal bâti ni plus criblé de défauts ; qu’il faudrait me mettre dans un hôpital, etc., etc.
C’était une très-belle lettre et qui disait aussi la vérité. Rien que l’idée de repartir m’aurait rendu malade.
Enfin, de jour en jour, nous attendions la réponse du ministre, la tante Grédel, le père Goulden, Catherine et moi. J’avais une impatience qu’on ne peut pas se figurer ; quand le facteur Brainstein, le fils du sonneur de cloches, passait dans la rue, je l’entendais venir d’une demi-lieue ; cela me troublait, je ne pouvais plus rien faire et je me penchais à la fenêtre. Je le regardais entrer dans toutes les maisons, et quand il s’arrêtait un peu trop, je m’écriais en moi-même : « Qu’est-ce qu’il a donc à bavarder si longtemps ? Est-ce qu’il ne pourrait pas donner sa lettre tout de suite et ressortir ? C’est une véritable commère, ce fils Brainstein ! » Je le prenais en grippe, quelquefois même je descendais et je courais à sa rencontre en lui disant :
« Vous n’avez rien pour moi ?
– Non, monsieur Joseph, non, je n’ai rien, » disait-il en regardant ses lettres.
Alors je revenais bien triste, et le père Goulden, qui m’avait vu, criait :
« Enfant ! enfant ! voyons, un peu de patience, que diable ! cela viendra… cela viendra…nous ne sommes plus en temps de guerre.
– Mais il aurait déjà pu répondre dix fois, monsieur Goulden. !
– Est-ce que tu crois qu’il n’a d’affaire que la tienne ? Il lui arrive des centaines de lettres pareilles tous les jours ; chacun reçoit la réponse à son tour, Joseph. Et puis, tout est bouleversé maintenant de fond en comble. Allons, allons, nous ne sommes pas seuls au monde ; beaucoup d’autres braves garçons, qui veulent se marier, attendent leur permission. » Je trouvais ses raisons bien bonnes, mais je m’écriais en moi-même : « Ah ! si ce ministre savait le plaisir qu’il peut nous faire en écrivant deux mots, je suis sûr qu’il écrirait tout de suite. Comme nous le bénirions, Catherine et moi, et la tante Grédel et tout le monde ! » Enfin, il fallait toujours attendre.
Les dimanches, on pense bien aussi que j’avais repris mon habitude d’aller aux Quatre-Vents, et ces jours-là je m’éveillais de grand matin. Je ne sais quoi me réveillait. Dans les premiers temps, je croyais encore être soldat ; cela me donnait froid. Ensuite j’ouvrais les yeux, je regardais le plafond et je pensais : « Tu es chez le père Goulden, à Phalsbourg, dans la petite chambre. C’est aujourd’hui dimanche et tu vas chez Catherine ! » Cette idée me réveillait tout à fait ; je voyais Catherine d’avance, avec ses bonnes joues roses et ses yeux bleus. J’aurais voulu me lever tout de suite, m’habiller et partir ; mais l’horloge sonnait quatre heures, les portes de la ville étaient encore fermées.
Il fallait rester ; ce retard m’ennuyait beaucoup. Pour prendre patience, je recommençais depuis le commencement toutes nos amours ; je me figurais les premiers temps : la peur de la conscription, le mauvais numéro, le Bon pour le service ! du vieux gendarme Werner à la mairie ; le départ, la route, Mayence, la grande rue de Capougnerstrasse, la bonne femme qui m’avait fait un bain de pieds ; plus loin, Francfort, Erfurt, où j’avais reçu la première lettre, deux jours avant la bataille ; les Russes, les Prussiens, enfin tout… Et je pleurais en moi-même. – Mon idée de Catherine revenait toujours. Cinq heures sonnaient, alors je sautais du lit, je me lavais, je me faisais la barbe, je m’habillais, et le père Goulden, encore sous ses grands rideaux, le nez en l’air, me disait :
« Hé ! je t’entends, je t’entends. ...