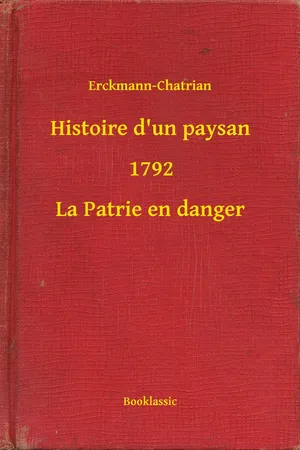Je vous ai raconté les misères du peuple avant 1789 : la masse d’impôts qu’on nous faisait supporter ; le compte rendu de Necker, où l’on apprit qu’il existait un gros déficit tous les ans ; la déclaration du parlement de Paris, que les états généraux avaient seuls le droit de voter les impôts ; les tours de Calonne et de Brienne pour avoir de l’argent ; les deux réunions de notables, qui refusèrent d’imposer leurs propres biens ; et finalement, quand il fallut payer ou faire banqueroute, la convocation des états généraux à Versailles, après cent soixante-quinze ans d’interruption.
Je vous ai dit que nos députés avaient l’ordre écrit d’abolir les barrières intérieures, qui gênaient le commerce ; les maîtrises et jurandes, qui gênaient l’industrie, les dîmes et droits féodaux, qui gênaient l’agriculture ; la vénalité des charges et offices, contraire à la justice ; les tortures et autres barbaries, contraires à l’humanité ; et les vœux des moines, contraires aux familles, aux bonnes mœurs et au bon sens.
Voilà ce que demandaient tous les cahiers du tiers état.
Mais le roi n’avait convoqué les députés du tiers que pour accepter les dépenses de la cour, des seigneurs et des évêques, pour régler le déficit et tout mettre sur le dos des bourgeois, des ouvriers et des paysans. C’est pourquoi la noblesse et le clergé, voyant qu’ils voulaient avant tout abolir les privilèges, refusèrent de se réunir à eux et les accablèrent de tant d’humiliations, qu’ils se redressèrent d’un coup, jurèrent de ne se séparer qu’après avoir fait la constitution, et se proclamèrent Assemblée nationale.
C’est ce que nous avait écrit Chauvel ; vous avez vu sa lettre.
Lorsque ces nouvelles arrivèrent au pays, la disette était encore si grande, que les pauvres vivaient de l’herbe des champs, en la faisant bouillir avec un peu de sel. Par bonheur le bois ne manquait pas ; l’orage montait : les gardes de monseigneur le cardinal-évêque restaient tranquillement chez eux, pour ne pas rencontrer les délinquants. Oui, c’était terrible !… terrible pour tout le monde, mais principalement pour les employés du fisc, pour les justiciers et tous ceux qui vivaient de l’argent du roi. Ces gens graves, prévôts, conseillers, syndics, tabellions, procureurs, de père en fils, se trouvaient comme logés dans une de ces vieilles maisons de Saverne, toutes vermoulues et décrépites, de véritables nids à rats, qui durent depuis des siècles et qui tomberont aux premiers coups de pioche. Ils le savaient, ils sentaient que cela menaçait ruine, et vous regardaient du coin de l’œil, d’un air inquiet ; ils oubliaient de poudrer leurs perruques et ne venaient plus danser leurs menuets au Tivoli.
Les nouvelles de Versailles se répandaient jusque dans les derniers villages. On attendait encore quelque chose, personne n’aurait pu dire quoi ! Le bruit courait que nos députés étaient entourés de soldats ; qu’on voulait leur faire peur, ou peut-être les massacrer. Ceux qui passaient à l’auberge des Trois-Pigeons ne parlaient plus que de cela. Maître Jean s’écriait :
– À quoi pensez-vous ? Est-ce que notre bon roi est capable de commettre des abominations ? Est-ce qu’il n’a pas convoqué lui-même des députés de son peuple, pour connaître nos besoins et faire à tous notre bonheur ? Otez-vous donc ces idées de la tête !
Les autres, du Harberg ou de Dagsbourg, le poing sur la table, ne répondaient pas ; ils s’en allaient pensifs, et maître Jean disait :
– Dieu veuille que la reine et le comte d’Artois n’essayent pas de faire un mauvais coup, car ceux qui n’ont plus rien à perdre ont tout à gagner ; et si la bataille commence, personne de nous n’en verra la fin.
Il avait bien raison ; pas un de ceux qui vivaient alors, nobles, bourgeois ou paysans, n’a vu la fin de la révolution ; elle dure encore, et ne finira que si l’esprit de douceur, de justice et de bon sens arrive une fois chez nous.
Les choses traînèrent ainsi plusieurs semaines ; le temps des petites récoltes était venu, la famine diminuait dans nos villages, et l’on commençait à se calmer, quand le 18 juillet, la nouvelle se répandit que Paris était en feu, qu’on avait voulu cerner l’Assemblée nationale pour la dissoudre, que la municipalité s’était soulevée contre le roi, qu’elle avait armé les bourgeois, que le peuple se battait dans les rues contre les régiments étrangers, et que les gardes-françaises tenaient avec la ville.
Aussitôt la lettre de Nicolas nous revint à l’esprit et cela nous parut naturel.
Tous les gens qui revenaient de Phalsbourg répétaient les mêmes choses ; le régiment de La Fère était consigné dans les casernes, et d’heure en heure des courriers s’arrêtaient à l’hôtel du gouverneur, puis filaient ventre à terre en Alsace.
Qu’on se représente l’étonnement du monde ! On n’avait pas encore l’habitude des révolutions comme de nos jours ; l’idée d’en faire ne vous venait jamais. Ce fut une grande épouvante.
Ce jour-là rien ne bougea, les nouvelles étaient arrêtées ; mais le lendemain on apprit l’enlèvement de la Bastille ; on sut que les Parisiens étaient maîtres de tout ; qu’ils avaient des fusils, de la poudre, des canons, et cela produisit un si grand effet, que les montagnards descendirent avec leurs haches, leurs fourches et leurs faux en Alsace et en Lorraine ; ils passaient par bandes, en criant :
– À Marmoutier !
– À Saverne !
– À Neuviller !
– À Lixheim !
Ils se répandaient comme des fourmilières, et démolissaient jusqu’aux baraques des hardiers, jusqu’aux maisons des gardes forestiers du prince-évêque, sans parler des bureaux d’octroi et des barrières sur les grandes routes.
Létumier, Huré, Cochard et les autres du village vinrent aussi prendre maître Jean, pour ne pas rester en arrière de Mittelbronn, des Quatre-Vents et de Lutzelbourg. Lui criait :
– Laissez-moi tranquille !… Faites ce qui vous plaira !… Je ne me mêle de rien.
Mais comme presque tous les villages d’Alsace avaient déjà brûlé les papiers des couvents et des seigneurs, et que les Baraquins voulaient aussi brûler ceux de la commune, au couvent des Tiercelins à Lixheim, il mit son habit, pour tâcher de sauver nos titres. Nous partîmes ensemble, Cochard, Létumier, Huré, maître Jean, moi, tout le village.
Il fallait entendre les cris des montagnards dans la plaine, il fallait voir les bûcherons, les schlitteurs, les ségares, tout débraillés, les haches, les pioches, les faux et les fourches en l’air par milliers. Les cris montaient et descendaient comme le roulement de l’eau sur l’écluse des Trois-Étangs ; et les femmes aussi s’en mêlaient, leurs tignasses pendantes et la hachette à la main.
À Mittelbronn, chez Forbin, il ne restait plus pierre sur pierre ; tous les papiers étaient brûlés, le toit était enfoncé dans la cave. À Lixheim, on marchait dans les plumes et la paille des paillasses jusqu’au ventre : on vidait tout par les fenêtres des malheureux juifs ; on hachait leurs meubles. Quand les gens sont lâchés, ils ne se connaissent plus ; ils confondent la religion, l’amour de l’argent, la vengeance, tout !
J’ai vu les pauvres juifs se sauver du côté de la ville : leurs femmes et leurs filles, les petits enfants sur les bras, criant comme des folles, et les vieux trébuchant derrière, en sanglotant. Et pourtant quels autres avaient plus souffert que ces malheureux, sous nos rois ? Lesquels avaient eu plus à se plaindre ? – Mais on ne songeait plus à rien.
Le couvent des Tiercelins était au vieux Lixheim ; les cinq prêtres qui vivaient là gardaient les papiers de Brouviller, de Hérange, de Fleisheim, de Pickeholtz, ceux des Baraques et même de Phalsbourg.
Toutes les communes, réunies avec la foule des montagnards, remplissaient les vieilles rues autour de la mairie ; elles voulaient leurs papiers, mais les Tiercelins pensaient :
« Si nous donnons les titres, ces gens nous massacreront ensuite. »
Ils ne savaient que faire, car la foule s’étendait autour du couvent et gardait tous les passages.
Quand maître Jean arriva, les maires des villages, en tricorne et gilet rouge, délibéraient près de la fontaine : les uns voulaient tout brûler, d’autres voulaient enfoncer les portes, quelques-uns plus raisonnables, soutenaient que l’on devait réclamer les titres d’abord, et que l’on verrait après ; ils finirent par avoir le dessus. Et comme Jean Leroux avait été député au bailliage, on le choisit avec deux autres d’entre les maires, pour aller redemander les papiers. Ils partirent ensemble, les pères Tiercelins, voyant qu’ils n’étaient que trois, leur ouvrirent, ils entrèrent, et la grosse porte se referma.
Ce qui se passa dans le couvent, maître Jean nous l’a raconté depuis : les pauvres vieux tremblaient comme des lièvres, leur supérieur, qui s’appelait père Marcel, criait que les titres étaient sous sa garde, qu’il ne pouvait les lâcher, et qu’il faudrait le tuer pour les avoir !
Mais alors maître Jean l’ayant conduit près d’une fenêtre, en lui montrant les faux qui reluisaient à perte de vue, il ne dit plus rien et monta leur ouvrir une grande armoire garnie d’un treillage en fil de fer, où les registres étaient empilés jusqu’au plafond.
Il fallait tout choisir et mettre en ordre. Comme cela durait depuis une bonne heure, les communes, croyant à la fin qu’on retenait leurs maires prisonniers, s’approchaient pour enfoncer les portes en poussant des cris terribles, lorsque maître Jean s’avança sur le balcon, avec une grosse poignée de papiers qu’il montrait d’un air joyeux, et les cris de contentement et de satisfaction s’étendirent jusqu’à l’autre bout de Lixheim. Partout on se disait en riant :
– Nous les avons !… Nous allons avoir nos papiers !
Maître Jean et les deux autres sortirent bientôt, traînant une charrette de registres. Ils traversèrent la foule, en criant qu’il ne fallait pas maltraiter les révérends pères Tiercelins, puisqu’ils rendaient à chacun son bien. On ne demandait pas mieux !
Chaque village reçut ses papiers à la maison commune, plusieurs en firent un feu de joie sur la place, brûlant leurs propres titres avec ceux du couvent. Mais Jean Leroux avait les nôtres dans sa poche, c’est pourquoi les Baraques conservent leurs droits de pâture et de glandée au bois de chênes, tandis que beaucoup d’autres n’ont plus rien, ayant en quelque sorte brûlé leurs propres forêts et pâturages à perpétuité.
J’aurais encore bien des choses à vous raconter sur cela, car un grand nombre, au lieu de rendre les titres qu’ils avaient sauvés, les ont gardés et vendus plus tard aux anciens seigneurs et même à l’État, ils sont devenus riches aux dépens de leurs communes. Mais à quoi bon ? Les gueux sont morts, ils ont rendu leurs comptes depuis longtemps.
On peut dire que, dans ces quinze jours, la France a été changée de fond en comble : tous les titres des couvents et des châteaux s’en allèrent en fumée ! Le tocsin bourdonnait jour et nuit, le ciel était rouge le long des Vosges : les abbayes, les vieux nids d’éperviers brûlaient comme des cierges parmi les étoiles ; et cela continua jusqu’au 4 août suivant, jour où les évêques et les seigneurs de l’Assemblée nationale renoncèrent à leurs droits féodaux et privilèges. Quelques-uns soutiennent qu’ils n’avaient plus besoin de renoncer, puisque tout était détruit à l’avance, sans doute, mais cela vaut pourtant mieux, de cette manière leurs descendants n’ont rien à réclamer.
Enfin, voilà comment le peuple se débarrassa des anciens droits de la noble race des conquérants. On l’avait mis sous le joug par la force, et c’est aussi par la force qu’il s’est rendu libre.
Depuis ce jour, l’Assemblée nationale put commencer notre constitution ; le roi vint même la complimenter et lui dire :
– Vous avez tort de vous méfier de moi ! Tous ces régiments que j’ai fait venir, ces dix mille hommes réunis au Champ de Mars, et ces canons qui vous entourent sont pour vous garder. Mais puisque vous n’en voulez pas, je vais les renvoyer.
Nos représentants eurent l’air de croire ce qu’il leur racontait ; mais si la Bastille n’avait pas été prise ; si la nation ne s’était pas soulevée, si les régiments étrangers avaient eu le dessus, si les gardes-françaises avaient marché contre la ville, qu’est-ce qui serait arrivé ? Il ne fallait pas être bien malin pour le deviner, notre bon roi Louis XVI aurait parlé tout autrement, et les représentants du tiers en auraient vu de dures ! Heureusement les choses avaient bien tourné pour nous : la commune de Paris venait de former sa garde nationale, et toutes les communes de France suivirent cet exemple ; elles s’armèrent contre ceux qui voulaient nous remettre sous le joug. Chaque fois que l’Assemblée nationale décrétait quelque chose, les paysans prenaient leurs fourches ou leurs fusils, en disant :
– Exécutons ça tout de suite !… Ce sera plus tôt fait… Nous éviterons de la peine à nos bons seigneurs !
Et l’on remplissait la loi.
Je me rappelle toujours avec plaisir la formation de notre milice citoyenne, comme on appela d’abord les gardes nationales, en août 1789. L’enthousiasme était presque aussi grand qu’à la nomination des députés du tiers état.
Maître Jean fut nommé lieutenant de la compagnie des Baraques, Létumier sous-lieutenant, Gauthier Courtois sergent-major, et puis d’autres sergents, caporaux. Nous n’avions pas de capitaine, parce que les Baraques ne fournissaient pas une compagnie entière.
Qu’on se représente la joie de ce jour, les cris de : Vive la nation ! pendant qu’on arrosait les épaulettes ; et la mine de maître Jean, qui pouvait enfin porter ses grosses moustaches et ses favoris pour de bon. Cela lui coûta bien deux mesures de son vin rouge de Lorraine. Létumier aussi, depuis ce moment, laissa pousser ses moustaches, de longues moustaches rousses, qui lui donnaient un air de vieux renard. Jean Rat fut notre tambour ; il faisait tous les rigodons et battait toutes les marches comme un vieux tambour-maître. Je ne sais pas où Jean Rat avait appris tant de choses, c’était peut-être en jouant de la clarinette.
Nous avions reçu des fusils de l’arsenal, de vieilles patraques garnies de baïonnettes longues d’une aune. On les maniait bien tout de même ; seulement il fallut d’abord nous donner des instructeurs du régiment de La Fère, quelques sergents qui nous apprirent l’exercice au Champ de Mars, les dimanches après-midi.
Avant la fin de la semaine, maître Jean avait déjà commandé son uniforme chez le tailleur du régiment, Kountz, et, le deuxième dimanche, il arrivait à l’exercice en grande tenue, le ventre bien arrondi dans son habit bleu à revers rouges, les yeux luisants, les épaulettes pendantes, le chapeau à cornes penché sur la nuque, le grand sabre à coquille traînant derrière sur ses talons. Il allait et venait devant les rangs, et criait à Valentin : – Citoyen Valentin, effacez donc vos épaules, mille tonnerres !
On n’a jamais vu de plus bel homme ; dame Catherine en le voyant rentrer avait peine à croire que c’était son mari ; les idées de Valentin se confondaient en le regardant, il le prenait pour de la noblesse, et sa longue figure jaune s’allongeait encore d’admiration.
Mais à l’exercice maître Jean n’était pas aussi ferré que beaucoup d’autres ; le grand Létumier lui rivait son clou. C’est là qu’on riait et qu’on se faisait du bon temps. Tous les villages des environs : Vilschberg, Mittelbronn, Quatre-Vents, Dann, Lutzelbourg, Saint-Jean-des-Choux, marchaient au pas comme des anciens, et les enfants de la ville autour poussaient des cris de : Vive la nation ! qui montaient jusqu’au ciel. Annette Minot, fruitière à la halle, était notre cantinière ; elle avait sa petite table de sapin, sa chaise et sa cruche d’eau-de-vie au milieu du Champ de Mars, avec des gobelets, et son grand parapluie tricolore déployé contre le soleil. Cela ne l’empêchait pas de rôtir dessous, nous, vers les trois heures, nous n’étions pas trop à l’aise non plus, en avalant la poussière. Comme toutes ces choses me reviennent, mon Dieu ! – Et notre sergent Quéru, un gros court, les moustaches grises, les oreilles dans la perruque, ses petits yeux noirs remplis de malice, et le grand chapeau à cornes par là-dessus ! Il marchait à reculons, devant nous, le fusil en travers des cuisses, et criait : « Une ! deusse ! Une ! deusse ! Halte ! À droite, alignement ! Fixe ! En place, repos. » Et, nous voyant suer comme des malheureux, il se mettait à rire de bon cœur, et finissait par crier :
– Rompez les rangs !
Alors on courait à la table d’Annette Minot ; chacun se faisait un honneur d’offrir le petit verre au sergent, qui ne refusait jamais, et disait avec son accent du Midi :
– Ça marchera, citoyens ; ça promet !
Il aimait les petits verres, mais qu’est-ce que cela nous faisait ? C’était un bon instructeur, un brave homme, un bon patriote. Lui, le petit Trinquet, de la troisième ; Baziaux, la plus belle voix du régiment ; Duchêne, un grand Lorrain de six pieds, rude comme du pain d’orge ; enfin tous ces vieux sergents fraternisaient avec les bourgeois ; et souvent, le soir, avant la retraite, nous les voyions au club se glisser dans l’ombre des piliers de la halle, en écoutant les disputes d’un air attentif, avant d’aller à l’appel. Ces gens avaient passé des quinze à vingt ans à moisir dans les grades inférieurs, en remplissant le service des officiers nobles, et plus tard nous les avons vus capitaines, colonels, généraux ; ils sentaient cela d’avance et tenaient pour la révolution.
Le soir, maître Jean, après avoir pendu son bel uniforme dans l’armoire, serré ses épaulettes et son chapeau dans leur étui de carton, et mis sa grosse veste en tricot, étudiait la théorie ; quelquefois, en travaillant à la forge, quand on y pensait le moins, il se mettait à crier :
– Garde à vous !… Par file à droite… droite !… En avant, pas accéléré, marche !… pour essayer sa voix et savoir s’il avait un bon creux. Presque toujours, après souper, le grand Létumier venait s’asseoir chez nous, son genou pointu entre les deux mains, et lui posait des questions en se balançant d’un air malin sur sa chaise. Maître Jean ne voyait dans la théorie que des carrés et des att...