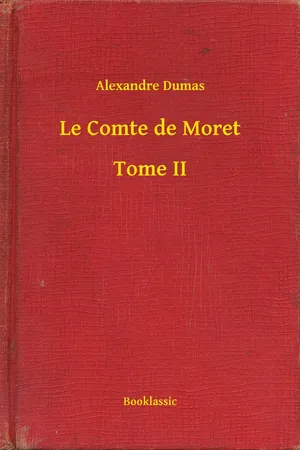Et maintenant, il faut, pour les besoins de notre récit, que nos lecteurs nous permettent de leur faire faire plus ample connaissance avec le roi Louis XIII, qu’ils ont entrevu à peine pendant cette nuit où, poussé par les pressentiments du cardinal de Richelieu dans la chambre de la reine, il n’y entra que pour s’assurer que l’on n’y tenait point cabale et lui annoncer que, par ordre de Bouvard, il se purgeait le lendemain et se faisait saigner le surlendemain.
Il s’était purgé, il s’était fait saigner, et n’en était ni plus gai ni plus rouge ; mais tout au contraire, sa mélancolie n’avait fait qu’augmenter.
Cette mélancolie, dont nul ne connaissait la cause et qui avait pris le roi dès l’âge de quatorze à quinze ans, le conduisait à essayer les uns après les autres toutes sortes de divertissements qui ne le divertissaient pas. Joignez à cela qu’il était presque le seul à la cour, avec son fou l’Angély, qui fût vêtu de noir, ce qui ajoutait encore à son air lugubre.
Rien n’était donc plus triste que ses appartements, dans lesquels, à l’exception de la reine Anne d’Autriche et de la reine-mère, qui du reste, avaient toujours le soin de prévenir le roi lorsqu’elles désiraient lui rendre visite, il n’entrait jamais aucune femme.
Souvent, lorsque l’on avait audience de lui, en arrivant à l’heure désignée, on était reçu ou par Béringhen, qu’en sa qualité de premier valet de chambre on appelait M. le Premier, ou par M. de Tréville, ou par M. de Guitaut ; l’un ou l’autre de ces messieurs vous introduisait dans le salon où l’on cherchait inutilement des yeux le roi ; le roi était dans une embrasure de fenêtre avec quelqu’un de son intimité, à qui il avait fait l’honneur de dire : Monsieur un tel, venez avec moi et ennuyons-nous. Et sur ce point, on était toujours sûr qu’il se tenait religieusement parole à lui et aux autres.
Plus d’une fois la reine, dans le but d’avoir prise sur ce morne personnage, et trop sûre de ne pouvoir y parvenir par elle-même, avait, sur le conseil de la reine-mère, admis dans son intimité ou attaché à sa maison quelque belle créature de la fidélité de laquelle elle était certaine, espérant que cette glace se fondrait aux rayons de deux beaux yeux, mais toujours inutilement.
Ce roi, que de Luynes, après quatre ans de mariage, avait été obligé de porter dans la chambre de sa femme, avait des favoris, jamais des favorites. La buggera a passato i monti, disaient les Italiens.
La belle Mme de Chevreuse, elle que l’on pouvait appeler l’Irrésistible, y avait essayé, et malgré la triple séduction de sa jeunesse, de sa beauté et de son esprit, elle y avait échoué.
– Mais, Sire, lui dit-elle un jour, impatientée de cette invincible froideur, vous n’avez donc pas de maîtresse.
– Si fait, madame, j’en ai, lui répondit le roi.
– Comment donc les aimez-vous, alors ?
– De la ceinture en haut, répondit le roi.
– Bon, fit Mme de Chevreuse, la première fois que je viendrai au Louvre, je ferai comme Gros-Guillaume, je mettrai ma ceinture au milieu des cuisses.
C’était un espoir pareil qui avait fait appeler à la cour la belle et chaste enfant que nous avons déjà présentée à nos lecteurs sous le nom d’Isabelle de Lautrec. On savait son dévouement acharné à la reine qui l’avait fait élever, quoique son père fût attaché, lui, au duc de Réthellois. Et en effet, elle était si belle, que Louis XIII s’en était d’abord fort occupé ; il avait causé avec elle, et son esprit l’avait charmé. Elle, de son côté, tout à fait ignorante des desseins que l’on avait sur elle, avait répondu au roi avec modestie et respect. Mais il avait, six mois avant l’époque où nous sommes arrivés, recruté un nouveau page de sa chambre, et non-seulement le roi ne s’était plus occupé d’Isabelle, mais encore il avait presque entièrement cessé d’aller chez la reine.
Et en effet les favoris se succédaient près du roi avec une rapidité qui n’avait rien de rassurant pour celui qui, comme on dit en terme de turf, tenait momentanément la corde.
Il y avait d’abord eu Pierrot, ce petit paysan dont nous avons parlé.
Vint ensuite Luynes, le chef des oiseaux de cabinet ; puis son porteur d’arbalète d’Esplan, qu’il fit marquis de Grimaud.
Puis Chalais, auquel il laissa couper la tête.
Puis Baradas, le favori du moment.
Et enfin Saint-Simon, le favori aspirant qui comptait sur la disgrâce de Baradas, disgrâce que l’on pouvait toujours prévoir quand on connaissait la fragilité de cet étrange sentiment qui, chez le roi Louis XIII, tenait un inqualifiable milieu entre l’amitié et l’amour.
En dehors de ses favoris, le roi Louis XIII avait des familiers ; c’étaient : M. de Tréville, le commandant de ses mousquetaires, dont nous nous sommes assez occupé dans quelques-uns de nos livres, pour que nous nous contentions de le nommer ici ; le comte de Nogent Beautru, frère de celui que le cardinal venait d’envoyer en Espagne, qui, la première fois qu’il avait été présenté à la cour, avait eu la chance, pour lui faire passer un endroit des Tuileries où il y avait de l’eau, déporter le roi sur ses épaules, comme saint-Christophe avait porté Jésus-Christ, et qui avait le rare privilège, non-seulement comme son fou l’Angély, de tout lui dire, mais encore de dérider ce front funèbre, par ses plaisanteries.
Bassompierre, fait maréchal en 1622, bien plus par les souvenirs d’alcôve de Marie de Médicis que par ses propres souvenirs de bataille ; homme, du reste, d’un esprit assez charmant, et d’un manque de cœur assez complet, pour résumer en lui toute cette époque qui s’étend de la première partie du seizième siècle à la première partie du dix-septième ; Lublet des Noyers, son secrétaire, ou plutôt son valet, La Vieuville, le surintendant des finances, Guitaut, son capitaine des gardes, homme tout dévoué à lui et à la reine Anne d’Autriche, qui, à toutes les offres que lui fit le cardinal pour se l’attacher, ne fit jamais d’autres réponses que : « Impossible, Votre Éminence, je suis au roi et l’Évangile défend de servir deux maîtres : » et enfin, le maréchal de Marillac, frère du garde des sceaux, qui devait, lui aussi, être une des taches sanglantes du règne de Louis XIII, ou plutôt du ministère du cardinal de Richelieu.
Ceci posé comme explication préliminaire, il arriva que, le lendemain du jour où Souscarrières avait fait au cardinal un rapport si véridique et si circonstancié des événements de la nuit précédente, le roi, après avoir déjeuné avec Baradas, fait une partie de volant avec Nogent, et ordonné que l’on prévînt deux de ses musiciens, Molinier et Justin, de prendre l’un son luth, l’autre sa viole, pour le distraire pendant la grande occupation à laquelle il allait se livrer, se tourna vers MM. de Bassompierre, de Marillac, des Noyers et La Vieuville, qui étaient venus lui faire leur cour.
– Messieurs, allons larder ! fit-il.
– Allons larder, messieurs, dit l’Angély en nasillant, voyez comme cela s’accorde bien : majesté et larder !
Et, sur cette plaisanterie assez médiocre et que nous ne rappellerions pas si elle n’était historique, il enfonça son chapeau sur son oreille et celui de Nogent sur le milieu de sa tête.
– Eh bien, drôle, que fais-tu ? lui dit Nogent.
– Je me couvre, et je vous couvre, dit l’Angély.
– Devant le roi, y penses-tu ?
– Bah ! pour des bouffons, c’est sans conséquence…
– Sire, faites donc taire votre fou ! s’écria Nogent furieux.
– Bon ! Nogent, dit Louis XIII, est-ce que l’on fait taire l’Angély ?
– On me paye pour tout dire, fit l’Angély ; si je me taisais, je ferais comme M. de La Vieuville, qu’on fait surintendant des finances pour qu’il y ait des finances, et qui n’a pas de finances, je volerais mon argent.
– Mais Votre Majesté n’a pas entendu ce qu’il a dit.
– Si fait, mais tu m’en dis bien d’autres à moi.
– À vous, Sire ?
– Oui, tout à l’heure, quand, en jouant à la raquette, j’ai manqué le volant. Ne m’as-tu pas dit : « En voilà un beau Louis le Juste ! » Si je ne te regardais pas un peu comme le confrère de l’Angély, crois-tu que je te laisserais me dire de ces choses-là ? Allons larder, messieurs, allons larder !
Ces deux, mots : Allons larder, méritent une explication, sous peine de ne pas être intelligibles pour nos lecteurs ; cette explication, nous allons la donner.
Nous avons dit, à deux endroits différents déjà que, pour combattre sa mélancolie, le roi se livrait, à toute sorte de divertissements qui ne le divertissaient pas. Il avait, enfant, fait des canons avec du cuir, des jets d’eau avec des plumes ; étant jeune homme il avait enluminé des images, ce que ses courtisans avaient appelé faire de la peinture ; il avait fait ce que ses courtisans avaient appelé de la musique, c’est-à-dire joué du tambour, exercice auquel, s’il faut en croire Bassompierre, il réussissait très-bien.
Il avait fait des cages et des châssis, avec M. des Noyers. Il s’était fait confiturier et avait fait d’excellentes confitures ; puis jardinier et avait réussi à avoir en février des pois verts qu’il avait fait vendre, et que, pour lui faire sa cour, M. de Montauron avait achetés. Enfin il s’était mis à faire la barbe, et un beau jour, dans l’ardeur qu’il avait pour cet amusement, il avait réuni tous ses officiers, et lui-même leur avait coupé la barbe, ne leur laissant au menton, dans sa parcimonieuse munificence que ce bouquet de poil que, depuis ce jour, en commémoration d’une main auguste, on a appelé une royale, si bien que le lendemain, le pont-Neuf suivant courait par le Louvre :
Hélas ! ma pauvre barbe,
Qui t’a donc faite ainsi ?
C’est le grand roi Louis
Treizième de ce nom
Qui toute ébarba sa maison.
Ça, monsieur de la Force,
Faut vous la faire aussi.
Hélas, Sire, merci,
Ne me la faites pas :
Me méconnaîtraient, mes soldats.
Laissons la barbe en pointe
Au cousin Richelieu,
Car par la vertudieu
Ce serait trop oser
Que de prétendre la raser.
Or, le roi Louis XIII avait fini pas se lasser de faire la barbe, comme il finissait par se lasser de tout, et comme il était descendu quelques jours auparavant dans sa cuisine, afin d’y introduire une mesure économique dans laquelle la générale Coquet perdit sa soupe au lait et M. de La Vrillière ses biscuits du matin ; il avait vu son cuisinier et ses marmitons piquer, ceux-ci des longes de veau, ceux-là des filets de bœuf, ceux-là des lièvres, ceux-là des faisans ; il avait trouvé cette opération des plus récréatives. Il en résultait que, depuis un mois à peu près, Sa Majesté avait adopté ce nouveau divertissement.
Sa Majesté lardait et faisait larder avec elle ses courtisans.
Je ne sais si l’art de la cuisine avait à gagner en passant par des mains royales, mais l’état, de l’ornementation y avait fait de grands progrès. Les longes de veau et les filets de bœuf surtout qui présentaient une plus grande surface, redescendaient à l’office avec les dessins les plus variés. Le roi se bornait à larder en paysage, c’est-à-dire qu’il dessinait, des arbres, des maisons, de chasses, des chiens, des loups, des cerfs, des fleurs de lys ; mais Nogent et les autres ne se bornaient point à des figures héraldiques et variaient leurs dessins de la façon la plus fantastique, ce qui leur valait quelquefois, de la part du roi Charles Louis, les admonestations les plus sévères et faisait exiler impitoyablement des tables royales les morceaux ornementés par...