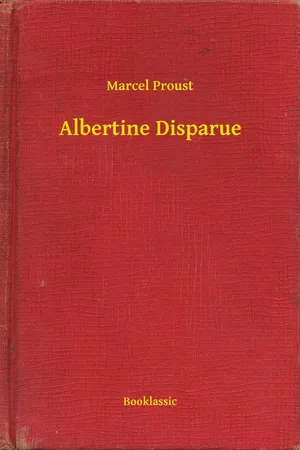Mademoiselle Albertine est partie ! Comme la souffrance va plus loin en psychologie que la psychologie ! Il y a un instant, en train de m’analyser, j’avais cru que cette séparation sans s’être revus était justement ce que je désirais, et comparant la médiocrité des plaisirs que me donnait Albertine à la richesse des désirs qu’elle me privait de réaliser, je m’étais trouvé subtil, j’avais conclu que je ne voulais plus la voir, que je ne l’aimais plus. Mais ces mots : « Mademoiselle Albertine est partie » venaient de produire dans mon cœur une souffrance telle que je ne pourrais pas y résister plus longtemps. Ainsi ce que j’avais cru n’être rien pour moi, c’était tout simplement toute ma vie. Comme on s’ignore ! Il fallait faire cesser immédiatement ma souffrance. Tendre pour moi-même comme ma mère pour ma grand’mère mourante, je me disais, avec cette même bonne volonté qu’on a de ne pas laisser souffrir ce qu’on aime : « Aie une seconde de patience, on va te trouver un remède, sois tranquille, on ne va pas te laisser souffrir comme cela. » Ce fut dans cet ordre d’idées que mon instinct de conservation chercha pour les mettre sur ma blessure ouverte les premiers calmants : « Tout cela n’a aucune importance parce que je vais la faire revenir tout de suite. Je vais examiner les moyens, mais de toute façon elle sera ici ce soir. Par conséquent inutile de se tracasser. » « Tout cela n’a aucune importance », je ne m’étais pas contenté de me le dire, j’avais tâché d’en donner l’impression à Françoise en ne laissant pas paraître devant elle ma souffrance, parce que, même au moment où je l’éprouvais avec une telle violence, mon amour n’oubliait pas qu’il lui importait de sembler un amour heureux, un amour partagé, surtout aux yeux de Françoise qui, n’aimant pas Albertine, avait toujours douté de sa sincérité. Oui, tout à l’heure, avant l’arrivée de Françoise, j’avais cru que je n’aimais plus Albertine, j’avais cru ne rien laisser de côté ; en exact analyste, j’avais cru bien connaître le fond de mon cœur. Mais notre intelligence, si grande soit-elle, ne peut apercevoir les éléments qui le composent et qui restent insoupçonnés tant que, de l’état volatil où ils subsistent la plupart du temps, un phénomène capable de les isoler ne leur a pas fait subir un commencement de solidification. Je m’étais trompé en croyant voir clair dans mon cœur. Mais cette connaissance que ne m’avaient pas donnée les plus fines perceptions de l’esprit venait de m’être apportée, dure, éclatante, étrange, comme un sel cristallisé par la brusque réaction de la douleur. J’avais une telle habitude d’avoir Albertine auprès de moi, et je voyais soudain un nouveau visage de l’Habitude. Jusqu’ici je l’avais considérée surtout comme un pouvoir annihilateur qui supprime l’originalité et jusqu’à la conscience des perceptions ; maintenant je la voyais comme une divinité redoutable, si rivée à nous, son visage insignifiant si incrusté dans notre cœur que si elle se détache, ou si elle se détourne de nous, cette déité que nous ne distinguions presque pas nous inflige des souffrances plus terribles qu’aucune et qu’alors elle est aussi cruelle que la mort.
Le plus pressé était de lire la lettre d’Albertine puisque je voulais aviser aux moyens de la faire revenir. Je les sentais en ma possession, parce que, comme l’avenir est ce qui n’existe que dans notre pensée, il nous semble encore modifiable par l’intervention in extremis de notre volonté. Mais, en même temps, je me rappelais que j’avais vu agir sur lui d’autres forces que la mienne et contre lesquelles, plus de temps m’eût-il été donné, je n’aurais rien pu. À quoi sert que l’heure n’ait pas sonné encore si nous ne pouvons rien sur ce qui s’y produira ? Quand Albertine était à la maison, j’étais bien décidé à garder l’initiative de notre séparation. Et puis elle était partie. J’ouvris la lettre d’Albertine. Elle était ainsi conçue :
« Mon ami,
» Pardonnez-moi de ne pas avoir osé vous dire de vive voix les quelques mots qui vont suivre, mais je suis si lâche, j’ai toujours eu si peur devant vous, que, même en me forçant, je n’ai pas eu le courage de le faire. Voici ce que j’aurais dû vous dire. Entre nous, la vie est devenue impossible, vous avez d’ailleurs vu par votre algarade de l’autre soir qu’il y avait quelque chose de changé dans nos rapports. Ce qui a pu s’arranger cette nuit-là deviendrait irréparable dans quelques jours. Il vaut donc mieux, puisque nous avons eu la chance de nous réconcilier, nous quitter bons amis. C’est pourquoi, mon chéri, je vous envoie ce mot, et je vous prie d’être assez bon pour me pardonner si je vous fais un peu de chagrin, en pensant à l’immense que j’aurai. Mon cher grand, je ne veux pas devenir votre ennemie, il me sera déjà assez dur de vous devenir peu à peu, et bien vite, indifférente ; aussi ma décision étant irrévocable, avant de vous faire remettre cette lettre par Françoise, je lui aurai demandé mes malles. Adieu, je vous laisse le meilleur de moi-même.
» Albertine.
« Tout cela ne signifie rien, me dis-je, c’est même meilleur que je ne pensais, car comme elle ne pense rien de tout cela, elle ne l’a évidemment écrit que pour frapper un grand coup, afin que je prenne peur et ne sois plus insupportable avec elle. Il faut aviser au plus pressé : qu’Albertine soit rentrée ce soir. Il est triste de penser que les Bontemps sont des gens véreux qui se servent de leur nièce pour m’extorquer de l’argent. Mais qu’importe ? Dussé-je, pour qu’Albertine soit ici ce soir, donner la moitié de ma fortune à Mme Bontemps, il nous restera assez, à Albertine et à moi, pour vivre agréablement. » Et en même temps, je calculais si j’avais le temps d’aller ce matin commander le yacht et la Rolls Royce qu’elle désirait, ne songeant même plus, toute hésitation ayant disparu, que j’avais pu trouver peu sage de les lui donner. « Même si l’adhésion de Mme Bontemps ne suffit pas, si Albertine ne veut pas obéir à sa tante et pose comme condition de son retour qu’elle aura désormais sa pleine indépendance, eh bien ! quelque chagrin que cela me fasse, je la lui laisserai ; elle sortira seule, comme elle voudra. Il faut savoir consentir des sacrifices, si douloureux qu’ils soient, pour la chose à laquelle on tient le plus et qui, malgré ce que je croyais ce matin d’après mes raisonnements exacts et absurdes, est qu’Albertine vive ici. » Puis-je dire, du reste, que lui laisser cette liberté m’eût été tout à fait douloureux ? Je mentirais. Souvent déjà j’avais senti que la souffrance de la laisser libre de faire le mal loin de moi était peut-être moindre encore que ce genre de tristesse qu’il m’arrivait d’éprouver à la sentir s’ennuyer, avec moi, chez moi. Sans doute, au moment même où elle m’eût demandé à partir quelque part, la laisser faire, avec l’idée qu’il y avait des orgies organisées, m’eût été atroce. Mais lui dire : prenez notre bateau, ou le train, partez pour un mois, dans tel pays que je ne connais pas, où je ne saurai rien de ce que vous ferez, cela m’avait souvent plu par l’idée que par comparaison, loin de moi, elle me préférerait, et serait heureuse au retour. « Ce retour, elle-même le désire sûrement ; elle n’exige nullement cette liberté à laquelle d’ailleurs, en lui offrant chaque jour des plaisirs nouveaux, j’arriverais aisément à obtenir, jour par jour, quelque limitation. Non, ce qu’Albertine a voulu, c’est que je ne sois plus insupportable avec elle, et surtout – comme autrefois Odette avec Swann – que je me décide à l’épouser. Une fois épousée, son indépendance, elle n’y tiendra pas ; nous resterons tous les deux ici, si heureux. » Sans doute c’était renoncer à Venise. Mais que les villes les plus désirées comme Venise (à plus forte raison les maîtresses de maison les plus agréables, comme la duchesse de Guermantes, les distractions comme le théâtre) deviennent pâles, indifférentes, mortes, quand nous sommes liés à un autre cœur par un lien si douloureux qu’il nous empêche de nous éloigner. « Albertine a, d’ailleurs, parfaitement raison dans cette question de mariage. Maman elle-même trouvait tous ces retards ridicules. L’épouser, c’est ce que j’aurais dû faire depuis longtemps, c’est ce qu’il faudra que je fasse, c’est cela qui lui a fait écrire sa lettre dont elle ne pense pas un mot ; c’est seulement pour faire réussir cela qu’elle a renoncé pour quelques heures à ce qu’elle doit désirer autant que je désire qu’elle le fasse : revenir ici. Oui, c’est cela qu’elle a voulu, c’est cela l’intention de son acte », me disait ma raison compatissante ; mais je sentais qu’en me le disant ma raison se plaçait toujours dans la même hypothèse qu’elle avait adoptée depuis le début. Or je sentais bien que c’était l’autre hypothèse qui n’avait jamais cessé d’être vérifiée. Sans doute cette deuxième hypothèse n’aurait jamais été assez hardie pour formuler expressément qu’Albertine eût pu être liée avec Mlle Vinteuil et son amie. Et pourtant, quand j’avais été submergé par l’envahissement de cette nouvelle terrible, au moment où nous entrions en gare d’Incarville, c’était la seconde hypothèse qui s’était déjà trouvée vérifiée. Celle-ci n’avait ensuite jamais conçu qu’Albertine pût me quitter d’elle-même, de cette façon, sans me prévenir et me donner le temps de l’en empêcher. Mais tout de même, si après le nouveau bond immense que la vie venait de me faire faire, la réalité qui s’imposait à moi m’était aussi nouvelle que celle en face de quoi nous mettent la découverte d’un physicien, les enquêtes d’un juge d’instruction ou les trouvailles d’un historien sur les dessous d’un crime ou d’une révolution, cette réalité en dépassant les chétives prévisions de ma deuxième hypothèse pourtant les accomplissait. Cette deuxième hypothèse n’était pas celle de l’intelligence, et la peur panique que j’avais eue le soir où Albertine ne m’avait pas embrassé, la nuit où j’avais entendu le bruit de la fenêtre, cette peur n’était pas raisonnée. Mais – et la suite le montrera davantage, comme bien des épisodes ont pu déjà l’indiquer – de ce que l’intelligence n’est pas l’instrument le plus subtil, le plus puissant, le plus approprié pour saisir le vrai, ce n’est qu’une raison de plus pour commencer par l’intelligence et non par un intuitivisme de l’inconscient, par une foi aux pressentiments toute faite. C’est la vie qui peu à peu, cas par cas, nous permet de remarquer que ce qui est le plus important pour notre cœur, ou pour notre esprit, ne nous est pas appris par le raisonnement mais par des puissances autres. Et alors, c’est l’intelligence elle-même qui, se rendant compte de leur supériorité, abdique par raisonnement devant elles et accepte de devenir leur collaboratrice et leur servante. C’est la foi expérimentale. Le malheur imprévu avec lequel je me trouvais aux prises, il me semblait l’avoir lui aussi (comme l’amitié d’Albertine avec deux Lesbiennes) déjà connu pour l’avoir lu dans tant de signes où (malgré les affirmations contraires de ma raison, s’appuyant sur les dires d’Albertine elle-même) j’avais discerné la lassitude, l’horreur qu’elle avait de vivre ainsi en esclave, signes tracés comme avec de l’encre invisible à l’envers des prunelles tristes et soumises d’Albertine, sur ses joues brusquement enflammées par une inexplicable rougeur, dans le bruit de la fenêtre qui s’était brusquement ouverte. Sans doute je n’avais pas osé les interpréter jusqu’au bout et former expressément l’idée de son départ subit. Je n’avais pensé, d’une âme équilibrée par la présence d’Albertine, qu’à un départ arrangé par moi à une date indéterminée, c’est-à-dire situé dans un temps inexistant ; par conséquent j’avais eu seulement l’illusion de penser à un départ, comme les gens se figurent qu’ils ne craignent pas la mort quand ils y pensent alors qu’ils sont bien portants, et ne font en réalité qu’introduire une idée purement négative au sein d’une bonne santé que l’approche de la mort précisément altérerait. D’ailleurs l’idée du départ d’Albertine voulu par elle-même eût pu me venir mille fois à l’esprit, le plus clairement, le plus nettement du monde, que je n’aurais pas soupçonné davantage ce que serait relativement à moi, c’est-à-dire en réalité, ce départ, quelle chose originale, atroce, inconnue, quel mal entièrement nouveau. À ce départ, si je l’eusse prévu, j’aurais pu songer sans trêve pendant des années, sans que, mises bout à bout, toutes ces pensées eussent eu le plus faible rapport, non seulement d’intensité mais de ressemblance, avec l’inimaginable enfer dont Françoise m’avait levé le voile en me disant : « Mademoiselle Albertine est partie. » Pour se représenter une situation inconnue l’imagination emprunte des éléments connus et à cause de cela ne se la représente pas. Mais la sensibilité, même la plus physique, reçoit, comme le sillon de la foudre, la signature originale et longtemps indélébile de l’événement nouveau. Et j’osais à peine me dire que, si j’avais prévu ce départ, j’aurais peut-être été incapable de me le représenter dans son horreur, et même, Albertine me l’annonçant, moi la menaçant, la suppliant, de l’empêcher ! Que le désir de Venise était loin de moi maintenant ! Comme autrefois à Combray celui de connaître Madame de Guermantes, quand venait l’heure où je ne tenais plus qu’à une seule chose, avoir maman dans ma chambre. Et c’était bien, en effet, toutes les inquiétudes éprouvées depuis mon enfance, qui, à l’appel de l’angoisse nouvelle, avaient accouru la renforcer, s’amalgamer à elle en une masse homogène qui m’étouffait. Certes, ce coup physique au cœur que donne une telle séparation et qui, par cette terrible puissance d’enregistrement qu’a le corps, fait de la douleur quelque chose de contemporain à toutes les époques de notre vie où nous avons souffert, certes, ce coup au cœur sur lequel spécule peut-être un peu – tant on se soucie peu de la douleur des autres – la femme qui désire donner au regret son maximum d’intensité, soit que, n’esquissant qu’un faux départ, elle veuille seulement demander des conditions meilleures, soit que, partant pour toujours – pour toujours ! – elle désire frapper, ou pour se venger, ou pour continuer d’être aimée, ou dans l’intérêt de la qualité du souvenir qu’elle laissera, briser violemment ce réseau de lassitudes, d’indifférences, qu’elle avait senti se tisser, – certes, ce coup au cœur, on s’était promis de l’éviter, on s’était dit qu’on se quitterait bien. Mais il est vraiment rare qu’on se quitte bien, car, si on était bien, on ne se quitterait pas ! Et puis la femme avec qui on se montre le plus indifférent sent tout de même obscurément qu’en se fatiguant d’elle, en vertu d’une même habitude, on s’est attaché de plus en plus à elle, et elle songe que l’un des éléments essentiels pour se quitter bien est de partir en prévenant l’autre. Or elle a peur en prévenant d’empêcher. Toute femme sent que, si son pouvoir sur un homme est grand, le seul moyen de s’en aller, c’est de fuir. Fugitive parce que reine, c’est ainsi. Certes, il y a un intervalle inouï entre cette lassitude qu’elle inspirait il y a un instant et, parce qu’elle est partie, ce furieux besoin de la ravoir. Mais à cela, en dehors de celles données au cours de cet ouvrage et d’autres qui le seront plus loin, il y a des raisons. D’abord le départ a lieu souvent dans le moment où l’indifférence – réelle ou crue – est la plus grande, au point extrême de l’oscillation du pendule. La femme se dit : « Non, cela ne peut plus durer ainsi », justement parce que l’homme ne parle que de la quitter, ou y pense ; et c’est elle qui quitte. Alors, le pendule revenant à son autre point extrême, l’intervalle est le plus grand. En une seconde il revient à ce point ; encore une fois, en dehors de toutes les raisons données, c’est si naturel ! Le cœur bat ; et d’ailleurs la femme qui est partie n’est plus la même que celle qui était là. Sa vie auprès de nous, trop connue, voit tout d’un coup s’ajouter à elle les vies auxquelles elle va inévitablement se mêler, et c’est peut-être pour se mêler à elles qu’elle nous a quittés. De sorte que cette richesse nouvelle de la vie de la femme en allée rétroagit sur la femme qui était auprès de nous et peut-être préméditait son départ. À la série des faits psychologiques que nous pouvons déduire et qui font partie de sa vie avec nous, de notre lassitude trop marquée pour elle, de notre jalousie aussi (et qui fait que les hommes qui ont été quittés par plusieurs femmes l’ont été presque toujours de la même manière à cause de leur caractère et de réactions toujours identiques qu’on peut calculer ; chacun a sa manière propre d’être trahi, comme il a sa manière de s’enrhumer), à cette série pas trop mystérieuse pour nous correspondait sans doute une série de faits que nous avons ignorés. Elle devait depuis quelque temps entretenir des relations écrites, ou verbales, ou par messagers, avec tel homme, ou telle femme, attendre tel signe que nous avons peut-être donné nous-mêmes sans le savoir en disant : « M. X. est venu hier pour me voir », si elle avait convenu avec M. X. que la veille du jour où elle devrait rejoindre M. X., celui-ci viendrait me voir. Que d’hypothèses possibles ! Possibles seulement. Je construisais si bien la vérité, mais dans le possible seulement, qu’ayant un jour ouvert, et par erreur, une lettre adressée à ma maîtresse, cette lettre écrite en style convenu et qui disait : « Attends toujours signe pour aller chez le marquis de Saint-Loup, prévenez demain par coup de téléphone », je reconstituai une sorte de fuite projetée ; le nom du marquis de Saint-Loup n’était là que pour signifier autre chose, car ma maîtresse ne connaissait pas suffisamment Saint-Loup, mais m’avait entendu parler de lui, et, d’ailleurs, la signature était une espèce de surnom, sans aucune forme de langage. Or la lettre n’était pas adressée à ma maîtresse, mais à une personne de la maison qui portait un nom différent et qu’on avait mal lu. La lettre n’était pas en signes convenus mais en mauvais français parce qu’elle était d’une Américaine, effectivement amie de Saint-Loup comme celui-ci me l’apprit. Et la façon étrange dont cette Américaine formait certaines lettres avait donné l’aspect d’un surnom à un nom parfaitement réel mais étranger. Je m’étais donc ce jour-là trompé du tout au tout dans mes soupçons. Mais l’armature intellectuelle qui chez moi avait relié ces faits, tous faux, était elle-même la forme si juste, si inflexible de la vérité que quand trois mois plus tard ma maîtresse, qui alors songeait à passer toute sa vie avec moi, m’avait quitté, ç’avait été d’une façon absolument identique à celle que j’avais imaginée la première fois. Une lettre vint ayant les mêmes particularités que j’avais faussement attribuées à la première lettre, mais cette fois-ci ayant bien le sens d’un signal.
Ce malheur était le plus grand de toute ma vie. Et malgré tout, la souffrance qu’il me causait était peut-être dépassée encore par la curiosité de connaître les causes de ce malheur qu’Albertine avait désiré, retrouvé. Mais les sources des grands événements sont comme celles des fleuves, nous avons beau parcourir la surface de la terre, nous ne les retrouvons pas. Albertine avait-elle ainsi prémédité depuis longtemps sa fuite ? j’ai dit (et alors cela m’avait paru seulement du maniérisme et de la mauvaise humeur, ce que Françoise appelait faire la « tête ») que, du jour où elle avait cessé de m’embrasser, elle avait eu un air de porter le diable en terre, toute droite, figée, avec une voix triste dans les plus simples choses, lente en ses mouvements, ne souriant plus jamais. Je ne peux pas dire qu’aucun fait prouvât aucune connivence avec le dehors. Françoise me raconta bien ensuite qu’étant entrée l’avant-veille du départ dans sa chambre elle n’y avait trouvé personne, les rideaux fermés, mais sentant à l’odeur de l’air et au bruit que la fenêtre était ouverte. Et, en effet, elle avait trouvé Albertine sur le balcon. Mais on ne voit pas avec qui elle eût pu, de là, correspondre, et, d’ailleurs, les rideaux fermés sur la fenêtre ouverte s’expliquaient sans doute parce qu’elle savait que je craignais les courants d’air et que, même si les rideaux m’en protégeaient peu, ils eussent empêché Françoise de voir du couloir que les volets étaient ouverts aussi tôt. Non, je ne vois rien sinon un petit fait qui prouve seulement que la veille elle savait qu’elle allait partir. La veille, en effet, elle prit dans ma chambre sans que je m’en aperçusse une grande quantité de papier et de toile d’emballage qui s’y trouvait, et à l’aide desquels elle emballa ses innombrables peignoirs et sauts de lit toute la nuit afin de partir le matin ; c’est le seul fait, ce fut tout. Je ne peux pas attacher d’importance à ce qu’elle me rendit presque de force ce soir-là mille francs qu’elle me devait, cela n’a rien de spécial, car elle était d’un scrupule extrême dans les choses d’argent. Oui, elle prit les papiers d’emballage la veille, mais ce n’était pas de la veille seulement qu’elle savait qu’elle partirait ! Car ce n’est pas le chagrin qui la fit partir, mais la résolution prise de partir, de renoncer à la vie qu’elle avait rêvée qui lui donna cet air chagrin. Chagrin, presque solennellement froid avec moi, sauf le dernier soir, où, après être restée chez moi plus tard qu’elle ne voulait, dit-elle – remarque qui m’étonnait venant d’elle qui voulait toujours prolonger, – elle me dit de la porte : « Adieu, petit, adieu, petit. » Mais je n’y pris pas garde au moment. Françoise m’a dit que le lendemain matin, quand elle lui dit qu’elle partait (mais, du reste, c’est explicable aussi par la fatigue, car elle ne s’était pas déshabillée et avait passé toute la nuit à emballer, sauf les affaires qu’elle avait à demander à Françoise et qui n’étaient pas dans sa chambre et son cabinet de toilette), elle était encore tellement triste, tellement plus droite, tellement plus figée que les jours précédents que Françoise crut quand elle lui dit : « Adieu, Françoise » qu’elle allait tomber. Quand on apprend ces choses-là, on comprend que la femme qui vous plaisait tellement moins maintenant que toutes celles qu’on rencontre si facilement dans les plus simples promenades, à qui on en voulait de les sacrifier pour elle, soit au contraire celle qu’on préférerait mille fois. Car la question ne se pose plus entre un certain plaisir – devenu par l’usage, et peut-être par la médiocrité de l’objet, presque nul – et d’autres plaisirs, ceux-là tentants, ravissants, mais entre ces plaisirs-là et quelque chose de bien plus fort qu’eux, la pitié pour la douleur.
En me promettant à moi-même qu’Albertine serait ici ce soir, j’avais couru au plus pressé et pansé d’une croyance nouvelle l’arrachement de celle avec laquelle j’avais vécu jusqu’ici. Mais si rapidement qu’eût agi mon instinct de conservation, j’étais, quand Françoise m’avait parlé, resté une seconde sans secours, et j’avais beau savoir maintenant qu’Albertine serait là ce soir, la douleur que j’avais ressentie pendant l’instant où je ne m’étais pas encore appris à moi-même ce retour (l’instant qui avait suivi les mots : « Mademoiselle Albertine a demandé ses malles, Mademoiselle Albertine est partie »), cette douleur renaissait d’elle-même en moi pareille à ce qu’elle avait été, c’est-à-dire comme si j’avais ignoré encore le prochain retour d’Albertine. D’ailleurs il fallait qu’elle revînt, mais d’elle-même. Dans toutes les hypothèses, avoir l’air de faire faire une démarche, de la prier de revenir irait à l’encontre du but. Certes je n’avais plus la force de renoncer à elle comme je l’avais eue pour Gilberte. Plus même que revoir Albertine, ce que je voulais c’était mettre fin à l’angoisse physique que mon cœur plus mal portant que jadis ne pouvait plus tolérer. Puis à force de m’habituer à ne pas vouloir, qu’il s’agît de travail ou d’autre chose, j’étais devenu plus lâche. Mais surtout cette angoisse était incomparablement plus forte pour bien des raisons dont la plus importante n’était peut-être pas que je n’avais jamais goûté de plaisir sensuel avec Mme de Guermantes et avec Gilberte, mais que, ne les voyant pas chaque jour, à toute heure, n’en ayant pas la possibilité et par conséquent pas le besoin, il y avait en moins, dans mon amour pour elles, la force immense de l’Habitude. Peut-être, maintenant que mon cœur, incapable de vouloir et de supporter de son plein gré la souffrance, ne trouvait qu’une seule solution possible, le retour à tout prix d’Albertine, peut-être la solution opposée (le renoncement volontaire, la résignation progressive) m’eût-elle paru une solution de roman, invraisemblable dans la vie, si je n’avais moi-même autrefois opté pour celle-là quand il s’était agi de Gilberte. Je savais donc que cette autre solution pouvait être acceptée aussi, et par un seul homme, car j’étais resté à peu près le même. Seulement le temps avait joué son rôle, le temps qui m’avait vieilli, le temps aussi qui avait mis Albertine perpétuellement auprès de moi quand nous menions notre vie commune. Mais du moins, sans renoncer à elle, ce qui me restait de ce que j’avais éprouvé...