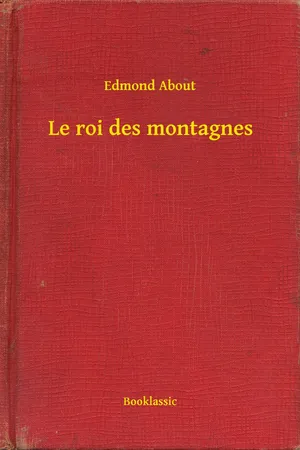Le 3 juillet de cette année, vers six heures
du matin, j’arrosais mes pétunias sans songer à mal, quand je vis
entrer un grand jeune homme blond, imberbe, coiffé d’une casquette
allemande et paré de lunettes d’or. Un ample paletot de lasting
flottait mélancoliquement autour de sa personne, comme une voile le
long d’un mât lorsque le vent vient à tomber. Il ne portait pas de
gants ; ses souliers de cuir écru reposaient sur de puissantes
semelles, si larges, que le pied était entouré d’un petit trottoir.
Dans sa poche de côté, vers la région du cœur, une grande pipe de
porcelaine se modelait en relief et dessinait vaguement son profil
sous l’étoffe luisante. Je ne songeai pas même à demander à cet
inconnu s’il avait fait ses études dans les universités
d’Allemagne ; je déposai mon arrosoir, et je le saluai d’un
beau : Guten Morgen.
– Monsieur, me dit-il en français, mais
avec un accent déplorable, je m’appelle Hermann Schultz ; je
viens de passer quelques mois en Grèce, et votre livre a voyagé
partout avec moi.
Cet exorde pénétra mon cœur d’une douce
joie ; la voix de l’étranger me parut plus mélodieuse que la
musique de Mozart, et je dirigeai vers ses lunettes d’or un regard
étincelant de reconnaissance. Vous ne sauriez croire, ami lecteur,
combien nous aimons ceux qui ont pris la peine de déchiffrer notre
grimoire. Quant à moi, si j’ai jamais souhaité d’être riche, c’est
pour assurer des rentes à tous ceux qui m’ont lu.
Je le pris par la main, cet excellent jeune
homme. Je le fis asseoir sur le meilleur banc du jardin, car nous
en avons deux. Il m’apprit qu’il était botaniste et qu’il avait une
mission du Jardin des Plantes de Hambourg. Tout en complétant son
herbier, il avait observé de son mieux le pays, les bêtes et les
gens. Ses descriptions naïves, ses vues, courtes mais justes, me
rappelaient un peu la manière du bonhomme Hérodote. Il s’exprimait
lourdement, mais avec une candeur qui imposait la confiance ;
il appuyait sur ses paroles du ton d’un homme profondément
convaincu. Il put me donner des nouvelles, sinon de toute la ville
d’Athènes, au moins des principaux personnages que j’ai nommés dans
mon livre. Dans le cours de la conversation, il énonça quelques
idées générales qui me parurent d’autant plus judicieuses que je
les avais développées avant lui. Au bout d’une heure d’entretien,
nous étions intimes.
Je ne sais lequel de nous deux prononça le
premier le mot de brigandage. Les voyageurs qui ont couru l’Italie
parlent peinture ; ceux qui ont visité l’Angleterre parlent
industrie : chaque pays a sa spécialité.
– Mon cher monsieur, demandai-je au
précieux inconnu, avez-vous rencontré des brigands ? Est-il
vrai, comme on l’a prétendu, qu’il y ait encore des brigands en
Grèce ?
– Il n’est que trop vrai, répondit-il
gravement. J’ai vécu quinze jours dans les mains du terrible
Hadgi-Stavros, surnommé le Roi des montagnes ; j’en puis donc
parler par expérience. Si vous êtes de loisir, et qu’un long récit
ne vous fasse pas peur, je suis prêt à vous donner les détails de
mon aventure. Vous en ferez ce qu’il vous plaira : un roman,
une nouvelle, ou plutôt (car c’est de l’histoire) un chapitre
additionnel pour ce petit livre où vous avez entassé de si
curieuses vérités.
– Vous êtes vraiment trop bon, lui
dis-je, et mes deux oreilles sont à vos ordres. Entrons dans mon
cabinet de travail. Nous y aurons moins chaud qu’au jardin, et
cependant l’odeur des résédas et des pois musqués arrivera jusqu’à
nous.
Il me suivit de fort bonne grâce, et tout en
marchant, il fredonnait en grec un chant populaire :
Un Clephte aux
yeux noirs descend dans les plaines ;
Son fusil doré
sonne à chaque pas ;
Il dit aux
vautours : « Ne me quittez pas,
Je vous
servirai le pacha d’Athènes ! »
Il s’établit sur un divan, replia ses jambes
sous lui, comme les conteurs arabes, ôta son paletot pour se mettre
au frais, alluma sa pipe et commença le récit de son histoire.
J’étais à mon bureau, et je sténographiais sous sa dictée.
J’ai toujours été sans défiance, surtout avec
ceux qui me font des compliments. Toutefois l’aimable étranger me
contait des choses si surprenantes, que je me demandai à plusieurs
reprises s’il ne se moquait pas de moi. Mais sa parole était si
assurée, ses yeux bleus m’envoyaient un regard si limpide, que mes
éclairs de scepticisme s’éteignaient au même instant.
Il parla, sans désemparer, jusqu’à midi et
demi. S’il s’interrompit deux ou trois fois, ce fut pour rallumer
sa pipe. Il fumait régulièrement, par bouffées égales, comme la
cheminée d’une machine à vapeur. Chaque fois qu’il m’arrivait de
jeter les yeux sur lui, je le voyais tranquille et souriant, au
milieu d’un nuage, comme Jupiter au cinquième acte
d’Amphitryon.
On vint nous annoncer que le déjeuner était
servi. Hermann s’assit en face de moi, et les légers soupçons qui
me trottaient par la tête ne tinrent pas devant son appétit. Je me
disais qu’un bon estomac accompagne rarement une mauvaise
conscience. Le jeune Allemand était trop bon convive pour être
narrateur infidèle, et sa voracité me répondait de sa véracité.
Frappé de cette idée, je confessai, en lui offrant des fraises, que
j’avais douté un instant de sa bonne foi. Il me répondit par un
sourire angélique.
Je passai la journée en tête-à-tête avec mon
nouvel ami, et je ne me plaignis pas de la lenteur du temps. À cinq
heures du soir, il éteignit sa pipe, endossa son paletot, et me
serra la main en me disant adieu. Je lui répondis :
– Au revoir !
– Non pas, reprit-il en secouant la
tête : je pars aujourd’hui par le train de sept heures, et je
n’ose espérer de vous revoir jamais.
– Laissez-moi votre adresse. Je n’ai pas
encore renoncé aux plaisirs du voyage, et je passerai peut-être par
Hambourg.
– Malheureusement, je ne sais pas
moi-même où je planterai ma tente. L’Allemagne est vaste ; il
n’est pas dit que je resterai citoyen de Hambourg.
– Mais, si je publie votre histoire, au
moins faut-il que je puisse vous en envoyer un exemplaire.
– Ne prenez pas cette peine. Sitôt que le
livre aura paru, il sera contrefait à Leipzig, chez Wolfgang
Gerhard, et je le lirai. Adieu.
Lui parti, je relus attentivement le récit
qu’il m’avait dicté ; j’y trouvai quelques détails
invraisemblables, mais rien qui contredît formellement ce que
j’avais vu et entendu pendant mon séjour en Grèce.
Cependant, au moment de donner le manuscrit à
l’impression, un scrupule me retint : s’il s’était glissé
quelques erreurs dans la narration d’Hermann ! En ma qualité
d’éditeur, n’étais-je pas un peu responsable ? Publier sans
contrôle l’histoire du Roi des montagnes, n’était-ce pas m’exposer
aux réprimandes paternelles du Journal des Débats, aux
démentis des gazetiers d’Athènes, et aux grossièretés du
Spectateur de l’Orient ? Cette feuille clairvoyante a
déjà inventé que j’étais bossu : fallait-il lui fournir une
occasion de m’appeler aveugle ?
Dans ces perplexités, je pris le parti de
faire deux copies du manuscrit. J’envoyai la première à un homme
digne de foi, un Grec d’Athènes, Mr Patriotis Pseftis. Je le priai
de me signaler, sans ménagement et avec une sincérité grecque,
toutes les erreurs de mon jeune ami, et je lui promis d’imprimer sa
réponse à la fin du volume.
En attendant, je livre à la curiosité publique
le texte même du récit d’Hermann. Je n’y changerai pas un mot, je
respecterai jusqu’aux plus énormes invraisemblances. Si je me
faisais le correcteur du jeune Allemand, je deviendrais, par le
fait, son collaborateur. Je me retire discrètement ; je lui
cède la place et la parole ; mon épingle est hors du
jeu : c’est Hermann qui vous parle en fumant sa pipe de
porcelaine et en souriant derrière ses lunettes d’or.