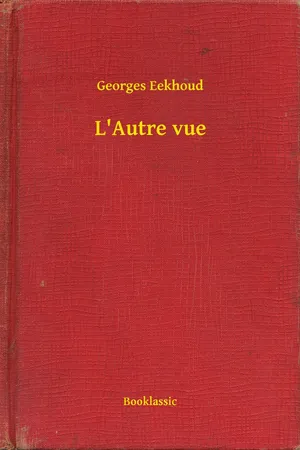Hast du die gute Gesellschaft gesehen ?
Gute Gesellschaft habe ich gesehen ; man nennt sie die gute Weil sie zum kleinsten Gedicht keine Gelegenheit gibt.
Gœthe (Venetianische Epigramme)
Les papiers publics se sont beaucoup occupés d’une affaire mystérieuse : celle de ce jeune fossoyeur condamné à six mois de prison pour violation de sépulture et emporté depuis par une fièvre cérébrale. Ils ont mis en cause, son nom ayant été mêlé aux débats judiciaires, feu M. Laurent Paridael, cousin de Régina Dobouziez, ma femme, laquelle avait épousé en premières noces M. Freddy Béjard qui périt si misérablement avec la plupart de ses ouvriers dans l’explosion de sa cartoucherie[1]. Notre parent Laurent Paridael fut aussi relevé pour mort sur le terrain de la catastrophe. Plût à Dieu qu’il n’en eût pas réchappé. Il n’aurait plus traîné alors une vie déclassée, il se serait épargné de mourir plus piteusement encore par un suicide, après force excentricités. Son honorable famille n’eut point subi l’humiliation de voir son nom accolé à celui d’un malfaiteur et sa mémoire exposée aux commentaires d’une presse friande de scandales.
Sans doute, il me répugne de remuer ces souvenirs, mais il a circulé tant de racontars sur le caractère et la conduite de notre infortuné parent que j’ai jugé indispensable de rectifier les faits.
Ce fut un personnage déconcertant, qui porta un défi aux convenances, mais il s’était fait une idée spéciale de l’humanité et de la nature, et en tenant compte de cette vision particulière, on reconnaîtra qu’il apporta certaine logique dans ses écarts et qu’il concilia ceux-ci avec une générosité chevaleresque ressemblant à une manière d’apostolat.
Je l’ai intimement pratiqué, surtout avant mon mariage avec sa cousine Mme veuve Béjard. Nos bons rapports subsistèrent jusqu’à ce que ses anomalies fussent devenues si flagrantes que sans rompre avec lui, je me vis forcé, par égard pour mon rang et mes relations, de ne plus m’afficher en sa compagnie.
De son côté, il me conserva toujours une certaine estime. En mourant, il m’a confié le manuscrit de son journal, une sorte de confession par laquelle il désirait se justifier à mes yeux.
La lecture de ces cahiers, jointe à ce que je savais par expérience de la destinée du pauvre garçon, m’a laissé assez perplexe, partagé entre de la commisération et de la répugnance ; néanmoins, ces confidences, même les plus imprévues, me permettent de conclure à la loyauté et au caractère magnanime du défunt ; elles révèlent une rare intelligence, de brillantes quoique bizarres facultés, une sensibilité spéciale, de la perversion, mais non de la perversité. Après les avoir lues, tout lecteur de bonne foi partagera ma conviction que Paridael fut avant tout un malheureux, à la fois son propre bourreau et sa propre victime. Aussi est-ce pour l’édification des honnêtes gens que je me décide à publier ces feuillets. Ma première intention avait été de les brûler après en avoir pris connaissance, mais, en présence des calomnies dont la mémoire de Paridael fut accablée par les gazettes, je me crois un devoir de les produire au grand jour.
Je me suis simplement permis de compléter, par ma connaissance du personnage, ce qu’il aura révélé sur lui-même.
L’avouerai-je ? En recopiant ces pages, maintes fois troublé plus qu’il n’aurait convenu, j’éprouvais la sensation d’une force vive perdue pour la société et pour la patrie. Malgré leur ton crispé, ces épanchements dégagent un tel charme que, j’en arrivais à douter de mon bon sens. Est-ce lui ou moi qui vois mal ? me demandais-je, tant il règne de conviction dans ces accents, et tant le dévoyé s’interprète avec cohérence.
En livrant ces mémoires à la publicité, je me flatte aussi de rendre service aux savants qui s’occupent de nos psychoses et qui nous prémunissent contre les écarts de ce que, dans notre infatuation, nous avons qualifié de génie. Le cas de Paridael me paraît, certes, de nature à intéresser ces spécialistes. Un problème d’un ordre extrêmement actuel se rattache à sa fin comme aussi à la mésaventure de cet obscur manœuvre dont je parlais en commençant.
Après ces indispensables prolégomènes, je me reporterai à l’époque où je fis la connaissance de Laurent Paridael.
Ce fut lors d’un dîner sans cérémonie chez M. et Mme Dobouziez, les grands industriels, fabricants de bougies stéariques, mes futurs beaux-parents. Orphelin depuis deux ans et placé par ses tuteurs, mes amphytrions[2], dans un collège lointain, le jeune Laurent était venu passer ses vacances au pays.
Nous nous étions mis à table. M. Dobouziez servait le potage. Les domestiques continuaient à réclamer Laurent à cor et à cri, l’un au pied de l’escalier, l’autre à la porte de la rue, un troisième à celle du jardin. Le retardataire accourut enfin essoufflé et tout en nage. C’était un garçon de figure intéressante, très solide pour ses quatorze ans, un large front offusqué par des broussailles de cheveux châtains, de grands yeux caves et cernés, le regard farouche d’une bête traquée, la bouche assez forte plissée par une expression précoce de malaise et d’amertume. Des écorchures aux joues et aux mains, un costume neuf couvert de boue et déjà troué, indiquaient un tempérament de casse-cou et un adepte des exercices violents.
En le voyant équipé de cette façon, M. Dobouziez fronça les sourcils et le foudroya du regard :
– Comme vous voilà fait ! Allons, dépêchez-vous de monter à votre chambre et ne revenez que lorsque vous serez présentable !
Mes hôtes profitèrent de son absence pour me confier les tracas qu’il leur causait. Cet enfant décourageait leurs meilleures intentions. Malgré son intelligence, il faisait le désespoir de ses maîtres. Au lieu de s’appliquer à l’étude des connaissances utiles, il se bourrait la tête de billevesées et de mauvaises lectures ; il se chamaillait avec ses camarades, fomentait l’insubordination, se démenait comme un diable, commettait incartade sur incartade.
Depuis son retour, ses tuteurs en étaient encore à attendre une première marque de tendresse. Il se dérobait à leurs avances, affectait de ne leur parler que lorsqu’ils l’interrogeaient et profitait de toutes les occasions pour leur fausser compagnie. Quand il ne se verrouillait pas dans sa chambre, il polissonnait à la rue ou bien, ce que M. et Mme Dobouziez voyaient surtout de mauvais œil, il courait s’encanailler, comme ils disaient, avec les ouvriers de leur usine. Moi qui représente l’opinion démocratique au Parlement et qui suis né dans l’arrière-boutique de tout petits mareyeurs, au fond d’une impasse voisine du marché au poisson, je ne partageais pas tout à fait la manière de voir de mes amphytrions au sujet du plaisir que Laurent prenait avec leurs braves travailleurs.
Lorsqu’il reparut à table, après s’être débarbouillé et rafistolé, je me mis en frais de conversation avec lui. Il accueillit assez mal mes avances ; mais à notre rencontre suivante il se dégela et j’étais parvenu à l’apprivoiser, quand il reprit le chemin du collège. Je le revis aux vacances d’après. Le potache était devenu un ferme adolescent. Ses dispositions n’avaient guère changé. Il évitait toujours les membres de sa famille et leurs connaissances pour passer tout son temps avec les chauffeurs et les magasiniers de la fabrique. De sa caste, il boudait jusqu’aux enfants de son âge.
J’étais le seul monsieur qu’il prit pour confident. La chaleur qu’il mettait à me vanter ses humbles amis flattait mes convictions politiques, favorables à un rapprochement entre capitalistes et salariés.
Voici quelques passages du journal de Laurent où sa sympathie pour les ouvriers s’exprime en des termes passablement exaltés, mais qui ne dépassent pas la mesure et qui s’accordent assez bien avec les propos qu’il me tenait à cette époque :
Je ne me lasse pas de contempler les paveurs qui travaillent depuis deux jours sous mes fenêtres. J’aime la musique de leurs « demoiselles », le timbre m’en est cher. Eux-mêmes accordent souverainement le rythme de leurs gestes à la couleur de leurs frusques et de ce que l’on voit de leur chair. Accroupis ou debout, au travail ou au repos, toujours ils me séduisent par leur dégaine plastique et ingénue. Le bleu de leurs yeux d’enfants, le corail de leurs lèvres succulentes rehausse si délicieusement leurs visages hâlés ! Je me délecte à leurs coups de reins, à leurs rejets du torse en arrière, au tortillage de leur feutre, au ratatinement de leur « marronne ». (C’est ainsi qu’en leur parler wallon ces paveurs de Soignies et de Quenast, qui rejoignirent à la grande ville les cadettes des carrières natales, désignent leurs bragues dont la couleur rappelle en effet celle des châtaignes.)
Généralement pour damer ils vont par deux. Après s’être appariés, ils crachent dans leurs mains, empoignent les hies par les manelles, esquissent une sorte de salut d’armes, et les voilà qui partent, accordant leurs gestes, pilant en cadence, l’une demoiselle retombant lorsque l’autre se relève.
Parfois ils pivotent sur eux-mêmes, se tournent le dos, s’éloignent quelque temps pour pirouetter de nouveau, se refaire vis-à-vis et se rapprocher, de la même allure réglée, sur le pas sonore de leur outil. On dirait d’une danse très lente, d’un menuet du travail.
Il leur arrive de s’arrêter pour reprendre haleine et échanger quelques puérilités auxquelles leur sourire prête une portée ineffable. Ils rejettent leur coiffe en arrière, se calent, les poings sur les hanches ou les bras croisés, les jambes un peu écartées, après s’être essuyé le front d’un revers de main ou à la manche de la chemise. Braves gens ! Leur sueur embaume autant que la sève des sapins et des rouvres ; elle est l’encens de cet office agréable au Seigneur. Quelle prière vaut leur travail ?
Hier, au tournant d’une rue dans le centre de la ville, j’entrevis un admirable jeune charretier. Il se tenait debout sur son tombereau vide, le fouet et la longe à la main, de l’air dont il eût conduit un quadrige. Il souriait d’un sourire aussi intrépide que le claquement de son fouet ou le hennissement de son cheval. En somme, pourquoi souriait-il ? Il y avait du soleil, la vie lui était bonne. Ce petit ouvrier condensait, en sa personne réjouie, tout le relief et le cachet professionnels. Il quintessenciait la corporation. Au carrefour suivant, il vira, disparut, fouet claquant, char cahotant, la bouche goulue et les yeux incendiaires, rosé et ambré, poignant de crânerie et de jeunesse : Antinoüs[3] charretier.
Tel chiffonnier, tel mendiant, me fait tomber en arrêt ; je leur demanderais de venir me voir chaque jour, de m’être un régal pour les yeux. Ces pauvres diables ignorent leur splendeur. Nul n’estimerait celle-ci comme je le fais.
Il m’arrivera de m’éprendre d’une simple voix. Un gagne-petit criant son sable, ses fagots, ses moules ; appelant les os et les drilles dans sa hotte ou sa besace, résume en une intonation toute la navrance d’un adagio. Ces haillons de voix accumulent le pathétisme d’une vie de lutte et de misère.
Je me rappelle une nuit d’été ou deux gaillards allaient et venaient en se querellant sous ma fenêtre. Réveillé en sursaut et de méchante humeur, je bondis pour envoyer ces braillards à tous les diables. M’étant penché au dehors, le charme de la nuit ou plutôt un autre charme que je ne tardai pas à m’expliquer, m’empêcha d’intervenir. Je ne parvenais pas à distinguer mes deux querelleurs ; en revanche, je les suivais des oreilles. Ils se disaient des injures en une langue que je ne saisissais pas, qui était sans doute au flamand ce que l’argot est au français. De quelles voix ils proféraient ces injures ! Sans les voir je me serais pris à les aimer pour leurs voix lyriques ! Étaient-ce des escarpes qui se disputaient un butin ou deux amis, rivaux en amour ? L’un accusait l’autre et celui-ci se défendait avec chaleur. En viendraient-ils aux prises ?
Le diapason auquel ils étaient montés me l’aurait fait craindre. Mais leurs vociférations s’apaisèrent. Leurs allées et venues dans la rue déserte me ménageaient d’inouïs effets de crescendo et de smorzando, auxquels la beauté de la nuit prêtait un fluide de plus. Au lieu d’un hourvari de larrons ou d’une attrapade entre galants, ils m’évoquaient plutôt une scène de défi dans une arène antique ou les préliminaires d’un jugement de Dieu dans une lice médiévale. L’insidieuse voix de l’un avait fini par apaiser la parole incendiaire de l’autre. Bientôt toute irritation cessa des deux parts et après s’être éloignés une dernière fois, mes inconnus tournèrent le coin pour ne plus revenir. Avec un sentiment de mélancolie je les entendis se perdre dans le lointain et me trouvai rendu au repos et au silence.
Ah ! combien je comprends ce trait de la vie de Michel-Ange, rapporté par Benvenuto Cellini dans ses Mémoires : « Les chants d’un certain Luigi Pulci étaient si beaux que le divin Buonarotti, dès qu’il savait où le trouver, ne manquait jamais d’aller le guetter. » Et Benvenuto ajoute ce détail lancinant : « Le chanteur était fils de ce Pulci qui eut la tête tranchée pour avoir abusé de sa propre fille. »
Adieu cet automne en lequel mes vingt ans se régalèrent de pommes ! Adieu les lumières d’or qui aviviez les métaux des feuillages et auréoliez mes beaux manœuvres vêtus de feuilles mortes !
Crépusculaires et automnaux entre tous sont les terrassiers : Gaillards de la campagne, nippés de velours et de boue, passés à la couleur de la glèbe qu’ils défoncent et brouettent six jours durant sur les chantiers de la grande ville. Bien découplés, musclés à plaisir avec de ronds visages ambrés ou fardés par le hâle ; des blonds avec des yeux clairs et des cheveux filasse, des bruns aux prunelles de la nuance de leurs hardes, à la tignasse noire et frisée, plus nerveux et aussi charnus que les autres. Ils se ceignent souvent les reins d’une large écharpe de flanelle rouge qui leur prête une magnifique cambrure et qui s’accorde au ton du velours boucané de leurs culottes. D’ordinaire, au travail, ils retroussent celles-ci comme leurs manches, mais leur plastique se corse particulièrement quand la visière de leur casquette plate prend la forme et rivalise avec les dimensions du fer de leurs pioches et quand ils usent de ces hautes et lourdes bottes d’égoutier que les Goncourt prisaient au point d’en écrire qu’elles « contribuent à l’admirable port du corps, au style de ceux qui les chaussent, le soulèvement de ces imposantes chaussures amenant un noble soulèvement des épaules, dans la poitrine rejetée en arrière ».
Et les Goncourt ne connaissaient que ceux de Paris. S’ils avaient vu les nôtres ! S’ils eussent hanté, à mon exemple, les abords des gares aux heures où ces journaliers des Flandres et des Polders de l’Escaut débarquent chez nous et, de préférence encore, à celle où leurs coteries allongent le pas pour regagner la station et s’enfourner dans les trains après une halte au comptoir des liquoristes. Je me représente leur retour au village où leur énervement terrorise la gent paisible, où ils manifestent des accès d’humeur camisarde, au point que l’on appela « convoi des sauvages » le train ramenant la horde de ces terrassiers turbulents.
Ils grouillaient il y a des siècles comme ils braillent et barbotent à présent, ils avaient la même mine et le même accoutrement. Mais leurs ancêtres jouèrent rudement de leurs pioches pour le salut de la patrie. Évoquons ces terrassiers d’antan :
Hardi les bougres !
Entamons la digue de Farnèse !
Et pour se donner du cœur et rythmer leur travail, nos pourfendeurs de remparts entonnent les chansons des Gueux, pendant que les redoutes espagnoles entretiennent un feu terrible sur leurs équipes.
La canonnade étouffe les voix et balaie les chanteurs. Mais d’autres braves accourent à la place des camarades et reprennent leur pioche en même temps que leur refrain.
Vivent les Gueux !
Les Espagnols se ruent à l’assaut de la digue. L’étroite bande de terre devient le théâtre de désespérés, corps à corps. Les Poldériens écrasés sous le nombre et n’ayant que leurs outils pour se défendre semblent devoir succomber. Mais tandis que les uns se battent, de l’eau jusqu’au ventre, les autres continuent à creuser la terre. Des couples roulent le long du talus et vont se noyer dans le fleuve sans lâcher prise. Les Espagnols réparent les brèches avec les cadavres des terrassiers. Beaucoup fouirent leur propre fosse… Les survivants, réduits à une poignée, n’en piochent pas moins allègrement pour cela. Encore un coup, par ici !
Victoire ! L’Escaut roule ses flots dans la plaine. Les terrassiers s’embrassent en pleurant de joie. Une galère zélandaise chargée de vivres rame vers Anvers.
Vivent les Gueux !
Pauvre Laurent ! Que ne persévéra-t-il dans ces sentiments patriotiques et pourquoi s’avisa-t-il d’étendre aux gueux pour de bon son enthousiasme pour les Gueux historiques ?
À la suite d’une fugue qui le brouilla avec les siens, livré à lui-même et maître de son petit patrimoine, il ne tarda pas à satisfaire ses goûts d’encanaillement. Quoiqu’il eût encouru la disgrâce de sa famille j’avais continué à le voir. Ainsi que nos amis communs le peintre Marbol et le musicien Vyvéloy, je me plaignais même de ne pas le voir assez souvent.
Je ne suis pas le premier venu. La considération dont je jouis sur la place, les suffrages de mes amis politiques, suffiraient à le prouver. Néanmoins, je vous accorde qu’en ma qualité de négociant et d’homme public ma compétence ne dépasse guère les questions d’intérêt matériel et d’ordre administratif. Mais Marbol et Vyvéloy sont de vrais artistes que mon jeune cousin aurait trouvé profit à fréquenter. L’un vend ses tableaux avant qu’ils ne soient secs, les opéras de l’autre se jouent sur les scènes du monde entier. Tous les ordres chamarrent leur p...