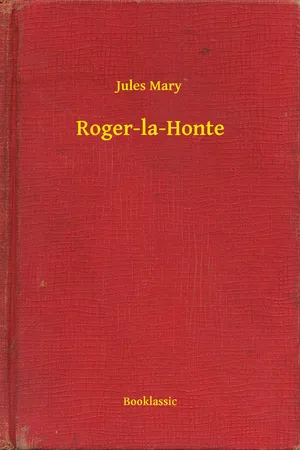Au coin de la ruelle du Montalais, qui descend au lac, et à deux pas du bois de Ville-d’Avray, s’élevait une maison de campagne, fraîche et coquette au possible derrière ses clématites et ses plantes grimpantes : vrai nid d’amoureux qui détestent le bruit et d’amants égoïstes pour qui le monde finit à leur amour.
La villa Montalais avait été achetée quelques années auparavant par M. Roger Laroque, un ingénieur-mécanicien, très connu, dont les ateliers de constructions étaient rue Saint-Maur et qui avait, en outre, un appartement particulier, boulevard Malesherbes, 117.
L’hiver, il habitait boulevard Malesherbes ; l’été, il se réfugiait à Ville-d’Avray, avec sa femme et sa fille ; mais chaque matin ses affaires le rappelaient à Paris, rue Saint-Maur ; il y déjeunait et rentrait le soir, vers sept heures, pour dîner en famille.
Le soir où commence notre récit – en juillet 1872 – à huit heures, contre son habitude très régulière, Roger Laroque n’était pas encore rentré.
Le dîner était prêt. La lampe suspendue venait d’être allumée dans une ravissante salle à manger communiquant avec une serre et tout encombrée de fleurs. Au salon, dont les fenêtres ouvraient sur une large terrasse, non plus qu’à la salle à manger, personne. Et l’on eût dit, sans les lumières, que cette maison était inhabitée, tant elle semblait calme et comme endormie au milieu des fleurs dans la nuit envahissante.
Pourtant, à gauche du salon, deux voix chuchotent. De ce côté, se trouve la chambre de Mme Laroque, encore plongée dans la demi-obscurité du crépuscule.
Deux voix, l’une superbe, grave et douce, de celles qui font aimer une femme sans la connaître, l’autre, enfantine, pareille au son du cristal, appelant le rire, les jeux et l’insouciance. C’est la mère et la fille, Henriette Laroque et Suzanne.
Mme Laroque a traîné une chaise longue auprès de la fenêtre entrouverte. Elle s’y est assise. Elle a attiré Suzanne auprès d’elle. Elles sont blondes toutes deux. L’une a vingt-cinq ans. Elle est en pleine floraison de sa beauté. L’autre a sept ans et n’est pas encore au printemps de sa vie. Elles se ressemblent.
Bien que huit heures aient sonné et que depuis plus d’une heure son mari devrait être là, Mme Laroque n’est pas trop inquiète. De quoi s’inquiéterait-elle ? Ne sait-elle pas que Roger l’adore autant qu’elle l’aime ?
Cependant, plus que d’autre jour, elle désirerait ce soir-là qu’il ne fût point en retard. Henriette et Suzanne l’attendent avec impatience et la maison elle-même, avec ses fleurs à profusion, son air souriant de fête, semble étonnée de ce silence et de cette solitude.
C’est que, justement, il y a sept ans que Suzanne est née : Suzanne, l’unique enfant, l’enfant gâtée, l’adoration du père.
Et, dans les longues heures de la journée, depuis l’avant-veille, Henriette lui fait réciter quelques mots qu’elle lui apprend par cœur et par lesquels Suzanne va souhaiter la bienvenue à Roger, dans un instant, lorsqu’il entrera.
Écoutez la voix grave de la mère et le cristal pur de la petite fille, chuchotant, n’osant parler haut, afin de conserver bien à elles, pour quelques minutes encore, le mystère de leur douce surprise.
– Tu n’as pas oublié, chère enfant ?
– Oh ! non, mère, je n’ai rien oublié.
– Que diras-tu à ton père, lorsqu’il t’embrassera ?
– Je lui dirai : « Père, je t’aime depuis sept ans. Je t’aime autant que maman. Je sais que tu consacres ta vie à préparer la mienne, et que tu te fatigues pour que je sois heureuse plus tard. Mais, père chéri, je ne suis jamais si heureuse que quand tu m’embrasses. Je sais que tu es indulgent pour moi, et tous les jours je t’aime davantage, parce que, tous les jours, je vois combien tu es bon. Si je t’ai fait de la peine, père chéri, c’est sans le savoir… et je t’en demande pardon ! »
– Et tu penses ce que tu dis, n’est-ce pas, mon enfant ?
– Oh ! mère, dit la mignonne en jetant les deux bras autour du cou d’Henriette, c’est vrai, sais-tu bien que je l’aime autant que toi !
La demie de huit heures sonna.
Henriette eut un geste de surprise.
– Ton père ne dînera pas avec nous ce soir, dit-elle, viens. Je ne veux pas que tu attendes plus longtemps.
Elles passèrent dans la salle à manger.
Mme Laroque sonna pour qu’on servît. Il n’y avait, à la villa, pour tout domestique, qu’un cocher, une cuisinière et une femme de chambre, Victoire, laquelle était au service d’Henriette depuis deux jours seulement.
Le dîner fut silencieux.
Malgré elle, un vague sentiment de crainte oppressait le cœur de la jeune femme. À deux ou trois reprises, Roger s’était trouvé ainsi en retard, mais il avait eu soin de télégraphier. Ce soir, rien. Pourquoi ?
Elles revinrent à la chambre à coucher.
Une heure s’écoula. Roger ne rentrait pas.
Henriette rêvait devant la fenêtre, demi-couchée sur la chaise longue.
Victoire avait voulu allumer. Elle s’y était opposée. À quoi bon ? Elle n’avait pas envie de lire, et il faisait un clair de lune magnifique. Le ciel était d’un bleu transparent, laissant deviner de lointains infinis.
Dix heures sonnèrent.
– Tu ne dors pas, chérie ? fit Henriette.
– Non, mère, dit l’enfant dont les yeux étaient grands ouverts.
– Tu ne veux pas te coucher ?
– Oh ! non, je voudrais embrasser petit père auparavant. Henriette, tourmentée, alla s’appuyer sur le balcon, regardant vers le chemin par où Roger, venant de la gare, avait coutume d’arriver. Suzanne, auprès d’elle, regardait aussi.
La villa Montalais est isolée de Ville-d’Avray par des jardins et des arbres. En face d’elle, dans les marronniers et un peu sur la gauche, est une petite maison proprette, aux contrevents verts, donnant de plain-pied sur la rue, alors que la villa, au contraire, est séparée de la rue par une pelouse constamment rafraîchie par un jet d’eau.
La maisonnette était éclairée ; les fenêtres ouvertes laissaient voir une chambre meublée d’acajou, ayant une table au milieu et, dans le fond, une sorte de bureau-secrétaire poussé contre le mur.
Onze heures sonnèrent non loin de là, à l’église du village.
– Mon Dieu ! dit-elle, que s’est-il donc passé ?
Et, s’adressant à sa fille :
– Tu n’as pas froid ? Tu ne t’endors pas ?
– Oh ! non, mère ! il fait si bon, et je voudrais tant voir petit père !
Dans la maison d’en face, devant les fenêtres, un homme de moyenne taille venait de passer et s’asseyait à son secrétaire qu’il ouvrait. On le voyait distinctement et Henriette et Suzanne le regardaient. C’était le locataire, le père Larouette.
– Notre nouveau voisin est rentré, dit la petite.
L’homme avait tiré de sa redingote un portefeuille gonflé, l’avait vidé et éparpillait devant lui les liasses de billets de banque, des rouleaux de louis, une fortune qu’il se mit à ranger méthodiquement, comptant et recomptant avec un plaisir visible.
Henriette et Suzanne le voyaient de profil ; et, tel qu’il était placé, Larouette tournait le dos à la porte d’entrée de sa chambre.
– Qu’est-ce qu’il fait, notre voisin ? interrogea Suzanne.
– Il compte de l’argent qu’il vient de recevoir, sans doute.
On entendit le premier quart de onze heures, au carillon de l’église.
Henriette se pencha sur sa fille, et l’embrassa au front, longuement.
– Je vais appeler Victoire pour qu’elle te déshabille et te couche, dit-elle.
– Oh ! mère, encore un instant… Papa ne peut tarder…
– Non, mignonne, il se fait tard… Tu serais fatiguée.
Et la jeune femme appuya sur le bouton d’une sonnette électrique communiquant avec l’office et se remit au balcon.
Suzanne regardait dans la rue, le plus loin qu’elle pouvait voir.
Victoire entra.
– Allumez une lampe et la veilleuse, dit Henriette, puis vous prendrez Suzanne.
Au même instant, la fillette se penchait en dehors du balcon en battant des mains, riant et appelant, dans un cri de joie :
– Père ! père ! nous t’attendons… Je ne suis pas couchée !…
Un homme, en effet, remontait la rue, à quelques pas de là. Il était de haute stature, coiffé d’un chapeau gris clair et vêtu d’un pardessus d’été également gris, avec une pèlerine sur les épaules.
Au cri de Suzanne, il se jeta dans les marronniers, devant la maison.
Henriette, en se penchant, l’avait vu aussi.
– Roger ! Roger ! dit-elle, pourquoi es-tu en retard ?… Dans quelle inquiétude tu nous as mises, si tu savais !…
Mais l’homme, qu’il eût entendu ou non, ne répondait rien. Il se coulait maintenant, le dos baissé, dans les arbres, de tronc en tronc, en se rapprochant de la maison de Larouette.
Tout à coup, il eut à franchir un sentier. La lune l’éclaira encore…
– C’est Roger !… murmura Henriette, que fait-il donc ? où va-t-il ?
Suzanne, étonnée, se taisait, mais ses yeux suivaient son père avec une curiosité inquiète… Et la mère ne respirait plus… le cœur tordu par une angoisse… les mains crispées au fer du balcon… très pâle… les dents serrées… presque méconnaissable…
L’homme dépassa les arbres et pénétra furtivement dans la maison.
– Tiens ! fit Suzanne, père qui va chez le voisin !…
Quelques secondes se passèrent. Larouette se levait, et, debout près de son secrétaire, refermait les tiroirs à clef avec méthode et lenteur.
Tout à coup, il se passa derrière lui une chose qu’il ne vit pas, mais que, de leur balcon, distinguèrent Suzanne et Henriette.
La porte du fond venait de s’ouvrir doucement, sans aucun bruit, puisque Larouette n’avait pas entendu, et un homme qui paraissait de haute taille, très robuste, apparut soudain derrière lui, tournant le dos à la fenêtre.
La moitié du corps projetée hors du balcon, les yeux dilatés, Henriette regardait.
Qu’allait-il donc se passer là ? Est-ce que c’était Roger, vraiment ?…
L’homme leva les deux bras… les poings fermés… sur la tête nue de Larouette…
Henriette voulut crier, prévenir… mais une force supérieure à elle-même retint le cri dans sa gorge ; elle n’eut qu’un soupir rauque, une sorte de râle d’épouvante et dit seulement :
– Roger ! Roger ! Juste Dieu !…
La scène qui suivit ne dura qu’une seconde.
Les deux poings levés s’étaient abattus, mais Larouette au même instant se retournait, esquivant le coup. Il jeta un cri, un seul : « À l’assassin ! »
Il y eut une courte et atroce lutte. Le chapeau du meurtrier tomba – un chapeau d’été, gris, orné d’un large ruban noir.
La lampe roula sur la table, mais, avant qu’elle ne s’éteignît, une brune figure, couverte d’une épaisse barbe très noire, était apparue comme dans un éclair.
Du reste, pas d’autre bruit. Les ténèbres s’étaient faites dans la chambre. Larouette, chétif, tenta de se défendre. Le meurtrier était un colosse. Pourtant la crainte de mourir décupla les forces de la victime. Larouette se débattit, essaya de crier.
Alors, il y eut une vive lumière, puis une détonation sourde. Et ce fut tout…
Henriette s’était reculée. Ses dents claquaient. De grosses gouttes de sueur mouillaient son front. Elle avait le regard d’une folle… Et elle répétait, haletante, dans un déchirement affreux de toute sa vie :
– Roger ! Se peut-il ! Lui !… C’est horrible !
Et voilà tout à coup qu’au milieu de son égarement lui vient la pensée de sa fille, de sa fille qu’elle a oubliée pendant les cinq minutes qu’a duré ce terrible drame… de sa fille qui, la première, avait reconnu Roger.
– Suzanne ! dit-elle.
– Mère ! fait une voix très faible, derrière elle.
Alors Henriette prend l’enfant dans ses bras avec une farouche douleur.
– Tu n’as rien vu… dit-elle, haletante, dans le désordre de son esprit… tu n’as rien vu… tu n’as rien entendu… Écoute-moi bien et comprends-moi… Il faut que tu n’aies rien vu et rien entendu.
– Non, mère, je n’aurai rien vu… je n’aurai rien entendu…
Ce n’était plus la voix de cristal pur, argentine et frêle… c’était la voix grave de la mère ; grandie soudain par un abominable spectacle, la fillette distinguait clairement l’avenir.
– Tu ne diras jamais rien ?
– Jamais… que sur un ordre de toi, mère.
– C’est bien… que Dieu t’épargne la douleur… qu’il me frappe, mais qu’il ait pitié de ta faiblesse et de ton innocence !…
Elle ne pleurait pas. Seulem...