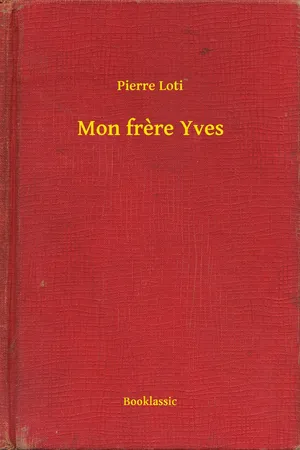Quand les vents me ramènent en Bretagne, c’est
aux derniers jours de mai, au plus beau du printemps breton.
Il y a déjà six semaines qu’Yves est dans sa
petite maison de Toulven, arrangeant ma chambre, préparant tout
pour mon arrivée.
Le navire sur lequel je suis embarqué a quitté
la Méditerranée pour remonter dans l’Océan, vers les ports du Nord
et désarmer à Brest.
18 mai, en mer. – Déjà on sent la
Bretagne approcher. Il fait beau encore, mais un de ces beaux temps
bretons qui sont tranquilles et mélancoliques. La mer unie est d’un
bleu pâle, l’air salin est frais et sent le varech ; il y a
sur toute chose comme un voile de brumes bleuâtres, très
transparentes et très ténues.
À huit heures du matin, doublé la pointe de
Penmarc’h. Les granits celtiques, les grandes falaises tristes peu
à peu se dessinent et s’approchent.
Maintenant ce sont de vrais bancs de brumes, –
mais très légers, brumes d’été, – qui se reposent partout sur les
lointains de l’horizon.
À une heure, la passe des Toulinguets, et puis
nous entrons à Brest.
19 mai. – Permission de huit jours. À
midi, je suis en chemin de fer, en route pour Toulven.
Pluie tout le long du chemin sur les campagnes
bretonnes. Dans les prés, dans les vallées ombreuses, tout est
plein d’eau.
De Bannalec à Toulven, une heure de voiture à
travers les bois. Le regard fixé en avant, je cherche la flèche en
granit de l’église au fond de l’horizon vert.
La voilà qui paraît, reflétée profondément, en
dessous, dans l’étang morne. Le beau temps est revenu avec un pâle
ciel bleu.
Toulven !… La voiture s’arrête. Yves est
là à m’attendre, tenant petit Pierre par la main.
Nous nous regardons tous deux, – et voilà que
d’abord une même envie de rire nous prend en même temps, à cause de
nos moustaches. Cela change nos figures et nous nous trouvons
drôles. Nous ne nous étions pas vus depuis que les marins ont le
droit d’en porter. Yves exprime l’avis que cela nous donne un air
beaucoup plus dégourdi.
Après, nous nous embrassons.
Comme il est encore devenu beau, le petit
Pierre, et plus grand, et plus fort !… Nous partons ensemble,
traversant Toulven, où les bonnes gens me connaissent, et sortent
sur leur porte pour me voir arriver. Nous défilons dans l’étroite
rue grise, aux maisons centenaires, aux murs de granit massif. Je
reconnais la vieille à profil de chouette qui a présidé à la
naissance de mon filleul ; elle me fait bonjour de la tête par
une fenêtre ouverte. Les grandes coiffes, les collerettes, les
paillettes des corsages, se détachent dans les embrasures
profondes, sur les fonds obscurs, et tout cela me jette au passage
ces impressions des vieux temps morts qui sont particulières à la
Bretagne.
Petit Pierre, que nous tenons par la main,
marche maintenant comme un homme. Il n’avait encore rien dit, un
peu saisi de me revoir ; mais le voilà qui cause ; il
lève vers moi sa figure ronde et me regarde déjà comme quelqu’un
d’ami à qui on fait part de ses réflexions. Petite voix douce que
je n’ai pas encore beaucoup entendue. Comme il a l’accent de
Bretagne !
« Parrain, tu m’as apporté mon
mouton ? »
Heureusement je m’étais rappelé cette promesse
de l’an dernier ; il était dans ma malle, ce mouton à
roulettes, pour mon petit Pierre. Et j’apportais aussi des
flambeaux, ayant des figures de perruches de France, que
j’avais promis à mon autre grand enfant, – Yves.
Voici la maison, gaie et blanche, toute neuve,
avec ses entourages de fenêtres en granit breton, ses auvents
verts, son grenier à lucarne, et, derrière, l’horizon des bois.
Nous entrons. En bas, dans la cuisine à grande
cheminée, Marie et la petite Corentine nous attendent.
Mais tout de suite, Yves me prie de monter,
car il a hâte de me faire voir le haut, leur belle chambre blanche,
avec ses rideaux de mousseline et ses meubles de cerisier
verni.
Et puis il ouvre une autre porte :
« À présent, frère, voilà chez
vous ! »
Et il me regarde, anxieux de l’effet produit,
après tant de mal qu’ils se sont donné, sa femme et lui, pour que
je trouve tout à mon goût.
J’entre, touché, ému. Elle est toute blanche,
ma chambre et on y sent un parfum délicieux, il y a partout des
fleurs qu’on est allé chercher très loin pour moi ; dans les
vases de la cheminée, des touffes de réséda et de gros bouquets de
pois de senteur ; dans le foyer, c’est rempli de bruyères.
Ils n’ont pas pu se décider, par exemple, à y
mettre des vieux meubles, des vieilleries bretonnes, et ils s’en
excusent, n’ayant rien trouvé à leur idée d’assez joli ni d’assez
propre. On est allé à Quimper m’acheter un lit comme le leur, en
cerisier, qui est un bois clair, d’une couleur gaie, un peu rose.
Les tables et les chaises sont pareilles. Les plus petits détails
sont arrangés avec tendresse ; sur les murs, il y a, dans des
cadres dorés, des dessins que j’ai faits jadis et une grande
photographie du clocher à jour de Saint-Pol-de-Léon, que j’avais
donnée à Yves du temps où nous naviguions ensemble sur la mer
brumeuse.
Par terre, les planches sont nettes comme du
bois neuf :
« Vous voyez, frère, c’est tout blanc
comme à bord », dit Yves, qui a lui-même blanchi partout avec
tant de soin, et qui se déchausse chaque fois qu’il monte pour ne
pas salir ses escaliers.
Il faut tout voir, tout visiter, même le
grenier à lucarne, où sont rangées les pommes de terre et les
cosses de bois pour l’hiver ; même le vestibule de l’escalier,
où est suspendu, comme un ex-voto de marin dans une
chapelle de la vierge, le bateau en miniature qu’Yves a construit
pendant ses loisirs dans sa hune du Primauguet ; et
puis le jardin où des fraisiers et de petites salades commencent à
pousser le long des allées toutes fraîches.
Maintenant nous sommes à table, Yves, Marie,
la petite Corentine, le petit Pierre et moi, autour de la nappe
bien blanche sur laquelle le dîner est posé. Yves, mon frère Yves,
se trouve drôle et s’intimide tout à coup dans son rôle de maître
de maison. Alors c’est moi qui suis obligé de découper, et, comme
c’est la première fois de ma vie, je m’embrouille aussi.
À ce dîner, je mange pour leur faire
plaisir ; mais ce bonheur si complet que je sens là près de
moi et dont je suis un peu cause, cette reconnaissance si profonde
qui m’entoure, tout cela m’impressionne très étrangement. Être au
milieu de ces choses rares, cela me surprend comme une nouveauté
délicieuse.
« Vous savez », me dit Yves, bas
comme en confidence, « maintenant je vais à la messe le
dimanche avec elle. »
Et il fait du côté de sa femme une petite
grimace de soumission enfantine, très comique avec son air sérieux.
D’ailleurs sa manière d’être avec Marie a tout à fait changé, et
j’ai bien vu en entrant que l’amour était enfin venu s’installer
pour tout de bon dans la maison neuve. Alors mes chers amis n’ont
plus rien à attendre de meilleur sur terre ; comme Yves le
dit, il faudrait seulement pouvoir arrêter la pendule du
temps pour que cette grande joie de leurs rêves accomplis ne
s’en aille plus.
Eux aussi sont silencieux dans leur bonheur,
comme s’ils craignaient de l’effaroucher en parlant trop fort et
trop gaiement.
D’ailleurs nous avons à causer des morts, de
cette petite Yvonne qui s’en est allée l’automne dernier sans
attendre le retour du Primauguet, et qu’Yves n’a jamais
vue ; puis du pauvre vieux Corentin, son grand-père, qui a
fini pendant les froids de décembre.
C’est Marie qui raconte :
« Il était devenu très difficile sur sa
fin, monsieur, lui qui était un homme si doux. Il disait que nous
ne savions pas le soigner et il ne faisait que demander son fils
Yves : " Oh ! Si Yves était ici, il m’aiderait, lui, il
me prendrait dans ses bons bras pour me retourner dans mon lit. "
La dernière nuit, tout le temps, il l’appelait. »
Et Yves reprend :
« Ce qui me cause le plus de chagrin
quand je pense à notre père, c’est que justement nous nous étions
un peu fâchés le jour que je suis parti, vous savez, pour ce
partage ? Vous ne pouvez croire, frère, comme cela me revient
souvent en tête, cette dispute avec lui. »
Le dîner est fini ; c’est le soir, le
long soir tiède de mai. Nous nous acheminons, Yves et moi, vers
l’église, pour faire visite à une croix blanche qui est là sur un
tertre avec des fleurs :
Yvonne
Kermadec, treize mois.
« Il paraît qu’elle me ressemblait tout à
fait », dit Yves.
Et cette ressemblance de la petite morte avec
lui le rend très pensif.
En regardant la croix, le tertre et les
fleurs, nous songeons tous deux à ce mystère : petite fille
qui était de son sang, issue de lui, qui avait ses yeux, et alors…
Probablement aussi une âme pareille, et qui est déjà rendue au sol
breton. C’est comme si quelque chose de lui-même s’en était déjà
retourné à la terre ; c’est comme des arrhes qu’il aurait déjà
données à la poussière éternelle…
Dans quatre ans, cette petite croix qu’on
voyait de loin n’existera plus ; on enlèvera Yvonne, son
tertre et ses fleurs. Même ses petits os s’en iront aussi se mêler
aux autres, aux antiques, sous l’église, dans l’ossuaire.
Quatre ans encore on la verra, cette croix, et
on y lira ce nom de petite fille…
Elle est tout au bord de l’étang ; dans
l’eau dormante et profonde, elle se reflète à côté de la haute
flèche grise. Sur le tertre, des œillets fleuris font des touffes
blanches, déjà indécises dans la nuit qui arrive. L’étang ressemble
à un miroir, d’un jaune pâle, couleur de lumière mourante, comme
celle du ciel au couchant ; et, tout autour, on voit la ligne
déjà noire des grands bois.
Les fleurs des tombes donnent leurs odeurs
douces du soir. – Un calme tiède nous environne et semble
s’épaissir…
On entend dans le lointain les hiboux qui
s’appellent, on ne distingue plus les œillets blancs d’Yvonne… La
nuit d’été est venue…
Alors un grand bruit nous fait frissonner tout
à coup, au milieu de ce silence où nous songions aux morts. C’est
l’Angelus qui sonne, là, très près, au-dessus de nous,
dans la clocher ; et l’air s’emplit de lourdes vibrations
d’airain.
Pourtant nous n’avons vu personne entrer dans
l’église, qui est fermée et obscure.
« Qui sonne ? dit Yves, inquiet, qui
peut sonner ?… Pas moi qui voudrais le faire, toujours… Non,
sûr que je n’entrerais pas dans l’église à l’heure qu’il est, et
pas même pour tout l’or du monde, encore !… »
Nous nous en allons de ce cimetière ; il
s’y fait trop de bruit décidément ; l’Angelus y est
étrange ; il y éveille des sonorités inattendues, dans les
eaux de l’étang, dans la terre des morts, dans la nuit. Non pas que
nous ayons peur de la pauvre petite tombe aux œillets blancs, mais
ce sont les autres, ces bosses de gazon qui sont autour de nous,
ces tertres d’inconnus…
Dix heures. – Je vais dormir ma
première nuit sous le toit de mon frère Yves.
Dix heures sonnées. – Nous nous
sommes déjà dit bonsoir, et le voilà qui rouvre ma porte.
« C’est pour les fleurs. Elles pourraient
peut-être vous faire du mal ; nous venons de penser
cela… »
Et il emporte tout, les résédas, les pois de
senteur, même les gerbes de bruyère.