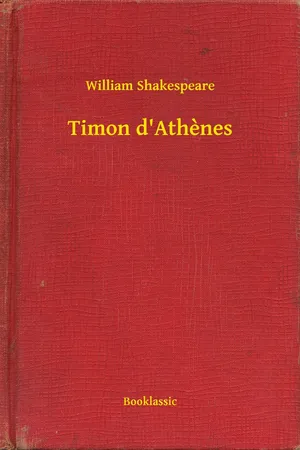Athènes. Salle dans la maison de Timon.
Entrent par différentes portes UN POÈTE, UN PEINTRE, puis UN JOAILLIER, UN MARCHAND et autres.
LE POÈTE. – Bonjour, monsieur.
LE PEINTRE. – Je suis bien aise de vous voir en bonne santé.
LE POÈTE. – Je ne vous ai pas vu depuis longtemps : comment va le monde ?
LE PEINTRE. – Il s’use, monsieur, en vieillissant.
LE POÈTE. – Oui, on sait cela : mais y a-t-il quelque rareté particulière ? qu’y a-t-il d’étrange et dont l’histoire ne donne d’exemple ? – Vois, ô magie de la générosité ! c’est ton charme puissant qui évoque ici tous ces esprits ! – Je connais ce marchand.
LE PEINTRE. – Et moi, je les connais tous deux : l’autre est un joaillier.
LE MARCHAND. – Oh ! c’est un digne seigneur.
LE JOAILLIER. – Oui, cela est incontestable.
LE MARCHAND. – Un homme incomparable, animé, à ce qu’il semble, d’une bonté infatigable et soutenue. Il va au delà des bornes.
LE JOAILLIER. – J’ai ici un joyau.
LE MARCHAND. – Oh ! je vous prie, voyons-le : pour le seigneur Timon, monsieur ?
LE JOAILLIER. – S’il veut en donner le prix : mais, quant à cela…
LE POÈTE, occupé à lire ses ouvrages. – « Quand l’appât d’un salaire nous a fait louer l’homme vil, c’est une tache qui flétrit la gloire des beaux vers consacrés avec justice à l’homme de bien. »
LE MARCHAND, considérant le diamant. – La forme est belle.
LE JOAILLIER. – Est-ce un riche bijou ? voyez-vous la belle eau ?
LE PEINTRE, au poëte. – Vous êtes plongé, monsieur, dans la composition de quelque ouvrage ? Quelque dédicace au grand Timon ?
LE POÈTE. – C’est une chose qui m’est échappée sans y penser : notre poésie est comme une gomme qui coule de l’arbre qui la nourrit. Le feu caché dans le caillou ne se montre que lorsqu’il est frappé ; mais notre noble flamme s’allume elle-même, et, comme le torrent, franchit chaque digue dont la résistance l’irrite. Qu’avez-vous là ?
LE PEINTRE. – Un tableau, monsieur. – Et quand votre livre paraît-il ?
LE POÈTE. – Il suivra de près ma présentation. – Voyons votre tableau.
LE PEINTRE. – C’est un bel ouvrage !
LE POÈTE, considérant le tableau. – En effet, c’est bien, c’est parfait.
LE PEINTRE. – Passable.
LE POÈTE. – Admirable ! Que de grâce dans l’attitude de cette figure ! Quelle intelligence étincelle dans ces yeux ! Quelle vive imagination anime ces lèvres ! On pourrait interpréter ce geste muet.
LE PEINTRE. – C’est une imitation assez heureuse de la vie. Voyez ce trait ; vous semble-t-il bien ?
LE POÈTE. – Je dis que c’est une leçon pour la nature ; la vie qui respire dans cette lutte de l’art est plus vivante que la nature.
(Entrent quelques sénateurs qui ne font que passer.)
LE PEINTRE. – Comme le seigneur Timon est recherché !
LE POÈTE. – Les sénateurs d’Athènes ! L’heureux mortel !
LE PEINTRE. – Regardez, en voilà d’autres !
LE POÈTE. – Vous voyez ce concours, ces flots de visiteurs. Moi, j’ai, dans cette ébauche, esquissé un homme à qui ce monde d’ici-bas prodigue ses embrassements et ses caresses. Mon libre génie ne s’arrête pas à un caractère particulier, mais il se meut au large dans une mer de cire[2]. Aucune malice personnelle n’empoisonne une seule virgule de mes vers ; je vole comme l’aigle ; hardi dans mon essor, ne laissant point de trace derrière moi.
LE PEINTRE. – Comment pourrai-je vous comprendre ?
LE POÈTE. – Je vais m’expliquer. – Vous voyez comme tous les états, tous les esprits (autant ceux qui sont liants et volages, que les gens graves et austères), viennent tous offrir leurs services au seigneur Timon. Son immense fortune, jointe à son caractère gracieux et bienfaisant, subjugue et conquiert toute sorte de cœurs pour l’aimer et le servir, depuis le souple flatteur, dont le visage est un miroir, jusqu’à cet Apémantus qui n’aime rien autant que se haïr lui-même ; il plie aussi le genou devant lui, et retourne content et riche d’un coup d’œil de Timon.
LE PEINTRE. – Je les ai vus causer ensemble.
LE POÈTE. – Monsieur, j’ai feint que la Fortune était assise sur son trône, au sommet d’une haute et riante colline. La base du mont est couverte par étages de talents de tout genre, d’hommes de toute espèce, qui travaillent sur la surface de ce globe, pour améliorer leur condition. Au milieu de cette foule dont les yeux sont attachés sur la souveraine, je représente un personnage sous les traits de Timon, à qui la déesse, de sa main d’ivoire, fait signe d’avancer, et par sa faveur actuelle change actuellement tous ses rivaux en serviteurs et en esclaves.
LE PEINTRE. – C’est bien imaginé, ce trône, cette Fortune et cette colline, et au bas un homme appelé au milieu de la foule, et qui, la tête courbée en avant, sur le penchant du mont, gravit vers son bonheur ; voilà, ce me semble, une scène que rendrait bien notre art.
LE POÈTE. – Soit, monsieur ; mais laissez-moi poursuivre. Ces hommes, naguère encore ses égaux (et quelques-uns valaient mieux que lui), suivent tous maintenant ses pas, remplissent ses portiques d’une cour nombreuse, versent dans son oreille leurs murmures flatteurs, comme la prière d’un sacrifice, révèrent jusqu’à son étrier, et ne respirent que par lui l’air libre des cieux.
LE PEINTRE. – Oui, sans doute : et que deviennent-ils ?
LE POÈTE. – Lorsque soudain la Fortune, dans un caprice et un changement d’humeur, précipite ce favori naguère si chéri d’elle, tous ses serviteurs qui, rampant sur les genoux et sur leurs mains, s’efforçaient après lui de gravir vers la cime du mont, le laissent glisser en bas ; pas un ne l’accompagne dans sa chute.
LE PEINTRE. – C’est l’ordinaire ; je puis vous montrer mille tableaux moraux qui peindraient ces coups soudains de la fortune, d’une manière plus frappante que les paroles. Cependant vous avez raison de faire sentir au seigneur Timon que les yeux des pauvres ont vu le puissant pieds en haut, tête en bas.
(Fanfares. Entre Timon avec sa suite : le serviteur de Ventidius cause avec Timon.)
TIMON. – Il est emprisonné, dites-vous ?
LE SERVITEUR DE VENTIDIUS. – Oui, mon bon seigneur. Cinq talents sont toute sa dette. Ses moyens sont restreints, ses créanciers inflexibles. Il implore une lettre de votre Grandeur à ceux qui l’ont fait enfermer ; si elle lui est refusée il n’a plus d’espoir.
TIMON. – Noble Ventidius ! Allons. – Il n’est pas dans mon caractère de me débarrasser d’un ami quand il a besoin de moi. Je le connais pour un homme d’honneur qui mérite qu’on lui donne du secours : il l’aura ; je veux payer sa dette et lui rendre la liberté.
LE SERVITEUR DE VENTIDIUS. – Votre Seigneurie se l’attache pour jamais.
TIMON. – Saluez-le de ma part : je vais lui envoyer sa rançon ; et lorsqu’il sera libre, dites-lui de me venir voir. Ce n’est pas assez de relever le faible, il faut le soutenir encore après. Adieu !
LE SERVITEUR DE VENTIDIUS. – Je souhaite toute prospérité à votre Honneur.
(Il sort.)
(Entre un vieillard athénien.)
LE VIEILLARD. – Seigneur Timon, daignez m’entendre.
TIMON. – Parlez, bon père.
LE VIEILLARD. – Vous avez un serviteur nommé Lucilius ?
TIMON. – Il est vrai ; qu’avez-vous à dire de lui ?
LE VIEILLARD. – Noble Timon, faites-le venir devant vous.
TIMON. – Est-il ici ou non ? Lucilius !
(Entre Lucilius.)
LUCILIUS. – Me voici, seigneur, à vos ordres.
LE VIEILLARD. – Cet homme, seigneur Timon, votre créature, hante de nuit ma maison. Je suis un homme qui, depuis ma jeunesse, me suis adonné au négoce ; et mon état mérite, un plus riche héritier qu’un homme qui découpe à table.
TIMON. – Eh bien ! qu’y a-t-il de plus ?
LE VIEILLARD. – Je n’ai qu’une fille, une fille unique, à qui je puisse transmettre ce que j’ai. Elle est belle, et des plus jeunes qu’on puisse épouser. Je l’ai élevée avec de grandes dépenses pour lui faire acquérir tous les talents. Ce valet, qui vous appartient, ose rechercher son amour. Je vous conjure, noble seigneur, joignez-vous à moi pour lui défendre de la fréquenter ; pour moi, j’ai parlé en vain.
TIMON. – Le jeune homme est honnête.
LE VIEILLARD. – Il le sera donc envers moi, Timon… Que son honnêteté lui serve de récompense sans m’enlever ma fille.
TIMON. – L’aime-t-elle ?
LE VIEILLARD. – Elle est jeune et crédule. Nos passions passées nous apprennent combien la jeunesse est légère.
TIMON. – Aimes-tu cette jeune fille ?
LUCILIUS. – Oui, mon bon seigneur, et elle agrée mon amour.
LE VIEILLARD. – Si mon consentement manque à son mariage, j’atteste ici les dieux que je choisirai mon héritier parmi les mendiants de ce monde, et que je la déshérite de tout mon bien.
TIMON. – Et quelle sera sa dot, si elle épouse un mari sortable ?
LE VIEILLARD. – Trois talents pour le moment ; à l’avenir, tout.
TIMON. – Cet honnête homme me sert depuis longtemps : je veux faire un effort pour fonder sa fortune, car c’est un devoir pour moi. Donnez-lui votre fille ; ce que vous avancerez pour sa dot sera la mesure de mes dons, et je rendrai la balance égale entre elle et lui.
LE VIEILLARD. – Noble seigneur, donnez-m’en votre parole, et ma fille est à lui.
TIMON. – Voilà ma main, et mon honneur sur ma promesse.
LUCILIUS. – Je remercie humblement votre Seigneurie : tout ce qui pourra jamais m’arriver de fortune et de bonheur, je le regarderai toujours comme venant de vous.
(Lucilius et le vieillard sortent.)
LE POÈTE. – Agréez mon travail, et que votre Seigneurie vive longtemps !
TIMON. – Je vous remercie ; vous aurez bientôt de mes nouvelles ; ne vous écartez point. (Au peintre.) Qu’avez-vous là, mon ami ?
LE PEINTRE, – Un morceau de peinture, que je conjure votre Seigneurie d’accepter.
TIMON. – La peinture me plaît : la peinture est presque l’homme au naturel ; car depuis que le déshonneur trafique des sentiments naturels, l’homme n’est qu’un visage, tandis que les figures que trace le pinceau sont du moins tout ce qu’elles paraissent… J’aime votre ouvrage, et vous en aurez bi...