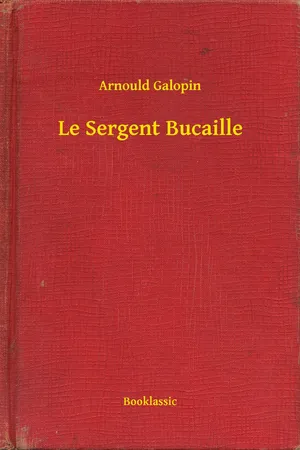C’était au début de l’année 1812… J’avais, comme beaucoup d’autres, par peur des gendarmes qui parcouraient la campagne, obéi à la conscription, périlleux devoir auquel échappaient généralement les fils de la bourgeoisie, soit par des rachats, soit par mille ruses et mille complicités.
Je dois avouer que je n’avais aucun goût pour le métier militaire. J’avais toujours mené une existence paisible entre mon père et ma mère, deux braves paysans que je faisais vivre de mon travail, et mon départ les eût laissés dans le plus complet dénuement si l’un de mes oncles qui était herbager aux environs de Beaumont n’avait promis de leur venir en aide.
Cet oncle, que nous appelions familièrement « Cadet », était un fervent admirateur de Napoléon ; aussi me félicita-t-il avec chaleur, quand il apprit que je partais pour l’armée. Il prit pour une vraie vocation ce qui n’était de ma part que simple crainte d’être arrêté un beau matin, et conduit comme réfractaire à la prison de Cherbourg, ainsi que cela était arrivé à deux de nos voisins que la gloire des armes ne tentait guère. Il me donna quelque argent et promit de subvenir aux besoins de mes parents, ce qu’il fit d’ailleurs jusqu’au jour où je pus enfin revenir au pays, après le désastre de Waterloo.
– Va, mon garçon, me dit l’oncle Cadet… va rejoindre les défenseurs de la France et n’oublie pas qu’aujourd’hui le moindre soldat a peut-être un bâton de maréchal dans sa giberne.
Mon ambition n’allait pas si loin. J’accomplissais mon devoir par nécessité, comme beaucoup de citoyens, et j’espérais que l’Empereur, après tant de victoires retentissantes, renoncerait bientôt à faire la guerre à l’Europe.
Si j’avais pu prévoir que les batailles allaient, pendant trois années, se succéder presque sans interruption, j’eusse été moins confiant et peut-être aurais-je fait comme certains jeunes gens qui, pour éviter la conscription, s’étaient réfugiés dans les îles. J’aurais emmené mes parents avec moi, et nous aurions vécu soit à Aurigny, soit à Guernesey, jusqu’à la fin des hostilités. Mais tout le monde était persuadé que lorsque l’Empereur aurait réduit l’Angleterre, ce qui ne pouvait tarder, la paix régnerait de nouveau sur le monde.
Ce ne fut point sans regret que je quittai mes parents pour suivre un sergent recruteur, sorte de soudard toujours ivre, aux façons grossières et brutales, qui arborait avec orgueil un uniforme tout rapiécé, rempli de taches, un bicorne cabossé et des bottes éculées. Malgré l’état sordide de ses vêtements, il ne manquait cependant pas d’allure avec son grand nez busqué, ses sourcils broussailleux et sa longue moustache jaune toujours humide de vin. Il s’appelait Rossignol et était originaire de l’Anjou. Il avait combattu à Savenay, à Quiberon, pendant la guerre de Vendée, avait fait Jemmapes, Fleurus, Wœrth et Coblentz… puis, après le 18 Brumaire, Marengo, Hohenlinden, Ulm, Austerlitz, Eylau. Blessé quatre fois, il eût pu prendre une retraite bien gagnée, mais, soldat de carrière, n’ayant pas de métier, il avait refusé de redevenir un « affreux péquin » comme il disait et s’était fait recruteur.
Il visitait les campagnes dans une maringote[1] et, avec l’aide des gendarmes, levait des conscrits, besogne qui n’était guère pénible et lui permettait de faire de longues stations dans les cabarets. Comme il supportait fort bien la boisson, il grisait ceux qu’il voulait enrôler, et quand ils étaient ivres, leur faisait signer un engagement, car il avait toujours sur lui des feuilles toutes prêtes où il suffisait d’apposer un paraphe… Quant aux récalcitrants, il les faisait empoigner par la maréchaussée. Il touchait, paraît-il, une prime pour chaque « levée », ce qui lui permettait d’être toujours entre deux vins.
Deux garçons du pays devaient partir en même temps que moi.
Bien que nous ne fussions que trois conscrits, Rossignol, qui menait tout militairement, fit battre la caisse par le garde-champêtre à l’heure du rassemblement.
Jusqu’alors, il s’était montré bon diable, mais une fois que nous fûmes sous ses ordres, il changea d’attitude et se mit à nous injurier en sacrant comme un damné. Nous devions nous rendre à Cherbourg par étapes.
Il nous fit mettre en ligne de trois et exigea que nous marchions au pas. Quand la cadence ralentissait, il nous traitait de clampins, de coïons ou de veaux et hurlait de son affreuse voix enrouée : « une… deusse ! une… deusse !… »
Dans les villages où nous passions, il s’arrêtait toujours pour s’humecter le gosier (à nos frais, bien entendu) et vers le soir, nous logions dans quelque grange pour repartir le lendemain au lever du soleil. Bien qu’il y eût des pompes et des citernes dans les endroits où nous campions, le sergent ne songeait jamais à se laver le visage ni les mains, car, disait-il pour son excuse, il avait l’eau en horreur.
En nous voyant faire nos ablutions, il nous décochait des plaisanteries stupides : « Vous allez vous user la peau. » « Pas besoin de tant vous bichonner, mes agneaux, l’Empereur ne donne pas de bal, ce soir. » « Allons, assez d’eau comme ça, laissez-en un peu à l’habitant. »
Mes deux camarades riaient de ces réflexions ineptes, mais moi je n’avais pas le cœur à la joie.
Je me représentais sans cesse les mines éplorées de mes pauvres parents que mon départ navrait, et qui me voyaient déjà sur un champ de bataille, parmi les boulets et les balles. Je songeais aussi à ma pauvre Cécile, la fille du père Heurteloup, une adorable créature que je m’apprêtais à demander en mariage. Nous nous connaissions depuis notre enfance et nous avions vécu jusqu’alors avec l’idée que nous serions un jour mari et femme… Notre séparation avait été navrante, et je puis dire que ce fut la première grande douleur de ma vie. Nous nous étions promis de nous écrire, car je croyais alors que les correspondances parvenaient régulièrement aux armées !…
On se représente sans peine ma détresse… Parfois, j’avais les larmes aux yeux en pensant à ma Cécile, et j’étais sûr que la pauvre fille souffrait autant que moi.
À cette heure, je l’avoue, je détestais ce Napoléon qui enlevait ainsi les jeunes hommes à leurs fiancées pour les lancer à la conquête du monde. Je me le représentais comme un bourreau ivre de sang, foulant sans pitié, monté sur son cheval, des monceaux de cadavres, dans des plaines ravagées par les charges de cavalerie, la mitraille et l’incendie.
Si jamais j’ai maudit la guerre, ce fut bien pendant les dures étapes que je fis avec mes deux compagnons, sous la conduite de ce sergent recruteur qui nous traitait comme des animaux. Il ne comprenait rien aux peines de cœur, celui-là ! Pour lui, la vie consistait à manger, boire, dormir et se battre.
J’étais vite devenu le point de mire de ses plaisanteries. Il m’avait baptisé « la Tristesse », et ne cessait de me harceler. Mes deux compagnons, au lieu de me plaindre, semblaient prendre plaisir à faire chorus avec lui, sans doute pour se mettre dans ses bonnes grâces. J’ai remarqué d’ailleurs que les soldats n’ont aucune pitié pour un camarade malheureux. Dès qu’on a revêtu l’uniforme, si l’on ne change pas aussitôt de caractère, si l’on ne devient pas grossier, gouailleur, impertinent, agressif, on est aussitôt la tête de Turc des autres, et le jour où l’on veut réagir, se rebeller, il est trop tard, le pli est pris, on est classé parmi les « geignards »… Il n’y a guère qu’une action d’éclat qui puisse vous réhabiliter, mais on ne devient pas un héros à son gré… il faut pour cela un hasard, une circonstance, et j’ai appris par la suite que le courage n’est pas toujours une question de volonté.
Nous arrivâmes enfin à Cherbourg.
Là, nous fûmes conduits dans un bâtiment situé près de la mer et où une quarantaine de conscrits étaient déjà rassemblés.
C’étaient pour la plupart des Normands comme moi, parmi lesquels il y avait fort peu de volontaires. Presque tous avaient été levés par les gendarmes, mais faisaient contre mauvaise fortune bon cœur. Ils étaient là depuis huit jours, et se croyaient déjà des « anciens », ce qui les autorisait, paraît-il, à brimer les nouveaux. Ils nous bousculaient, nous appelaient blancs-becs et nous donnaient à entendre que si nous voulions être traités en égaux, nous devions payer notre bienvenue.
Nous nous exécutâmes, et on nous laissa tranquilles ; d’ailleurs, d’autres recrues ne tardèrent pas à arriver. Mes deux compagnons et moi fûmes de cette façon promus au rang d’anciens et eûmes, à notre tour, le droit d’exercer des représailles sur les nouveaux venus.
Le sergent Rossignol nous avait quittés pour aller reprendre ses tournées dans la campagne, car l’Empereur avait, paraît-il, besoin de beaucoup d’hommes.
On disait que la Russie faisait, depuis quelque temps, de grands préparatifs et qu’elle concentrait une immense quantité de troupes sur les frontières de la Pologne. Elle ouvrait ses ports aux marchandises anglaises et foulait aux pieds le traité de Tilsitt.
Les Russes avaient bien choisi leur moment pour nous attaquer, car nous avions alors de nombreuses troupes occupées en Espagne, ce qui diminuait de beaucoup les ressources dont Napoléon aurait pu disposer pour soutenir la guerre dans le nord.
Certains prétendaient que l’on nous exercerait très vite et que nous ne tarderions pas à entendre siffler les balles.
Il y avait parmi nous beaucoup de fanfarons qui se disaient impatients d’aller au feu, mais je crois qu’ils eussent préféré, comme moi, demeurer dans leurs foyers.
On devait nous conduire à Paris où s’opérait la concentration et je n’envisageais pas sans inquiétude les dures étapes qu’il nous faudrait fournir avant d’arriver au terme de ce long voyage.
Un matin, nous nous mîmes en route. Nous étions environ une centaine. On nous fit placer par quatre. Deux sergents et trois caporaux marchaient en serre-file.
Tout alla bien d’abord.
Plusieurs d’entre nous avaient arboré à leurs revers des cocardes multicolores achetées à Cherbourg sur lesquelles se détachaient en lettres dorées les mots : « Honneur et Patrie ».
De temps à autre, quand nous arrivions dans une ville ou un village, les sergents nous forçaient à crier : « Vive l’Empereur ! » et cet enthousiasme de commande semblait faire impression sur l’habitant.
J’avais pour voisin de droite un grand gaillard au poil roux du nom de Martinvast, qui me bourrait continuellement de coups de coude. Comme j’étais de fort méchante humeur, je le bourrai à mon tour, et cela dégénéra en dispute, puis en pugilat, ce que voyant, un sergent s’approcha et nous dit :
– S’pèces de marouflards, vous saurez que c’est pas à coups de poing que des soldats vident leurs querelles… c’est bon pour les péquins… Vous autres qui avez l’honneur de servir l’Empereur, c’est à l’arme blanche que vous devez régler ça… Vos noms ?…
– Bucaille.
– Martinvast.
– C’est bon…, vous vous alignerez sur le terrain quand nous serons à Paris…, et nous verrons un peu si vous avez du cœur au ventre…