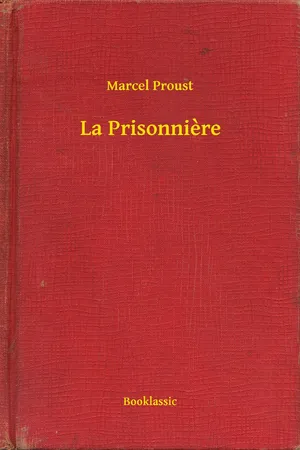Dès le matin, la tête encore tournée contre le mur, et avant d’avoir vu, au-dessus des grands rideaux de la fenêtre, de quelle nuance était la raie du jour, je savais déjà le temps qu’il faisait. Les premiers bruits de la rue me l’avaient appris, selon qu’ils me parvenaient amortis et déviés par l’humidité ou vibrants comme des flèches dans l’aire résonnante et vide d’un matin spacieux, glacial et pur ; dès le roulement du premier tramway, j’avais entendu s’il était morfondu dans la pluie ou en partance pour l’azur. Et, peut-être, ces bruits avaient-ils été devancés eux-mêmes par quelque émanation plus rapide et plus pénétrante qui, glissée au travers de mon sommeil, y répandait une tristesse annonciatrice de la neige, ou y faisait entonner, à certain petit personnage intermittent, de si nombreux cantiques à la gloire du soleil que ceux-ci finissaient par amener pour moi, qui encore endormi commençais à sourire, et dont les paupières closes se préparaient à être éblouies, un étourdissant réveil en musique. Ce fut, du reste, surtout de ma chambre que je perçus la vie extérieure pendant cette période. Je sais que Bloch raconta que, quand il venait me voir le soir, il entendait comme le bruit d’une conversation ; comme ma mère était à Combray et qu’il ne trouvait jamais personne dans ma chambre, il conclut que je parlais tout seul. Quand, beaucoup plus tard, il apprit qu’Albertine habitait alors avec moi, comprenant que je l’avais cachée à tout le monde, il déclara qu’il voyait enfin la raison pour laquelle, à cette époque de ma vie, je ne voulais jamais sortir. Il se trompa. Il était d’ailleurs fort excusable, car la réalité même, si elle est nécessaire, n’est pas complètement prévisible. Ceux qui apprennent sur la vie d’un autre quelque détail exact en tirent aussitôt des conséquences qui ne le sont pas et voient dans le fait nouvellement découvert l’explication de choses qui précisément n’ont aucun rapport avec lui.
Quand je pense maintenant que mon amie était venue, à notre retour de Balbec, habiter à Paris sous le même toit que moi, qu’elle avait renoncé à l’idée d’aller faire une croisière, qu’elle avait sa chambre à vingt pas de la mienne, au bout du couloir, dans le cabinet à tapisseries de mon père, et que chaque soir, fort tard, avant de me quitter, elle glissait dans ma bouche sa langue, comme un pain quotidien, comme un aliment nourrissant et ayant le caractère presque sacré de toute chair à qui les souffrances que nous avons endurées à cause d’elle ont fini par conférer une sorte de douceur morale, ce que j’évoque aussitôt par comparaison, ce n’est pas la nuit que le capitaine de Borodino me permit de passer au quartier, par une faveur qui ne guérissait en somme qu’un malaise éphémère, mais celle où mon père envoya maman dormir dans le petit lit à côté du mien. Tant la vie, si elle doit une fois de plus nous délivrer d’une souffrance qui paraissait inévitable, le fait dans des conditions différentes, opposées parfois jusqu’au point qu’il y a presque sacrilège apparent à constater l’identité de la grâce octroyée !
Quand Albertine savait par Françoise que, dans la nuit de ma chambre aux rideaux encore fermés, je ne dormais pas, elle ne se gênait pas pour faire un peu de bruit, en se baignant, dans son cabinet de toilette. Alors, souvent, au lieu d’attendre une heure plus tardive, j’allais dans une salle de bains contiguë à la sienne et qui était agréable. Jadis, un directeur de théâtre dépensait des centaines de mille francs pour consteller de vraies émeraudes le trône où la diva jouait un rôle d’impératrice. Les ballets russes nous ont appris que de simples jeux de lumières prodiguent, dirigés là où il faut, des joyaux aussi somptueux et plus variés. Cette décoration, déjà plus immatérielle, n’est pas si gracieuse pourtant que celle par quoi, à huit heures du matin, le soleil remplace celle que nous avions l’habitude d’y voir quand nous ne nous levions qu’à midi. Les fenêtres de nos deux salles de bains, pour qu’on ne pût nous voir du dehors, n’étaient pas lisses, mais toutes froncées d’un givre artificiel et démodé. Le soleil tout à coup jaunissait cette mousseline de verre, la dorait et, découvrant doucement en moi un jeune homme plus ancien, qu’avait caché longtemps l’habitude, me grisait de souvenirs, comme si j’eusse été en pleine nature devant des feuillages dorés où ne manquait même pas la présence d’un oiseau. Car j’entendais Albertine siffler sans trêve :
Les douleurs sont des folles,Et qui les écoute est encor plus fou.
Je l’aimais trop pour ne pas joyeusement sourire de son mauvais goût musical. Cette chanson, du reste, avait ravi, l’été passé, Mme Bontemps, laquelle entendit dire bientôt que c’était une ineptie, de sorte que, au lieu de demander à Albertine de la chanter, quand elle avait du monde, elle y substitua :
Une chanson d’adieu sort des sources troublées,
qui devint à son tour « une vieille rengaine de Massenet, dont la petite nous rebat les oreilles ».
Une nuée passait, elle éclipsait le soleil, je voyais s’éteindre et rentrer dans une grisaille le pudique et feuillu rideau de verre.
Les cloisons qui séparaient nos deux cabinets de toilette (celui d’Albertine, tout pareil, était une salle de bains que maman, en ayant une autre dans la partie opposée de l’appartement, n’avait jamais utilisée pour ne pas me faire de bruit) étaient si minces que nous pouvions parler tout en nous lavant chacun dans le nôtre, poursuivant une causerie qu’interrompait seulement le bruit de l’eau, dans cette intimité que permet souvent à l’hôtel l’exiguïté du logement et le rapprochement des pièces, mais qui, à Paris, est si rare.
D’autres fois, je restais couché, rêvant aussi longtemps que je le voulais, car on avait ordre de ne jamais entrer dans ma chambre avant que j’eusse sonné, ce qui, à cause de la façon incommode dont avait été posée la poire électrique au-dessus de mon lit, demandait si longtemps, que, souvent, las de chercher à l’atteindre et content d’être seul, je restais quelques instants presque rendormi. Ce n’est pas que je fusse absolument indifférent au séjour d’Albertine chez nous. Sa séparation d’avec ses amies réussissait à épargner à mon cœur de nouvelles souffrances. Elle le maintenait dans un repos, dans une quasi-immobilité qui l’aideraient à guérir. Mais, enfin, ce calme que me procurait mon amie était apaisement de la souffrance plutôt que joie. Non pas qu’il ne me permît d’en goûter de nombreuses, auxquelles la douleur trop vive m’avait fermé, mais ces joies, loin de les devoir à Albertine, que d’ailleurs je ne trouvais plus guère jolie et avec laquelle je m’ennuyais, que j’avais la sensation nette de ne pas aimer, je les goûtais au contraire pendant qu’Albertine n’était pas auprès de moi. Aussi, pour commencer la matinée, je ne la faisais pas tout de suite appeler, surtout s’il faisait beau. Pendant quelques instants, et sachant qu’il me rendait plus heureux qu’Albertine, je restais en tête à tête avec le petit personnage intérieur, salueur chantant du soleil et dont j’ai déjà parlé. De ceux qui composent notre individu, ce ne sont pas les plus apparents qui nous sont le plus essentiels. En moi, quand la maladie aura fini de les jeter l’un après l’autre par terre, il en restera encore deux ou trois qui auront la vie plus dure que les autres, notamment un certain philosophe qui n’est heureux que quand il a découvert, entre deux œuvres, entre deux sensations, une partie commune. Mais le dernier de tous, je me suis quelquefois demandé si ce ne serait pas le petit bonhomme fort semblable à un autre que l’opticien de Combray avait placé derrière sa vitrine pour indiquer le temps qu’il faisait et qui, ôtant son capuchon dès qu’il y avait du soleil, le remettait s’il allait pleuvoir. Ce petit bonhomme-là, je connais son égoïsme : je peux souffrir d’une crise d’étouffements que la venue seule de la pluie calmerait, lui ne s’en soucie pas, et aux premières gouttes si impatiemment attendues, perdant sa gaîté, il rabat son capuchon avec mauvaise humeur. En revanche, je crois bien qu’à mon agonie, quand tous mes autres « moi » seront morts, s’il vient à briller un rayon de soleil tandis que je pousserai mes derniers soupirs, le petit personnage barométrique se sentira bien aise, et ôtera son capuchon pour chanter : « Ah ! enfin, il fait beau. »
Je sonnais Françoise. J’ouvrais le Figaro. J’y cherchais et constatais que ne s’y trouvait pas un article, ou prétendu tel, que j’avais envoyé à ce journal et qui n’était, un peu arrangée, que la page récemment retrouvée, écrite autrefois dans la voiture du docteur Percepied, en regardant les clochers de Martainville. Puis, je lisais la lettre de maman. Elle trouvait bizarre, choquant, qu’une jeune fille habitât seule avec moi. Le premier jour, au moment de quitter Balbec, quand elle m’avait vu si malheureux et s’était inquiétée de me laisser seul, peut-être ma mère avait-elle été heureuse en apprenant qu’Albertine partait avec nous et en voyant que, côte à côte avec nos propres malles (les malles auprès desquelles j’avais passé la nuit à l’Hôtel de Balbec en pleurant), on avait chargé sur le tortillard celles d’Albertine, étroites et noires, qui m’avaient paru avoir la forme de cercueils et dont j’ignorais si elles allaient apporter à la maison la vie ou la mort. Mais je ne me l’étais même pas demandé, étant tout à la joie, dans le matin rayonnant, après l’effroi de rester à Balbec, d’emmener Albertine. Mais, à ce projet, si au début ma mère n’avait pas été hostile (parlant gentiment à mon amie comme une maman dont le fils vient d’être gravement blessé, et qui est reconnaissante à la jeune maîtresse qui le soigne avec dévouement), elle l’était devenue depuis qu’il s’était trop complètement réalisé et que le séjour de la jeune fille se prolongeait chez nous, et chez nous en l’absence de mes parents. Cette hostilité, je ne peux pourtant pas dire que ma mère me la manifestât jamais. Comme autrefois, quand elle avait cessé d’oser me reprocher ma nervosité, ma paresse, maintenant elle se faisait un scrupule – que je n’ai peut-être pas tout à fait deviné au moment, ou pas voulu deviner – de risquer, en faisant quelques réserves sur la jeune fille avec laquelle je lui avais dit que j’allais me fiancer, d’assombrir ma vie, de me rendre plus tard moins dévoué pour ma femme, de semer peut-être, pour quand elle-même ne serait plus, le remords de l’avoir peinée en épousant Albertine. Maman préférait paraître approuver un choix sur lequel elle avait le sentiment qu’elle ne pourrait pas me faire revenir. Mais tous ceux qui l’ont vue à cette époque m’ont dit qu’à sa douleur d’avoir perdu sa mère s’ajoutait un air de perpétuelle préoccupation. Cette contention d’esprit, cette discussion intérieure, donnait à maman une grande chaleur aux tempes et elle ouvrait constamment les fenêtres pour se rafraîchir. Mais, de décision, elle n’arrivait pas à en prendre de peur de « m’influencer » dans un mauvais sens et de gâter ce qu’elle croyait mon bonheur. Elle ne pouvait même pas se résoudre à m’empêcher de garder provisoirement Albertine à la maison. Elle ne voulait pas se montrer plus sévère que Mme Bontemps que cela regardait avant tout et qui ne trouvait pas cela inconvenant, ce qui surprenait beaucoup ma mère. En tous cas, elle regrettait d’avoir été obligée de nous laisser tous les deux seuls, en partant juste à ce moment pour Combray, où elle pouvait avoir à rester (et en fait resta) de longs mois, pendant lesquels ma grand’tante eut sans cesse besoin d’elle jour et nuit. Tout, là-bas, lui fut rendu facile, grâce à la bonté, au dévouement de Legrandin qui, ne reculant devant aucune peine, ajourna de semaine en semaine son retour à Paris, sans connaître beaucoup ma tante, simplement d’abord parce qu’elle avait été une amie de sa mère, puis parce qu’il sentit que la malade, condamnée, aimait ses soins et ne pouvait se passer de lui. Le snobisme est une maladie grave de l’âme, mais localisée et qui ne la gâte pas tout entière. Moi, cependant, au contraire de maman, j’étais fort heureux de son déplacement à Combray, sans lequel j’eusse craint (ne pouvant pas dire à Albertine de la cacher) qu’elle ne découvrît son amitié pour Mlle Vinteuil. C’eût été pour ma mère un obstacle absolu, non seulement à un mariage dont elle m’avait d’ailleurs demandé de ne pas parler encore définitivement à mon amie et dont l’idée m’était de plus en plus intolérable, mais même à ce que celle-ci passât quelque temps à la maison. Sauf une raison si grave et qu’elle ne connaissait pas, maman, par le double effet de l’imitation édifiante et libératrice de ma grand’mère, admiratrice de George Sand, et qui faisait consister la vertu dans la noblesse du cœur, et, d’autre part, de ma propre influence corruptrice, était maintenant indulgente à des femmes pour la conduite de qui elle se fût montrée sévère autrefois, ou même aujourd’hui, si elles avaient été de ses amies bourgeoises de Paris ou de Combray, mais dont je lui vantais la grande âme et auxquelles elle pardonnait beaucoup parce qu’elles m’aimaient bien. Malgré tout et même en dehors de la question des convenances, je crois qu’Albertine eût été insupportable à maman, qui avait gardé de Combray, de ma tante Léonie, de toutes ses parentes, des habitudes d’ordre dont mon amie n’avait pas la première notion.
Elle n’aurait pas fermé une porte et, en revanche, ne se serait pas plus gênée d’entrer quand une porte était ouverte que ne fait un chien ou un chat. Son charme, un peu incommode, était ainsi d’être à la maison moins comme une jeune fille que comme une bête domestique, qui entre dans une pièce, qui en sort, qui se trouve partout où on ne s’y attend pas et qui venait – c’était pour moi un repos profond – se jeter sur mon lit à côté de moi, s’y faire une place d’où elle ne bougeait plus, sans gêner comme l’eût fait une personne. Pourtant, elle finit par se plier à mes heures de sommeil, à ne pas essayer non seulement d’entrer dans ma chambre, mais à ne plus faire de bruit avant que j’eusse sonné. C’est Françoise qui lui imposa ces règles.
Elle était de ces domestiques de Combray sachant la valeur de leur maître et que le moins qu’elles peuvent est de lui faire rendre entièrement ce qu’elles jugent qui lui est dû. Quand un visiteur étranger donnait un pourboire à Françoise à partager avec la fille de cuisine, le donateur n’avait pas le temps d’avoir remis sa pièce que Françoise, avec une rapidité, une discrétion et une énergie égales, avait passé la leçon à la fille de cuisine qui venait remercier non pas à demi-mot, mais franchement, hautement, comme Françoise lui avait dit qu’il fallait le faire. Le curé de Combray n’était pas un génie, mais, lui aussi, savait ce qui se devait. Sous sa direction, la fille de cousins protestants de Mme Sazerat s’était convertie au catholicisme et la famille avait été parfaite pour lui : il fut question d’un mariage avec un noble de Méséglise. Les parents du jeune homme écrivirent, pour prendre des informations, une lettre assez dédaigneuse et où l’origine protestante était méprisée. Le curé de Combray répondit d’un tel ton que le noble de Méséglise, courbé et prosterné, écrivit une lettre bien différente, où il sollicitait comme la plus précieuse faveur de s’unir à la jeune fille.
Françoise n’eut pas de mérite à faire respecter mon sommeil par Albertine. Elle était imbue de la tradition. À un silence qu’elle garda, ou à la réponse péremptoire qu’elle fit à une proposition d’entrer chez moi ou de me faire demander quelque chose, qu’avait dû innocemment formuler Albertine, celle-ci comprit avec stupeur qu’elle se trouvait dans un monde étrange, aux coutumes inconnues, réglé par des lois de vivre qu’on ne pouvait songer à enfreindre. Elle avait déjà eu un premier pressentiment de cela à Balbec, mais, à Paris, n’essaya même pas de résister et attendit patiemment chaque matin mon coup de sonnette pour oser faire du bruit.
L’éducation que lui donna Françoise fut salutaire, d’ailleurs, à notre vieille servante elle-même, en calmant peu à peu les gémissements que, depuis le retour de Balbec, elle ne cessait de pousser. Car, au moment de monter dans le tram, elle s’était aperçue qu’elle avait oublié de dire adieu à la « gouvernante » de l’Hôtel, personne moustachue qui surveillait les étages, connaissait à peine Françoise, mais avait été relativement polie pour elle. Françoise voulait absolument faire retour en arrière, descendre du tram, revenir à l’Hôtel, faire ses adieux à la gouvernante et ne partir que le lendemain. La sagesse, et surtout mon horreur subite de Balbec, m’empêchèrent de lui accorder cette grâce, mais elle en avait contracté une mauvaise humeur maladive et fiévreuse que le changement d’air n’avait pas suffi à faire disparaître et qui se prolongeait à Paris. Car, selon le code de Françoise, tel qu’il est illustré dans les bas-reliefs de Saint-André-des-Champs, souhaiter la mort d’un ennemi, la lui donner même n’est pas défendu, mais il est horrible de ne pas faire ce qui se doit, de ne pas rendre une politesse, de ne pas faire ses adieux avant de partir, comme une vraie malotrue, à une gouvernante d’étage. Pendant tout le voyage, le souvenir, à chaque moment renouvelé, qu’elle n’avait pas pris congé de cette femme avait fait monter aux joues de Françoise un vermillon qui pouvait effrayer. Et si elle refusa de boire et de manger jusqu’à Paris, c’est peut-être parce que ce souvenir lui mettait un « poids » réel « sur l’estomac » (chaque classe sociale a sa pathologie) plus encore que pour nous punir.
Parmi les causes qui faisaient que maman m’envoyait tous les jours une lettre, et une lettre d’où n’était jamais absente quelque citation de Mme de Sévigné, il y avait le souvenir de ma grand’mère. Maman m’écrivait : « Mme Sazerat nous a donné un de ces petits déjeuners dont elle a le secret et qui, comme eût dit ta pauvre grand’mère, en citant Mme de Sévigné, nous enlèvent à la solitude sans nous apporter la société. » Dans mes premières réponses, j’eus la bêtise d’écrire à maman : « À ces citations, ta mère te reconnaîtrait tout de suite. » Ce qui me valut, trois jours après, ce mot : « Mon pauvre fils, si c’était pour me parler de ma mère tu invoques bien mal à propos Mme de Sévigné. Elle t’aurait répondu comme elle fit à Mme de Grignan : « Elle ne vous était donc rien ? Je vous croyais parents. »
Cependant, j’entendais les pas de mon amie qui sortait de sa chambre ou y rentrait. Je sonnais, car c’était l’heure où Andrée allait venir avec le chauffeur, ami de Morel et fourni par les Verdurin, chercher Albertine. J’avais parlé à celle-ci de la possibilité lointaine de nous marier ; mais je ne l’avais jamais fait formellement ; elle-même, par discrétion, quand j’avais dit : « Je ne sais pas, mais ce serait peut-être possible », avait secoué la tête avec un mélancolique sourire disant : « Mais non, ce ne le serait pas », ce qui signifiait : « Je suis trop pauvre. » Et alors, tout en disant : « Rien n’est moins sûr », quand il s’agissait de projets d’avenir, présentement je faisais tout pour la distraire, lui rendre la vie agréable, cherchant peut-être aussi, inconsciemment, à lui faire par là désirer de m’épouser. Elle riait elle-même de tout ce luxe. « C’est la mère d’Andrée qui en ferait une tête de me voir devenue une dame riche comme elle, ce qu’elle appelle une dame qui a « chevaux, voitures, tableaux ». Comment ? Je ne vous avais jamais raconté qu’elle disait cela ? Oh ! c’est un type ! Ce qui m’étonne, c’est qu’elle élève les tableaux à la dignité des chevaux et des voitures. » On verra plus tard que, malgré les habitudes de parler stupides qui lui étaient restées, Albertine s’était étonnamment développée, ce qui m’était entièrement égal, les supériorités d’esprit d’une compagne m’ayant toujours si peu intéressé que, si je les ai fait remarquer à l’une ou à l’autre, cela a été par pure politesse. Seul peut-être le curieux génie de Françoise m’eût peut-être plu. Malgré moi je souriais pendant quelques instants, quand, par exemple, ayant profité de ce qu’elle avait appris qu’Albertine n’était pas là, elle m’abordait par ces mots : « Divinité du ciel déposée sur un lit ! » Je disais : « Mais, voyons, Françoise, pourquoi « divinité du ciel » ? – Oh, si vous croyez que vous avez quelque chose de ceux qui voyagent sur notre vile terre, vous vous trompez bien ! – Mais pourquoi « déposée » sur un lit ? vous voyez bien que je suis couché. – Vous n’êtes jamais couché. A-t-on jamais vu personne couché ainsi ? Vous êtes venu vous poser là. Votre pyjama, en ce moment, tout blanc, avec vos mouvements de cou, vous donne l’air d’une colombe. »
Albertine, même dans l’ordre des choses bêtes, s’exprimait tout autrement que la petite fille qu’elle était il y avait seulement quelques années à Balbec. Elle allait jusqu’à déclarer, à propos d’un événement politique qu’elle blâmait : « Je trouve ça formidable. » Et je ne sais si ce ne fut vers ce temps-là qu’elle apprit à dire, pour signifier qu’elle trouvait un livre mal écrit : « C’est intéressant, mais, par exemple, c’est écrit comme par un cochon. »
La défense d’entrer chez moi avant que j’eusse sonné l’amusait beaucoup. Comme elle avait pris notre habitude familiale des citations et utilisait pour elle celles des pièces qu’elle avait jouées au couvent et que je lui avais dit aimer, elle me comparait toujours à Assuérus :
Et la mort est le prix de tout audacieuxQui sans être appelé se présente à ses yeux.… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Rien ne met à l’abri de cet ordre fatal,Ni le rang, ni le sexe ; et le crime est égal.Moi-même…Je suis à cette loi comme une autre soumise :Et sans le prévenir il faut pour lui parlerQu’il me cherche ou du moins qu’il me fasse appeler,
Physiquement, elle avait changé aussi. Ses longs yeux bleus – plus allongés – n’avaient pas gardé la même forme ; ils avaient bien la même couleur, mais semblaient être passés à l’état liquide. Si bien que, quand elle les fermait, c’était comme quand avec des rideaux on empêche de voir la mer. C’est sans doute de cette partie d’elle-même que je me souvenais surtout, chaque nuit en la quittant. Car, par exemple, tout au contraire, chaque matin le crespelage de ses cheveux me causa longtemps la même surprise, comme une chose nouvelle que je n’aurais jamais vue. Et pourtant, au-dessus du regard souriant d’une jeune fille, qu’y a-t-il de plus beau que cette couronne bouclée de violettes noires ? Le sourire propose plus d’amitié ; mais les petits crochets vernis des cheveux en fleurs, plus parents de la chair, dont ils semblent la transposition en vaguelettes, attrapent davantage le désir.
À peine entrée dans ma chambre, elle sautait sur le lit et quelquefois définissait mon genre d’intelligence, jurait dans un transport sincère qu’elle aimerait mieux mourir que de me quitter : c’était les jours où je m’étais rasé avant de la faire venir. Elle était de ces femmes qui ne savent pas démêler la raison de ce qu’elles ressentent. Le plaisir que leur cause un teint frais, elles l’expliquent par les qualités morales de celui qui leur semble pour leur avenir présenter une possibilité de bonheur, capable du reste de décroître et de devenir moins nécessaire au fur et à mesure qu’on laisse pousser sa barbe.
Je lui demandais où elle comptait aller.
– Je crois qu’Andrée veut me mener aux Buttes-Chaumont que je ne connais pas.
Certes, il m’était impossible de deviner, entre tant d’autres paroles, si sous celle-là un mensonge était caché. D’ailleurs j’avais confiance en Andrée pour me dire tous les endroits où elle allait avec Albertine.
À Balbec, quand je m’étais senti trop las d’Albertine, j’avais compté dire mensongèrement à Andrée : « Ma petite Andrée, si seulement je vous avais revue plus tôt ! C’était vous que j’aurais aimée. Mais, maintenant, mon cœur est fixé ailleurs. Tout de même, nous pouvons nous voir beaucoup, car mon amour pour une autre me cause de grands chagrins et vous m’aiderez à me consoler. » Or, ces mêmes paroles de mensonge étaient devenues vérité à trois semaines de distance. Peut-être Andrée avait-elle cru à Paris que c’était en effet un mensonge et que je l’aimais, comme elle l’aurait sans doute cru à Balbec. Car la vérité change tellement pour nous, que les autres ont peine à s’y reconnaître. Et comme je savais qu’elle me raconte...