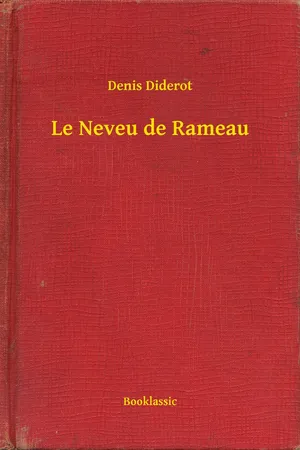Vertumnis, quotquot sunt, natus iniquis
(Horat., Lib. II, Satyr. VII)
Qu’il fasse beau, qu’il fasse laid, c’est mon habitude d’aller sur les cinq heures du soir me promener au Palais-Royal. C’est moi qu’on voit, toujours seul, rêvant sur le banc d’Argenson. Je m’entretiens avec moi-même de politique, d’amour, de goût ou de philosophie. J’abandonne mon esprit à tout son libertinage. Je le laisse maître de suivre la première idée sage ou folle qui se présente, comme on voit dans l’allée de Foy nos jeunes dissolus marcher sur les pas d’une courtisane à l’air éventé, au visage riant, à l’œil vif, au nez retroussé, quitter celle-ci pour une autre, les attaquant toutes et ne s’attachant à aucune. Mes pensées, ce sont mes catins. Si le temps est trop froid, ou trop pluvieux, je me réfugie au café de la Régence ; là je m’amuse à voir jouer aux échecs. Paris est l’endroit du monde, et le café de la Régence est l’endroit de Paris où l’on joue le mieux à ce jeu. C’est chez Rey que font assaut Légal le profond, Philidor le subtil, le solide Mayot, qu’on voit les coups les plus surprenants, et qu’on entend les plus mauvais propos ; car si l’on peut être homme d’esprit et grand joueur d’échecs, comme Légal ; on peut être aussi un grand joueur d’échecs, et un sot, comme Foubert et Mayot. Un après-dîner, j’étais là, regardant beaucoup, parlant peu, et écoutant le moins que je pouvais ; lorsque je fus abordé par un des plus bizarres personnages de ce pays où Dieu n’en a pas laissé manquer. C’est un composé de hauteur et de bassesse, de bon sens et de déraison. Il faut que les notions de l’honnête et du déshonnête soient bien étrangement brouillées dans sa tête ; car il montre ce que la nature lui a donné de bonnes qualités, sans ostentation, et ce qu’il en a reçu de mauvaises, sans pudeur. Au reste il est doué d’une organisation forte, d’une chaleur d’imagination singulière, et d’une vigueur de poumons peu commune. Si vous le rencontrez jamais et que son originalité ne vous arrête pas ; ou vous mettrez vos doigts dans vos oreilles, ou vous vous enfuirez. Dieux, quels terribles poumons. Rien ne dissemble plus de lui que lui-même. Quelquefois, il est maigre et hâve, comme un malade au dernier degré de la consomption ; on compterait ses dents à travers ses joues. On dirait qu’il a passé plusieurs jours sans manger, ou qu’il sort de la Trappe. Le mois suivant, il est gras et replet, comme s’il n’avait pas quitté la table d’un financier, ou qu’il eût été renfermé dans un couvent de Bernardins. Aujourd’hui, en linge sale, en culotte déchirée, couvert de lambeaux, presque sans souliers, il va la tête basse, il se dérobe, on serait tenté de l’appeler, pour lui donner l’aumône. Demain, poudré, chaussé, frisé, bien vêtu, il marche la tête haute, il se montre et vous le prendriez au peu prés pour un honnête homme. Il vit au jour la journée. Triste ou gai, selon les circonstances. Son premier soin, le matin, quand il est levé, est de savoir où il dînera ; après dîner, il pense où il ira souper. La nuit amène aussi son inquiétude. Ou il regagne, à pied, un petit grenier qu’il habite, à moins que l’hôtesse ennuyée d’attendre son loyer, ne lui en ait redemandé la clef ; ou il se rabat dans une taverne du faubourg où il attend le jour, entre un morceau de pain et un pot de bière. Quand il n’a pas six sols dans sa poche, ce qui lui arrive quelquefois, il a recours soit à un fiacre de ses amis, soit au cocher d’un grand seigneur qui lui donne un lit sur de la paille, à côté de ses chevaux. Le matin, il a encore une partie de son matelas dans ses cheveux. Si la saison est douce, il arpente toute la nuit, le Cours ou les Champs-Élysées. Il reparaît avec le jour, à la ville, habillé de la veille pour le lendemain, et du lendemain quelquefois pour le reste de la semaine. Je n’estime pas ces originaux-là. D’autres en font leurs connaissances familières, même leurs amis. Ils m’arrêtent une fois l’an, quand je les rencontre, parce que leur caractère tranche avec celui des autres, et qu’ils rompent cette fastidieuse uniformité que notre éducation, nos conventions de société, nos bienséances d’usage ont introduite. S’il en paraît un dans une compagnie ; c’est un grain de levain qui fermente qui restitue à chacun une portion de son individualité naturelle. Il secoue, il agite ; il fait approuver ou blâmer ; il fait sortir la vérité ; il fait connaître les gens de bien ; il démasque les coquins ; c’est alors que l’homme de bon sens écoute, et démêle son monde. Je connaissais celui-ci de longue main. Il fréquentait dans une maison dont son talent lui avait ouvert la porte. Il y avait une fille unique. Il jurait au père et à la mère qu’il épouserait leur fille. Ceux-ci haussaient les épaules, lui riaient au nez ; lui disaient qu’il était fou, et je vis le moment que la chose était faite. Il m’empruntait quelques écus que je lui donnais. Il s’était introduit, je ne sais comment, dans quelques maisons honnêtes, où il avait son couvert, mais à la condition qu’il ne parlerait pas, sans en avoir obtenu la permission. Il se taisait, et mangeait de rage. Il était excellent à voir dans cette contrainte. S’il lui prenait envie de manquer au traité, et qu’il ouvrit la bouche ; au premier mot, tous les convives s’écriaient, ô Rameau ! Alors la fureur étincelait dans ses yeux, et il se remettait à manger avec plus de rage. Vous étiez curieux de savoir le nom de l’homme, et vous le savez. C’est le neveu de ce musicien célèbre qui nous a délivrés du plain-chant de Lulli que nous psalmodions depuis plus de cent ans ; qui a tant écrit de visions inintelligibles et de vérités apocalyptiques sur la théorie de la musique, où ni lui ni personne n’entendit jamais rien, et de qui nous avons un certain nombre d’opéras où il y a de l’harmonie, des bouts de chants, des idées décousues, du fracas, des vols, des triomphes, des lances, des gloires, des murmures, des victoires à perte d’haleine ; des airs de danse qui dureront éternellement, et qui, après avoir enterré le Florentin sera enterré par les virtuoses italiens, ce qu’il pressentait et le rendait sombre, triste, hargneux ; car personne n’a autant d’humeur, pas même une jolie femme qui se lève avec un bouton sur le nez, qu’un auteur menacé de survivre à sa réputation ; témoins Marivaux et Crébillon le fils.
Il m’aborde… Ah, ah, vous voilà, monsieur le philosophe, et que faites-vous ici parmi ce tas de fainéants ? Est-ce que vous perdez aussi votre temps à pousser le bois ? C’est ainsi qu’on appelle par mépris jouer aux échecs ou aux dames.
MOI. – Non, mais quand je n’ai rien de mieux à faire, je m’amuse à regarder un instant, ceux qui le poussent bien.
LUI. – En ce cas, vous vous amusez rarement ; excepté Légal et Philidor, le reste n’y entend rien.
MOI. – Et monsieur de Bissy donc ?
LUI. – Celui-là est en joueur d’échecs, ce que mademoiselle Clairon est en acteur. Ils savent de ces jeux, l’un et l’autre, tout ce qu’on en peut apprendre.
MOI. – Vous êtes difficile, et je vois que vous ne faites grâce qu’aux hommes sublimes.
LUI. – Oui, aux échecs, aux dames, en poésie, en éloquence, en musique, et autres fadaises comme cela. A quoi bon la médiocrité dans ces genres.
MOI. – A peu de chose, j’en conviens. Mais c’est qu’il faut qu’il y ait un grand nombre d’hommes qui s’y appliquent, pour faire sortir l’homme de génie. Il est un dans la multitude. Mais laissons cela. Il y a une éternité que je ne vous ai vu. Je ne pense guère à vous, quand je ne vous vois pas. Mais vous me plaisez toujours à revoir. Qu’avez-vous fait ?
LUI. – Ce que vous, moi et tous les autres font ; du bien, du mal et rien. Et puis j’ai eu faim, et j’ai mangé, quand l’occasion s’en est présentée ; après avoir mangé, j’ai eu soif, et j’ai bu quelquefois. Cependant la barbe me venait ; et quand elle a été venue, je l’ai fait raser.
MOI. – Vous avez mal fait. C’est la seule chose qui vous manque, pour être un sage.
LUI. – Oui-da. J’ai le front grand et ridé ; l’œil ardent ; le nez saillant ; les joues larges ; le sourcil noir et fourni ; la bouche bien fendue ; la lèvre rebordée ; et la face carrée. Si ce vaste menton était couvert d’une longue barbe ; savez-vous que cela figurerait très bien en bronze ou en marbre.
MOI. – A côté d’un César, d’un Marc-Aurèle, d’un Socrate.
LUI. – Non, je serais mieux entre Diogène et Phryné. Je suis effronté comme l’un, et je fréquente volontiers chez les autres.
MOI. – Vous portez-vous toujours bien ?
LUI. – Oui, ordinairement ; mais pas merveilleusement aujourd’hui.
MOI. – Comment ? Vous voilà avec un ventre de Silène ; et un visage…
LUI. – Un visage qu’on prendrait pour son antagoniste. C’est que l’humeur qui fait sécher mon cher oncle engraisse apparemment son cher neveu.
MOI. – A propos de cet oncle, le voyez-vous quelquefois ?
LUI. – Oui, passer dans la rue.
MOI. – Est-ce qu’il ne vous fait aucun bien ?
LUI. – S’il en fait à quelqu’un, c’est sans s’en douter. C’est un philosophe dans son espèce. Il ne pense qu’à lui ; le reste de l’univers lui est comme d’un clou à soufflet. Sa fille et sa femme n’ont qu’à mourir, quand elles voudront ; pourvu que les cloches de la paroisse, qu’on sonnera pour elles, continuent de résonner la douzième et la dix-septième tout sera bien. Cela est heureux pour lui. Et c’est ce que je prise particulièrement dans les gens de génie. Ils ne sont bons qu’à une chose. Passé cela, rien. Ils ne savent ce que c’est d’être citoyens, pères, mères, frères, parents, amis. Entre nous, il faut leur ressembler de tout point ; mais ne pas désirer que la graine en soit commune. Il faut des hommes ; mais pour des hommes de génie ; point. Non, ma foi, il n’en faut point. Ce sont eux qui changent la face du globe ; et dans les plus petites choses, la sottise est si commune et si puissante qu’on ne la réforme pas sans charivari. Il s’établit partie de ce qu’ils ont imaginé. Partie reste comme il était ; de là deux évangiles ; un habit d’Arlequin. La sagesse du moine de Rabelais, est la vraie sagesse, pour son repos et pour celui des autres : faire son devoir, tellement quellement ; toujours dire du bien de Monsieur le prieur ; et laisser aller le monde à sa fantaisie. Il va bien, puisque la multitude en est contente. Si je savais l’histoire, je vous montrerais que le mal est toujours venu ici-bas, par quelque homme de génie. Mais je ne sais pas l’histoire, parce que je ne sais rien. Le diable m’emporte, si j’ai jamais rien appris ; et si pour n’avoir rien appris, je m’en trouve plus mal. J’étais un jour à la table d’un ministre du roi de France qui a de l’esprit comme quatre ; eh bien, il nous démontra clair comme un et un font deux, que rien n’était plus utile aux peuples que le mensonge ; rien de plus nuisible que la vérité. Je ne me rappelle pas bien ses preuves ; mais il s’ensuivait évidemment que les gens de génie sont détestables, et que si un enfant apportait en naissant, sur son front, la caractéristique de ce dangereux présent de la nature, il faudrait ou l’étouffer, ou le jeter au cagnard.
MOI. – Cependant ces personnages-là, si ennemis du génie, prétendent tous en avoir.
LUI. – Je crois bien qu’ils le pensent au-dedans d’eux-mêmes ; mais je ne crois pas qu’ils osassent l’avouer.
MOI. – C’est par modestie. Vous conçûtes donc là, une terrible haine contre le génie.
LUI. – A n’en jamais revenir.
MOI. – Mais j’ai vu un temps que vous vous désespériez de n’être qu’un homme commun. Vous ne serez jamais heureux, si le pour et le contre vous afflige également. Il faudrait prendre son parti, et y demeurer attaché. Tout en convenant avec vous que les hommes de génie sont communément singuliers, ou comme dit le proverbe, qu’il n’y a point de grands esprits sans un grain de folie, on n’en reviendra pas. On méprisera les siècles qui n’en auront pas produit. Ils feront l’honneur des peuples chez lesquels ils auront existé ; tôt ou tard, on leur élève des statues, et on les regarde comme les bienfaiteurs du genre humain. N’en déplaise au ministre sublime que vous m’avez cité, je crois que si le mensonge peut servir un moment, il est nécessairement nuisible à la longue ; et qu’au contraire, la vérité sert nécessairement à la longue ; bien qu’il puisse arriver qu’elle nuise dans le moment. D’où je serais tenté de conclure que l’homme de génie qui décrie une erreur générale, ou qui accrédite une grande vérité, est toujours un être digne de notre vénération. Il peut arriver que cet être soit la victime du préjugé et des lois ; mais il y a deux sortes de lois, les unes d’une équité, d’une généralité absolues ; d’autres bizarres qui ne doivent leur sanction qu’à l’aveuglement ou la nécessité des circonstances. Celles-ci ne couvrent le coupable qui les enfreint que d’une ignominie passagère ; ignominie que le temps reverse sur les juges et sur les nations, pour y rester à jamais. De Socrate, ou du magistrat qui lui fit boire la ciguë, quel est aujourd’hui le déshonoré ?
LUI. – Le voilà bien avancé ! en a-t-il été moins condamné ? en a-t-il moins été mis à mort ? en a-t-il moins été un citoyen turbulent ? par le mépris d’une mauvaise loi, en a-t-il moins encouragé les fous au mépris des bonnes ? en a-t-il moins été un particulier audacieux et bizarre ? Vous n’étiez pas éloigné tout à l’heure d’un aveu peu favorable aux hommes de génie.
MOI. – Écoutez-moi, cher homme. Une société ne devrait point avoir de mauvaises lois ; et si elle n’en avait que de bonnes, elle ne serait jamais dans le cas de persécuter un homme de génie. Je ne vous ai pas dit que le génie fût indivisiblement attaché à la méchanceté, ni la méchanceté au génie. Un sot sera plus souvent un méchant qu’un homme d’esprit. Quand un homme de génie serait communément d’un commerce dur, difficile, épineux, insupportable, quand même ce serait un méchant, qu’en concluriez-vous ? LUI. – Qu’il est bon à noyer.
MOI. – Doucement ; cher homme. Ça, dites-moi ; je ne prendrai pas votre oncle pour exemple ; c’est un homme dur ; c’est un brutal ; il est sans humanité ; il est avare. Il est mauvais père, mauvais époux ; mauvais oncle ; mais il n’est pas assez décidé que ce soit un homme de génie ; qu’il ait poussé son art fort loin, et qu’il soit question de ses ouvrages dans dix ans. Mais Racine ? Celui-là certes avait du génie, et ne passait pas pour un trop bon homme. Mais de Voltaire ?
LUI. – Ne me pressez pas ; car...