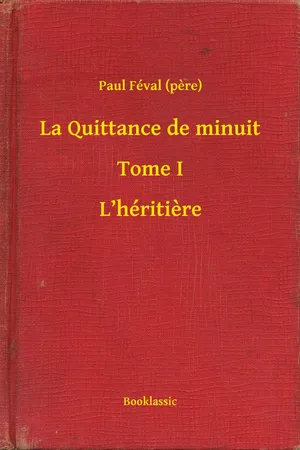Les événements que nous avons racontés aux précédents chapitres, se passaient à la fin de 1844. Nous sommes en juin 1845.
Pendant ces quelques mois, les événements avaient marché. En ce temps de la grande lutte soutenue par Daniel O’Connell, où il semblait que la volonté d’un seul homme fût entre le courroux contenu des partis et la plus implacable de toutes les guerres civiles, chaque jour amenait son progrès contesté, sa bataille perdue ou gagnée : une bataille gagnée presque toujours, car l’étoile de l’Irlande grandissait et montait à l’horizon politique. Ces huit millions d’esclaves qui ont tant de peine à devenir un peuple, se dressaient pauvres mais forts, vis-à-vis des suppôts à demi vaincus de la tyrannie anglaise.
Ils avaient encore, sans doute, les vices et les faiblesses que mène avec soi la servitude, mais ils prêtaient l’oreille aux leçons vaillantes d’une voix libre ; leur cœur apprenait à battre. Ils allaient peut-être s’éveiller hommes.
Et tandis que les uns courbaient encore la tête sous la puissance fatale de la misère ; tandis que d’autres, voués à de mystérieuses vengeances, poursuivaient durant les nuits noires leurs batailles inutiles et cruelles, quelque chose s’agitait au dedans et au dehors de la nation. L’Angleterre, émue, écoutait la voix longtemps muette de sa conscience. O’Connell, captif, trouvait un arc de triomphe au delà des portes ouvertes de sa prison ; Robert Peel, le noble et ferme génie, muselait son propre parti, et ensemençait de ses mains le champ où doit mûrir la moisson de l’indépendance.
L’Europe, attentive, regardait, rapprochant ses mains, pressées d’applaudir. Robert Peel mourut, O’Connell est mort. Rien n’est sorti de la lutte ; – rien, sinon cette mystérieuse menace qui change de nom toujours, et qui, d’année en année, pend à un fil plus mince au-dessus du cœur de l’Angleterre.
Molly-Maguire a éteint sa torche, mais les Fenyans chargent leurs rifles et aiguisent leurs couteaux.
O’Connell l’a dit : l’Irlande opprimée est un cancer mortel que l’Angleterre porte au sein.
Le gai soleil de juin enfilait la voie étroite de Donnor street, à Galway ; ses rayons, frappant obliquement la ligne irrégulière des maisons, mettaient alternativement de grandes ombres et de vives lumières à leurs façades sculptées. Galway est la perle de l’Irlande ; c’est la cité romanesque, la ville épique, gardant au fronton de ses demeures les belles fantaisies que le moyen âge taillait partout dans la pierre.
En passant par certaines rues, vous diriez quelque quartier transplanté d’une ville castillane. Les maisons, qui se touchent presque, s’élèvent sveltes et fières, ouvrant sur la voie discrète leurs longues fenêtres en ogive. Le dessus de chaque porte se découpe en sculptures capricieuses. Çà et là, entre les fenêtres, des écussons symétriques étalent leurs vieux émaux que le temps a respectés.
Donnor street est une de ces voies où l’architecture gothique et le style de la Renaissance alternent sans aucun mélange de constructions modernes. Chaque maison est un château, petit ou grand, aux murailles criblées d’armoiries, que ferment fièrement les battants guillochés de son portail. Mais ces châteaux sont depuis longtemps veufs de leurs nobles hôtes ; ceux qui ne sont pas inhabités servent d’asile aux professions les plus bourgeoises, et encore ont-ils peu de faveur auprès des industriels, à cause de l’incommodité de leurs distributions intérieures.
À l’angle de Donnor street et de la ruelle sans nom qui mène au Claddag, cette patrie des matelots et des pêcheurs de Galway, une grande maison, d’architecture éminemment curieuse et caractéristique, avait été transformée en auberge, sous le patronage de Saunder Flipp, Écossais et presbytérien. Il y avait au-dessus de la porte principale, entre deux écus sculptés dans la pierre, où la harpe d’Irlande s’accompagnait de diverses pièces chevaleresques, un beau tableau composé de pâtés de couleurs bleue, jaune et rouge, qui représentaient le bon roi Malcolm.
Au-dessous on lisait : Ale d’Écosse, poteen, fort pension pour hommes et pour chevaux.
C’était un des principaux public houses protestants de Galway. À différentes époques, les orangistes y avaient tenu les séances de leur club. Quoique presbytérien, Saunder Flipp avait une tendresse de frère pour les gens de l’Église établie, qui venaient boire à son auberge. Il était allé une fois, dans son zèle enthousiaste, jusqu’à proposer à ses pratiques orangistes de mettre bas l’enseigne du roi Malcolm, qui avait été en son temps un partisan du pape ; mais la grandeur d’âme des anglicans avait dédaigné cette offre soumise, et les pâtés de couleurs bleue, rouge et jaune continuaient de représenter sans encombre le vieux monarque écossais.
C’était alors un bon temps pour Saunie : les voyageurs abondaient en la ville de Galway. On était à la veille des élections, et les deux partis, qui se préparaient à une lutte acharnée, avaient convoqué le ban et l’arrière-ban de leurs amis. L’Ulster[5] avait envoyé un nombreux contingent de protestants, pour tenir avec avantage le marché aux votes et travailler les consciences indécises. Des gens de Londres étaient venus dans le même but, et du midi de l’Irlande affluaient des bandes bruyantes, qui n’étaient certes pas là pour appuyer le candidat tory.
En outre, il y avait à Galway un autre appât pour la foule, un grand procès de whiteboysme : c’était assez pour emplir jusqu’au comble toutes les hôtelleries ; et, de fait, la vieille cité, trop petite, déversait une partie de ses hôtes sur Tuam et les autres villes environnantes.
Ce procès de whiteboysme, qui était en train de se juger, piquait la curiosité très vivement. L’accusé, que le grand jury avait renvoyé devant les assises, était, disait-on, l’un des principaux chefs de l’armée des Molly-Maguires. Cet homme, qui jouissait d’une grande influence dans la partie occidentale du comté, entre la mer et les deux lacs, avait trouvé dans la population une telle sympathie, qu’aucun témoin ne s’était rencontré pour déposer contre lui à la dernière session.
Lors de son arrestation, il y avait eu de terribles émeutes dans le Connaught. Des bandes étaient venues, de nuit, jusqu’au milieu de la ville de Galway ; et, si le prisonnier avait voulu y mettre un peu du sien, il ne fût pas resté quarante-huit heures sous les verrous de la reine. Mais le prisonnier demeurait calme au fond de sa cellule ; il désavouait l’émeute, et prétendait faire triompher légalement son innocence.
Au lieu de l’acquitter purement et simplement, faute de preuves, on avait renvoyé l’affaire à deux mois, comme cela se fait assez généralement en Irlande. Le bruit public était que, pendant ces deux mois, on avait découvert enfin ce qu’il fallait de témoins pour faire condamner le vieux Miles Mac-Diarmid.
De l’autre côté de la rue étroite, et justement vis-à-vis de l’auberge du Roi Malcolm, s’élevait une grande maison noire, délabrée, chancelante, dont les fenêtres gothiques, veuves de leurs vitraux, laissaient passer le vent et la pluie. Dégagée des habitations qui la pressaient, cette maison eût été une belle ruine. Ses murailles, couvertes de sculptures féodales, brisaient leurs courbes avec grandeur, et s’ouvraient à leur milieu, ménageant un portail sarrasin digne du palais d’un prince. Elle était beaucoup plus large de façade que l’hôtel de Saunder Flipp, et avait la forme d’un château : un corps de logis et deux ailes, séparés entre eux par de profondes échancrures. Personne ne l’habitait. On la laissait tomber eu poussière, comme tant de palais en Irlande, et nul n’allait s’inquiéter de l’imminence de sa chute.
Il était deux heures de l’après-midi : le soleil éclairait joyeusement les cloisons rougeâtres du parloir de l’auberge du Roi Malcolm. Il y avait çà et là, dans les compartiments de cette salle, destinée aux membres importants de la société orangiste, quelques gentlemen attablés, buvant du toddy.
La loge la plus voisine de la fenêtre était occupée par quatre personnages, deux hommes et deux femmes, qui s’entretenaient paisiblement. Mistress Fenella Daws, l’aînée des deux femmes, pouvait bien avoir quarante ans. Elle était très maigre, très blafarde, et coiffée à l’enfant. Ses cheveux, d’un blond ardent, décimés par l’âge, étageaient leurs petites bouclettes pommadées autour d’un front étroit où il n’y avait pas trop de rides. Ses yeux blancs avaient d’étonnantes façons de se mouvoir de bas en haut et de rouler avec détresse, chaque fois qu’elle ouvrait sa mince bouche contenant de grandes dents.
Manifestement, sa ferme volonté était d’avoir un charmant sourire. Quand elle souriait, son nez long et mince se busquait doucement ; ses yeux, garnis de franges roussâtres, se fermaient à demi ; ses larges dents se montraient éblouissantes. Elle était grande, toute en jambes, et habillée suivant la dernière mode d’Almack : une robe de mousseline claire, dont le frêle tissu était menacé de ruine par les angles aigus de ses épaules, rabattait ses plis sur la plus austère de toutes les poitrines ; un fichu éclatant tournait nonchalamment autour des vertèbres puissamment accusées de son cou ; de beaux souliers vernis, emplis par des pieds plats, relevaient orgueilleusement sa jupe trop courte.
Elle avait du vague dans l’esprit et des romans dans le cœur. La poésie était sa nourriture.
À côté d’elle s’asseyait une charmante fille, de dix-huit ans, sa nièce, miss Frances Roberts. Miss Frances ne ressemblait point à sa tante : elle avait de beaux yeux limpides et sérieux ; son front pur s’encadrait de fins cheveux blonds, dont les boucles abondantes tombaient avec profusion le long de ses joues. Les filles de l’Angleterre ont le privilège de ces admirables chevelures dont la nuance douce chatoie, et dont les ondes perlées ruissellent sur la blancheur sans rivale de leur peau transparente.
Les sourires de Frances étaient aussi rares que ceux de sa tante s’épanouissaient fréquents. Mais, quand elle souriait, c’était comme un suave rayon qui réjouissait l’œil et chauffait le cœur.
Elle avait un petit air de dignité sévère, qui contrastait singulièrement avec les airs langoureux de Fenella Daws. On eût dit vraiment que ta tante et la nièce avaient changé de rôle, ou que la jolie fille, par une muette moquerie, mettait sur son gracieux visage le masque qui convenait à la femme mûre.
Cette austérité n’avait, au reste, nul rapport avec la timidité de nos vierges. La modestie change d’allures en passant le détroit, et les belles filles d’Albion n’entendent point comme nous la pudeur. Peut-être l’entendent-elles comme il faut. Le regard de Frances, ferme et hardi, ne se baissait point à tout propos. Le rose délicat de sa joue ne passait point au pourpre de minute en minute. Elle était calme comme un homme. Et cette assurance donnait à sa physionomie une fierté douce. Il y avait autour d’elle comme un reflet attrayant de digne sérénité.
Dans la manière dont la traitait sa tante, on aurait pu reconnaître un singulier mélange de déférence étudiée et de dédain très franc. Fenella ne pouvait voir en effet dans cette petite qu’une créature évidemment inférieure ; mais Frances était la fille de feu sir Edmund-Roberts, chevalier et membre du Parlement. Cela méritait considération. Fenella se faisait honneur volontiers de cette parenté. Elle parlait avec emphase des belles connaissances de sa nièce, qui avait été élevée dans une maison d’éducation fashionable, et qui était l’amie, mais vraiment l’amie, de plusieurs grandes dames, parmi lesquelles il fallait compter lady Georgiana Montrath.
De ces nobles amitiés, Fenella recevait comme un lointain reflet de distinction, qui lui était cher plus que nous ne saurions le dire. Sans cela sa supériorité eût écrasé bel et bien miss Roberts.
Mistress Fenella Daws et sa nièce buvaient le thé, assises du même côté de la table et adossées à la fenêtre. En face d’elles, les deux hommes buvaient et s’entretenaient.
Ils étaient tous les deux, à peu de chose près, du même âge. Celui d’entre eux qui avait le plus d’apparence, était un personnage gros, court, au front chauve et plat, flanqué sur les tempes de deux mèches de cheveux gris. Il avait une longue figure emmanchée à un cou trapu, et son menton sans barbe descendait en pointe sur sa poitrine. Ses yeux à demi fermés affectaient une dignité sévère. Ses lèvres remuaient avec lenteur pour prononcer d’emphatiques paroles. Il tenait le plus raide qu’il pouvait son torse obèse, couvert d’un habit noir.
Ce n’était rien moins que Josuah Daws, esq., sous-contrôleur de la police métropolitaine de Londres, époux de Fenella Daws et oncle de miss Frances Roberts. Il était en Irlande avec une mission, disait-il, et paraissait avoir au degré suprême la conviction de son importance.
Son compagnon, qui avait nom Gib Roe, était un homme de taille moyenne, grand et maigre, qui semblait mal à l’aise sous son habit de gentleman. Sa figure anguleuse, aux traits profondément fouillés, offrait en ce moment le type le plus parfait de la servilité aux abois. On s’étonnait de ne point voir des haillons sur ces épaules courbées ; et cette main jaunie, aux jointures calleuses, qui tressaillait et tremblait au moindre bruit, devait avoir touché bien souvent le denier de l’aumône. Gib avait mis son chapeau à côté de lui sur la table, ce qui éloignait toute idée qu’il pût être un homme comme il faut. En Irlande, en effet, de même qu’en Angleterre, le chapeau d’un gentleman doit être rivé soigneusement à son crâne ; se découvrir est le fait d’un manant.
Gib avait des cheveux crépus mais rares, qui s’ébouriffaient autour de sa tête pointue. Ses yeux déteints et caves disparaissaient presque derrière les poils inégalement hérissés de ses sourcils. Sa joue était hâve, ce qui faisait ressortir la tache rouge, signe menaçant, que la misère ou la maladie avait imprimée sur la saillie aiguë de ses pommettes. Le reste de...