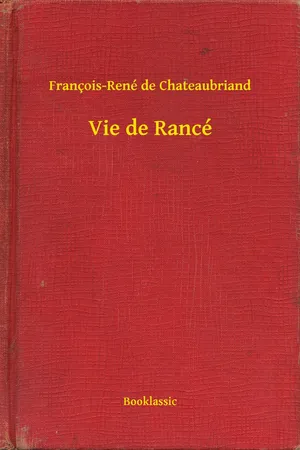Les calomnies publiées contre le monastère de La Trappe par les libertins, qui se moquaient des austérités, et par les jaloux, qui sentaient naître une autre immortalité pour Rancé, commençaient à s’accroître ; on avait sans cesse devant les yeux les premières erreurs du solitaire, on s’obstinait à ne voir dans sa conversion que des motifs de vanité. Ses plus grands amis, l’abbé de Prières, visiteur de l’ordre était lui-même épouvanté des réformes de La Trappe ; il écrivait à l’abbé : « Vous aurez beaucoup d’admirateurs, mais peu d’imitateurs. »
Maubuisson, abbaye près de Pontoise, avait été bâtie par la reine Blanche, et l’on y voyait son tombeau : Rancé écrivit à la supérieure, découragée, de cette abbaye. Il écrivait à une autre femme, car tous les souffrants consultaient ce savant médecin qui avait essayé les remèdes sur lui-même : « Si l’ennui vous attaque, pensez que Jésus-Christ vous attend ; toute votre course et sa durée ne vous paraîtront qu’une vapeur dans ce point auquel il faudra qu’elle finisse. »
Le 7 septembre 1672 Rancé présenta une requête au roi en faveur de la réforme ; il commence par dire que les anciens solitaires, dont il ne mérite de porter ni le nom ni l’habit, n’ont point fait difficulté de sortir du fond de leurs déserts pour le service de Dieu ; qu’à leur exemple il croirait manquer au plus saint de ses devoirs s’il se taisait ; que malheureusement il ne va parler que pour se plaindre, et que celui qui lui ouvre la bouche n’a mis sur ses lèvres que des paroles de douleur. De là passant à son sujet, il parle de l’ordre de Cîteaux, prêt à retomber dans les périls dont il est échappé, par le défaut de protection refusée à l’étroite observance établie par Louis XIII. Pendant que les solitaires ont vécu dans la perfection ils ont été considérés comme les anges tutélaires des monarchies ; ils ont soutenu, par le pouvoir qu’ils avaient auprès de Dieu, la fortune de l’empire : une sainte recluse avait connu en esprit ce qui se passait à la journée de Lépante. « Votre Majesté, ajoute Rancé, ne sera point surprise qu’étant obligé par le devoir de ma profession de me présenter à tous les instants au pied des autels du Roi du ciel, j’aborde une fois dans ma vie le trône du roi de la terre. »
La cour de Rome, qu’avaient en vue les réformes trop austères de La Trappe, s’opposait aux exagérations de ses serviteurs ; Rancé annonçait son habileté en réveillant la passion du pouvoir dans le cœur de Louis XIV.
Dans tous les bruits répandus, les uns dénonçaient Rancé pour sa doctrine, prétendant qu’elle n’était pas pure ; les autres le taxaient d’hypocrisie, les autres lui reprochaient d’introduire dans l’ordre des voies nouvelles. Le roi, vers la fin d’octobre 1673, lui accorda pour juger la question les commissaires qu’il avait demandés, l’archevêque de Paris, le doyen de Notre-Dame, MM. de Caumartin, de Fieubet, de Voisin et de La Marquerie.
Ses adversaires faisaient en même temps des démarches à Rome contre lui. « Pour un moine, disait Rancé, il n’y a pas de réputation qui lui soit due. Il n’est que pour être homme d’opprobre et d’abjection. »
On popularisait ces sentiments hostiles en les répandant dans des vers qui ne valaient pas ceux de notre grand chansonnier, mais qui marquaient déjà la trace par où la France devait arriver à une immortalité qui n’appartient qu’à elle. On trouve cette allure qui nous a amenés des chanteurs de François Ier à Béranger :
Je suis revenu de La Trappe,
Cette maudite trappe à fou ;
Et si jamais le diable m’y attrape,
Je veux qu’on me casse le cou.
Ce maudit trou n’est qu’une trappe,
Ce maudit trou
N’est qu’une trappe à fou.
Les commissaires nommés par le cabinet s’étant assemblés, Rancé fut mandé à Paris, en 1675. Ils avaient tout réglé selon les intentions du serviteur de Dieu ; mais un abbé de la commune observance déclara que si l’on suivait les avis des commissaires, les abbés étrangers ne viendraient pas au chapitre général de Cîteaux. Le roi s’arrêta : tout se tenait alors, un mouvement dans le clergé pouvait entraîner un dérangement dans les affaires. Louis XIV le savait, et rien n’était si prudent que ce roi absolu élevé aux incartades de la Fronde.
Rancé purgea sa bibliothèque ; il répondit à l’évêque de Pamiers et à M. Deslions, qui, dans le dessein de le décourager, lui disaient qu’il était encore loin des austérités des premiers chrétiens : « Il est vrai que le pain de tourbe dont vous me parlez était fort en usage parmi les moines. »
En 1676, il contracta une maladie habituelle, avec laquelle il mourut, mais qui ne l’empêcha pas de travailler. Après avoir passé trois mois à l’infirmerie, il revint à la communauté. Ainsi s’écoula sa vie jusqu’en 1689, qu’il fut saisi d’une grosse fièvre. Aussitôt que le mal lui laissait quelque relâche, il reprenait ses occupations, suivies de rechutes : « La vie d’un pécheur comme moi dure toujours trop » disait-il.
Mademoiselle, grand hurluberlu, qui se trouvait partout avec son imagination, écrivit à Rancé, et lui demanda quelques religieux. Il lui répondit : « Je suis fort persuadé, mademoiselle, que votre altesse royale ne doute point que je n’eusse une extrême joie de pouvoir lui nommer un religieux tel qu’elle le désire, mais j’en ai perdu huit depuis un an, qui sont allés à Dieu. Il y en a d’autres qui sont près de les suivre ; et quoique nous soyons encore un nombre considérable, nous ne vivons plus ni les uns ni les autres que dans la vue et le désir de la mort. »
A cette époque mourut un religieux qui n’avait pas plus de vingt-trois ans, et qui, dans son attirail de décédé, dit à Rancé : « J’ai bien de la joie de me voir dans l’habit de mon départ. » Il souriait lorsqu’il allait mourir, comme les anciens barbares. On croyait entendre cet oiseau sans nom qui console le voyageur dans le vallon de Cachemir.
C’est sur ce fond de La Trappe que venaient se jouer les scènes extérieures. Les silhouettes du monde se dessinaient autour des ombres, le long des étangs et dans les futaies. Le contraste était plus frappant qu’à Port-Royal, car on n’apercevait pas M. d’Andilly marchant une serpe à la main, le long des espaliers, mais quelque vieux moine courbé allant, une bêche sur l’épaule, creuser une fosse dans le cimetière. C’étaient ces scènes de bergeries que l’on voit dans les tableaux des grands peintres.
Une des premières personnes du monde avec laquelle Rancé eut des rapports fut Mlle d’Alençon, autrement Mme de Guise, fille de Gaston et cousine germaine de Louis XIV. Mlle d’Alençon, bossue, épousa le dernier duc de Guise, dont elle eut un fils, qui mourut vite. « Le mérite, dit Mademoiselle dans ses Mémoires, qu’avaient autrefois en France les Lorrains du temps du Balafré et de tous ces illustres MM. de Guise, n’avait pas continué dans tout ce qui était resté du même nom. » Le duc de Guise, mari de Mlle d’Alençon, n’avait qu’un pliant devant sa femme : il ne mangeait qu’au bout de la table, encore fallait-il qu’on lui eût permis de s’asseoir.
M. Boistard, capitaine employé à Saint-Cyr, a bien voulu me communiquer un recueil manuscrit contenant vingt-sept lettres de l’abbé de Rancé à Mme de Guise. La lettre écrite du 3 mars 1692 parle de la mort d’un solitaire de La Trappe. Ces lettres parlent aussi de Jacques II : « On est inexorable, dit Rancé, pour ceux qui n’ont pas la fortune de leur côté. » Rancé affirme, dans la lettre du 7 septembre 1693, « que le propre d’un chrétien est d’être sans souvenir, sans mémoire et sans ressentiment. » Quand on a, un siècle plus tard, vu passer 1793, il est difficile d’être sans souvenir.
Louis XIV avait de l’affection pour Mme de Guise, bien qu’il s’emportât contre elle lorsqu’elle s’enfuit à La Trappe sur le bruit que le prince d’Orange allait descendre en France. Quand elle allait à l’abbaye, elle y passait plusieurs jours. Mme de Guise mourut à Versailles, le 17 mars 1696 ; elle avait vendu à Louis XIV le palais d’Orléans, aujourd’hui le palais du Luxembourg. Elle fut enterrée non à Saint-Denis, mais aux Carmelites. L’oraison funèbre de Mme de Guise fut prononcée à Alençon par le Père Dorothée, capucin : c’est toute la pompe que la religion livrée à elle seule accordait aux grands.
Immédiatement avec Mme de Guise parut à La Trappe le duc de Saint-Simon. Il faudrait presque révoquer en doute ce qu’il raconte de la manière dont il parvint à faire croquer par Rigaut le portrait de Rancé, si Maupeou n’avait rapporté les mêmes détails. Le père de Saint-Simon tenait son titre de Louis XIII ; il avait acheté une terre voisine de La Trappe ; il menait souvent son fils à l’abbaye. Saint-Simon serait très croyable dans ce qu’il rapporte s’il pouvait s’occuper d’autre chose que de lui. A force de vanter son nom, de déprécier celui des autres, on serait tenté de croire qu’il avait des doutes sur sa race. Il semble n’abaisser ses voisins que pour se mettre en sûreté. Louis XIV l’accusait de ne songer qu’à démolir les rangs, qu’à se constituer le grand-maître des généalogies. Il attaquait le parlement, et le parlement rappela à Saint-Simon qu’il avait vu commencer sa noblesse. C’est un caquetage éternel de tabourets dans les Mémoires de Saint-Simon. Dans ce caquetage viendraient se perdre les qualités incorrectes du style de l’auteur, mais heureusement il avait un tour à lui ; il écrivait à la diable pour l’immortalité.
Le duc de Penthièvre parut plus tard à La Trappe : Saint-Simon ne se put guérir de l’âcreté de son humeur dans une solitude où le petit fils du comte de Toulouse perfectionna sa vertu : le fiel et le miel se composent quelquefois sous les mêmes arbres. Pieux et mélancolique, le duc de Penthièvre fit augmenter, s’il ne bâtit pas entièrement, l’abbatiale, où il aimait se retirer, en prévision du martyre de sa fille. La princesse de Lamballe, enfant, venait s’amuser à la maison-Dieu ; elle fut massacrée après la dévastation du monastère. Sa vie s’envola comme ce passereau d’une barque du Rhône, qui, blessé à mort, fait pencher en se débattant l’esquif trop chargé.
Pellisson fréquentait La Trappe. Il s’était flatté de faire consentir le roi à certain arrangement. Rancé insistait pour que sa communauté eût le droit de choisir un prieur. « Je ne doute pas, mandait-il à Pellisson, que vous ne voyiez mieux que moi tout ce que je ne vous dis pas sur cette matière, parce que vos connaissances sont plus étendues et vont beaucoup plus loin que les miennes. »
Pellisson abjura le protestantisme en 1670, à Chartres, entre les mains de l’évêque de Comminges, et s’attacha ensuite à Bossuet. Pellisson est célèbre pour avoir élevé une araignée : il demeura ferme dans le procès de Fouquet, si bien débrouillé par M. Monmerqué. Il écrivit, en défense de son ancien patron, trois mémoires sur lesquels on pourrait encore jeter les yeux avec fruit. Louis XIV le ménagea ; il s’aperçut que la conquête lui ferait honneur et ne serait pas difficile ; mais comme l’ancien commis des finances mourut sans confession, on le soupçonna toujours. Rancé le défendit toujours : la célébrité adoucissait sa foi. Rancé avait peut-être vu Pellisson chez le cardinal de Richelieu lors de la création de l’Académie. Pellisson avait aimé Mlle de Scudéry ; il n’était pas beau, elle ne perdit point sa bonne réputation.
Bossuet, camarade de collège de Rancé, visita son condisciple ; il se leva sur La Trappe comme le soleil sur une forêt sauvage. L’aigle de Meaux se transporta huit fois à cette aire. Ces différents vols vont toucher à des faits dont la mémoire est restée. En 1682 Louis XIV s’établit à Versailles. En 1685 Bossuet composa à La Trappe l’avertissement du Catéchisme de Meaux. En 1686 l’orateur mit fin à ses Oraisons funèbres par le chef-d’œuvre qu’il prononça devant le cercueil du grand Condé. En 1696 s’en alla à Dieu Sobieski, ancien mousquetaire de Louis le Grand. Sobieski entra dans Vienne par la brèche qu’avait ouverte le canon des Turcs. Les Polonais sauvèrent l’Europe, qui laisse exterminer aujourd’hui la Pologne. L’histoire n’est pas plus reconnaisante que les hommes.
La Trappe était le lieu où Bossuet se plaisait le mieux : les hommes éclatants ont un penchant pour les lieux obscurs. Devenu familier avec le chemin du Perche, Bossuet écrivait à une religieuse malade : « J’espère bien vous rendre, à mon retour de La Trappe, une plus longue visite », paroles qui n’ont d’autre mérite que d’être jetées à la poste en passant et d’être signées : Bossuet.
Bossuet trouvait un charme dans la manière dont les compagnons de Rancé célébraient l’Office divin : « Le chant des Psaumes, dit l’abbé Ledieu, qui venait seul troubler le silence de cette vaste solitude, les longues pauses de Complies, le son doux, tendre et perçant du Salve Regina, inspiraient au prélat une sorte de mélancolie religieuse. » A La Trappe il me semblait en effet pendant ces silences ouïr passer le monde avec le souffle du vent. Je me rappelais ces garnisons perdues aux extrémités du monde et qui font entendre aux échos des airs inconnus, comme pour attirer la patrie : ces garnisons meurent, et le bruit finit.
Bossuet assistait aux offices du jour et de la nuit. Avant Vêpres, l’évêque et le réformateur prenaient l’air. On m’a montré près de la grotte de Saint-Bernard une chaussée embarrassée de broussailles qui séparait autrefois deux étangs. J’ai osé profaner, avec les pas qui me servirent à rêver René, la digue où Bossuet et Rancé s’entretenaient des choses divines. Sur la levée dépouillée je croyais voir se dessiner les ombres jumelles du plus grand des orateurs et du premier des nouveaux solitaires.
Bossuet reçut le viatique le lundi saint de l’année 1704 : il y avait quatre ans que Rancé n’existait plus. Bossuet se plaignait d’être importuné de sa mémoire, sa garde lui soutenait la tête : « Cela serait bon, disait-il, si ma tête pouvait se tenir. » Dans un de ces moment, l’abbé Ledieu lui prononça le mot de gloire ; Bossuet reprit : « Cessez ces discours ; demandez pour moi pardon à Dieu. »
Le 12 avril 1704, les pieds et les mains du moribond s’engourdirent. Un peu avant quatre heures et demie du matin il expira : c’était l’heure où son ami Rancé priait aux approches du jour. L’aigle qui s’était en passant reposé un moment dans ce monde reprit son vol vers l’aire sublime dont il ne devait plus descendre : il n’est resté de ce sublime génie qu’une pierre.
Rancé eut d’abord la pensée de se démettre de son abbaye ; il consulta Bossuet au mois de décembre 1682. Bossuet lui répondit d’attendre. Dans cette année le père d’un jeune mousquetaire réfugié à La Trappe se plaignit de la captation dont on avait usé envers son fils, il ne reçut de l’abbé que ces mots : « Vous le quitterez bientôt. »
En ce temps-là mourut l’abbé de Prières. J’en ai souvent parlé. Il fit écrire à Rancé par un prêtre : « L’abbé de Prières m’ordonna dans les derniers moments de sa vie de vous donner avis de sa mort en vous témoignant l’estime qu’il a conservée pour vous jusqu’au dernier soupir. »
Ces honnêtes gens se léguaient leur estime.
De toutes les accusations portées contre Rancé aucune ne s’appuyait sur une apparence de vérité, excepté celle de jansénisme. On a une lettre de lui, adressée en 1676 à M. de Brancas ; elle s’exprime ainsi :
« Je vous dis, en parlant de M. Arnauld et de ces messieurs, que le pape était content d’eux, et qu’il avait reçu leur signature en la manière qu’ils l’avaient donnée ; vous me répondîtes, ce que déjà des personnes de piété m’avaient donné comme une chose constante, qu’ils l’avaient surpris, et que le pape avait fait comme ceux qui mettent la main devant leurs yeux, et font semblant de ne pas voir. Cependant monsieur, il m’est tombé entre les mains, depuis quelques jours, l’arrêt qui a été donné contre M. l’évêque d’Angers, qui porte expressément que le pape, avec beaucoup de prudence, a voulu recevoir la signature de quelques particuliers avec une explication plus étendue pour les mettre à couvert de leurs scrupules et des peines portées par les constitutions. Tellement, monsieur, que non seulement il n’a pas fait semblant de ne pas voir qu’ils aient signé avec explication mais même il l’a prouvé et s’en est contenté. Je suis bien heureux monsieur, de n’avoir jugé personne. Où en serais-je réduit si j’avais condamné des gens que le pape reçoit dans le fait même pour lequel je les aurais condamnés ? Et à quelle réparation ne serais-je point tenu si j’avais porté un jugement contre eux, et que j’eusse donné à d’autres de faire la même chose sur mon témoignage ! car dans le fond j’aurais, contre le respect que je dois au pape et contre ses intentions, condamné ceux qu’il justifie, et considéré comme personnes qui sont dans l’erreur et dans la désobéissance celles dont il est satisfait et qu’il reçoit dans son sein et dans sa communion et par une conduite pleine de charité et de sagesse. Je vous assure, monsieur, qu’il ne m’arrivera pas de juger, et que je serai plus religieux que jamais dans les résolutions que j’ai prises sur ce sujet-là. Je vous parle sans passion et dans un désintéressement entier de tous les partis (car je n’en ai aucun et je suis incapable d’en avoir que celui de l’Église), mais dans la créance que c’est Jésus-Christ qui me met au cœur ce que je vous vas dire.
« Il est impossible que Dieu demande compte ni à vous ni à moi de ce que nous nous serons abstenus de juger, n’ayant pour cela ni caractère ni obligation ; mais il se peut très bien faire qu’une conduite opposée chargerait nos consciences, quelque bonnes que soient nos intentions, si ceux qui ont autorité ou qui ont obligation de juger se mécomptent pour y avoir apporté toute l’application, les soins et la diligence nécessaires. Ils peuvent espérer que Dieu, qui connaît le fond de leurs cœurs, leur fera miséricorde ; mais pour ceux qui s’avancent et qui n’ont point de mission, si ce malheur leur arrive, ils ne peuvent attendre qu’une punition rigoureuse ; car dès le moment qu’ils se sont ingérés et ont usurpé un droit qui ne leur appartenait point ils ont mérité que Dieu les abandonne à leurs propres ténèbres. Je vous assure, monsieur, soit que je pense que Jésus-Christ nous a déclaré qu’il châtierait d’un supplice éternel celui qui dirait à son frère une légère injure, ou que je me regarde comme étant sur le point d’être jugé moi-même, il n’y a rien dont je sois plus éloigné que de juger les autres.
« Voilà quelle doit être la disposition de tout homme qui ne sera point prévenu, qui regardera les choses dans leur vérité, sans intérêt et sans passion ; mais le mal est que nous croyons n’en pas avoir, parce que nous n’en avons point de propre et de particulière. Cependant nous sommes souvent engagés dans celles des autres sans nous en apercevoir. Pour moi, je suis persuadé qu’en de telles manières la voie la plus sure est de demeurer dans la soumission et dans le silence. C’est le moyen de m’attirer tous les partis et de ne plaire à personne ? mais, pourvu que je plaise à Dieu et que je me tienne dans son ordre, je ne me mets point en peine de quelle manière les hommes expliqueront ma conduite. Véritablement je ne sais plus de ce monde, et je ne suis pas assez malheureux pour y rentrer après l’avoir quitté par le dessein que j’aurais de le contenter contre mon devoir et les mouvements de ma conscience. Vous connaîtrez sans doute, monsieur, qu’il est si difficile, lorsqu’on parle dans les causes, même les plus justes, de se tenir dans les règles de la modération et de la charité, que ceux-là sont heureux que Dieu a mis dans des états où rien ne les oblige ni de parler ni de se produire ; et je vous confesse que je ne me lasse point d’admirer et de plaindre en même temps l’aveuglement de la plupart des hommes qui ne font non plus de difficulté de dire : Cet homme est schismatique, que s’ils disaient : Il a le teint pâle et le visage mauvais. Quand je vous dis, monsieur, que je ne vous parle que pour vous seul, ce n’est pas que je ne veuille bien que l’on sache quels sont mes sentiments et mes pensées sur ce point-là ; mais je serais encore plus aise, comme c’est la vérité, que l’on ne s’imagine pas que je m’occupe des affaires qui ne me regardent point.
« Je ne saurais m’empêcher de vous dire encore qu’il n’y a rien de moins vrai que ce que l’on dit que je faisais pénitence d’avoir signé le formulaire, puisque je le signerai toutes les fois que mes supérieurs le désireront, et que je suis persuadé qu’en cela mon sentiment est le véritable. Mais je ne nie point que dans le nombre presque infini de crimes et de maux dont je me sens redevable à la justice divine, celui d’avoir imputé aux personnes qu’on appelle jansénistes des opinions et des erreurs dont j’ai reconnu dans la suite qu’ils n’étaient pas coupables n’y puisse être compris. Étant dans le monde, avant que je pensasse sérieusement à mon salut, je me suis expliqué contre eux en toute rencontre, et me suis donné sur cela une entière liberté, croyant que je le pouvais faire sur la relation des gens qui avaient de la piété et de la doctrine. Cependant je me suis mécompté, et ce ne sera point une excuse pour moi au jugement de Dieu, d’avoir cru et d’avoir parlé sur le rapport et sur la foi des autres. Cela m’a fait prendre deux résolutions que j’espère de garder inviolablement avec la grâce de Dieu : une, de ne croire jam...