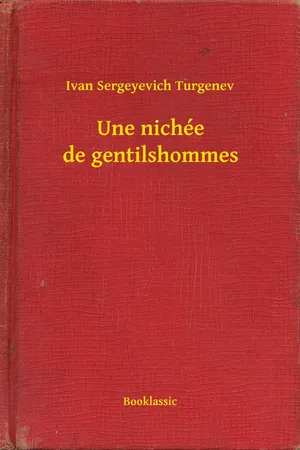Pendant ce temps, en bas, au salon, on jouait
à la préférence. Maria Dmitriévna gagnait, et était de bonne
humeur. Un domestique entra et annonça Panchine. Maria Dmitriévna
laissa tomber les cartes et s’agita sur son fauteuil ; Varvara
Pavlowna la regarda d’un air moqueur, puis dirigea ses regards vers
la porte. Panchine parut ; il avait un frac noir boutonné
jusqu’en haut, et un grand faux col anglais.
« Il m’en a coûté ; mais, vous
voyez, je suis venu. » Voilà ce qu’exprimait son visage rasé
de frais et sans l’ombre d’un sourire.
– Que vous arrive-t-il, Voldemar ?
s’écria Maria Dmitriévna, jusqu’à présent, vous entriez sans vous
faire annoncer.
Panchine ne lui répondit que par un regard, la
salua respectueusement, mais ne lui baisa pas la main. Elle le
présenta à Varvara Pavlowna ; il recula d’un pas, salua cette
dernière avec une égale politesse, mais avec une nuance de grâce et
de respect de plus, et vint s’asseoir à la table de jeu.
La partie de préférence se termina bientôt.
Panchine demanda des nouvelles de Lisaveta Michailovna ; il
apprit qu’elle était souffrante. Il en témoigna du regret ;
ensuite il se mit à causer avec Varvara Pavlowna, pesant
diplomatiquement sur les mots et accentuant chaque parole, écoutant
avec déférence ses réponses jusqu’au bout.
Mais la gravité de son ton diplomatique était
sans effet sur Varvara Pavlowna. Elle le regardait en face,
gaiement attentive, parlait avec aisance, tandis qu’un rire
combattu semblait crisper ses narines délicates. Maria Dmitriévna
commença par porter aux nues le talent de la jeune femme. Panchine
inclina poliment la tête, autant du moins que le lui permettait son
col empesé, disant « qu’il en était à l’avance
convaincu, » et entama une conversation où il alla presque
jusqu’à parler de M. de Metternich.
Varvara Pavlowna ferma à demi ses yeux de
velours, et dit à voix basse :
– Mais vous aussi, vous êtes artiste.
Puis elle ajouta plus bas encore :
– Venez !
Et elle indiqua le piano d’un mouvement de
tête.
Cette seule parole, tombée de ses
lèvres : « Venez ! » changea en un moment,
comme par magie, toute la manière d’être de Panchine. Son air
soucieux disparut ; il sourit, s’anima, déboutonna son
frac :
– Moi, un artiste, hélas !
dit-il ; mais vous, à ce que l’on dit, vous êtes une artiste
véritable.
Et il suivit Varvara Pavlowna au piano.
– Faites-lui chanter sa romance à la
lune ! s’écria Maria Dmitriévna.
– Vous chantez ? demanda Varvara
Pavlowna, en jetant sur lui un regard lumineux et rapide.
Asseyez-vous.
Panchine voulut s’en défendre.
– Asseyez-vous, répéta-t-elle en frappant
impérieusement sur le dossier de la chaise.
Il s’assit, toussa, écarta son col, et chanta
sa romance.
– Charmant ! murmura Varvara
Pavlowna. – Vous chantez très-bien ; vous avez du style. –
Recommencez.
Elle fit le tour du piano et se plaça juste en
face de Panchine. Il répéta la romance en imprimant à sa voix une
vibration déclamatoire. Varvara Pavlowna, accoudée sur le piano et
tenant ses blanches mains à la hauteur de ses lèvres, le regardait
fixement. Panchine cessa de chanter.
– Charmant ! charmante idée !
dit-elle avec la tranquille assurance d’un connaisseur. Dites,
avez-vous écrit quelque chose pour voix de femme, pour
mezzo-soprano ?
– Je n’écris presque rien, répondit
Panchine. Je ne le fais qu’en passant, dans mes moments perdus…
Mais vous, chantez-vous ?
– Oui, je chante.
– Oh ! chantez-nous quelque
chose ! s’écria Maria Dmitriévna.
Varvara Pavlowna rejeta la tête en arrière,
et, avec la main, écarta ses cheveux de ses joues qui s’étaient
colorées.
– Nos voix doivent bien aller ensemble,
dit-elle en se retournant vers Panchine. – Chantons un duo.
Connaissez-vous Son geloso, ou bien La ci darem la
mano, ou Mira la bianca luna ?
– Je chantais autrefois Mira
la bianca luna, répondit Panchine, – mais il y a longtemps de
cela ; je l’ai oublié.
– Cela ne fait rien ; nous le
répéterons à mi-voix. Laissez-moi m’asseoir.
Varvara Pavlowna se mit au piano. Panchine se
plaça à côté d’elle. Ils chantèrent le duo tout bas ; Varvara
Pavlowna le reprit à divers endroits, puis ils le chantèrent haut,
puis ils le répétèrent encore deux fois : Mira la bianca
lu… n… na. Varvara Pavlowna n’avait plus la voix fraîche, mais
elle savait la manier avec beaucoup d’art. Panchine fut d’abord
intimidé ; ses intonations étaient fausses ; il prit
bientôt son courage à deux mains, et s’il ne chanta pas d’une
manière irréprochable, au moins il remuait les épaules, balançait
tout son corps, et levait de temps en temps la main comme un vrai
chanteur. Varvara Pavlowna joua deux ou trois petits morceaux de
Thalberg, et dit d’un air coquet une romance française.
Maria Dmitriévna ne savait plus comment exprimer sa
satisfaction ; elle voulut plus d’une fois envoyer chercher
Lise ; de son côté, Guédéonofski ne trouvait pas de parole et
branlait seulement la tête ; – mais, tout à coup, il bâilla à
l’improviste, et eut à peine le temps de mettre la main sur sa
bouche. Ce bâillement n’échappa point à Varvara Pavlowna ;
elle tourna aussitôt le dos au piano, en ajoutant :
– Assez de musique comme cela ;
causons.
Elle croisa les mains.
– Oui, assez de musique, répéta gaiement
Panchine.
Et il entama avec elle, en français, une
conversation alerte et légère.
– On se croirait dans un salon parisien,
se disait Maria Dmitriévna, en écoutant leur conversation pleine de
finesse et de détours.
Panchine était dans la jubilation, ses yeux
brillaient, ses lèvres souriaient. D’abord, quand il rencontrait le
regard de Maria Dmitriévna, il passait la main sur son visage,
fronçait le sourcil, et poussait de gros soupirs ; mais
bientôt il oublia tout à fait son rôle et s’abandonna sans réserve
au plaisir d’une causerie moitié mondaine, moitié artistique.
Varvara Pavlowna se montra philosophe accomplie : elle avait
réponse à tout ; rien ne l’embarrassait et elle ne doutait de
rien ; il était facile de voir qu’elle avait causé souvent et
beaucoup avec des hommes d’esprit de nature différente. Paris était
le pivot de toutes ses pensées, de tous ses sentiments. Panchine
amena la conversation sur la littérature : il se trouva
qu’elle-même, aussi bien que lui, n’avait lu que des ouvrages
français : George Sand lui inspirait de l’indignation ;
elle admirait Balzac tout en le trouvant fatigant ; dans
Eugène Sue et Scribe elle voyait des connaisseurs profondément
humains ; elle adorait Dumas et Féval ; dans son for
intérieur, elle préférait à tous Paul de Kock, mais il va sans dire
qu’elle ne prononça pas même son nom. À dire vrai, la littérature
l’intéressait médiocrement. Varvara Pavlowna évitait avec soin tout
ce qui pouvait même de loin rappeler sa position ; il n’était
pas le moins du monde question d’amour dans tout ce qu’elle
disait ; au contraire, ses discours respiraient plutôt un
certain rigorisme pour les entraînements du cœur, et marquaient le
désenchantement et la modestie. Panchine la réfutait ; elle
tenait bon… Mais, chose étrange ! pendant qu’elle laissait
tomber de ses lèvres des paroles de blâme, souvent impitoyables, le
son même de sa voix était caressant et tendre, et ses yeux
semblaient dire… Ce que disaient précisément ses beaux yeux, il
aurait été difficile de le définir, mais leur langage doux et voilé
n’avait rien de sévère. Panchine s’efforçait d’en pénétrer le sens
intime, il s’efforçait aussi de faire parler ses regards ;
mais il sentait son impuissance ; il avait conscience de
l’avantage qu’avait sur lui Varvara Pavlowna, cette lionne venue de
l’étranger, cette quasi Parisienne, et devant elle il ne se sentait
pas tout à fait maître de lui-même. Varvara Pavlowna avait
l’habitude, tout en causant, d’effleurer légèrement la manche
d’habit de son interlocuteur ; ces attouchements momentanés
troublaient beaucoup Vladimir Nicolaewitch. Varvara Pavlowna
possédait l’art d’être bientôt à son aise avec tout le monde ;
il ne s’était pas passé deux heures, qu’il semblait déjà à Panchine
la connaître depuis une éternité, tandis que Lise, cette même Lise
qu’il aimait cependant encore, dont il avait demandé la main la
veille, Lise restait pour lui dans l’éloignement et semblait se
perdre dans un brouillard. On servit le thé. La conversation prit
un tour encore plus intime. Maria Dmitriévna sonna le petit
cosaque, et lui ordonna de dire à Lise qu’elle descendît au salon,
si sa migraine était dissipée. Au nom de Lise, Panchine se mit à
discourir sur l’abnégation et le sacrifice, et à débattre cette
question : Qui en est plus capable de l’homme ou de la
femme ? Maria Dmitriévna prit feu aussitôt, affirma que la
femme en était certes plus capable, déclara qu’elle le prouverait
en deux mots, s’embrouilla, et après avoir hasardé une comparaison
assez malheureuse, finit par se taire. Varvara Pavlowna prit un
cahier de musique, s’en couvrit à moitié le visage, et se tournant
vers Panchine, lui dit à demi-voix, un doux sourire sur les lèvres
et dans les yeux, tout en grignotant un biscuit :
– Elle n’a pas inventé la poudre, la
bonne dame.
Panchine fut un peu surpris et effrayé de la
hardiesse de Varvara Pavlowna, mais il ne comprit point combien
cette réflexion inattendue trahissait de mépris pour
lui-même ; et, oubliant les caresses et l’attachement de Maria
Dmitriévna, oubliant les dîners qu’elle lui avait offerts, l’argent
qu’elle lui avait prêté en secret, il répondit, le
malheureux ! avec un accent et un sourire
semblables :
« Je crois bien ! » et pas même
« je crois bien ! » mais – « j’crois
ben ! »
Varvara Pavlowna lui jeta un regard amical et
se leva. Lise parut ; Marpha Timoféevna avait en vain essayé
de la retenir ; la jeune fille voulait endurer l’épreuve
jusqu’au bout. Varvara Pavlowna alla à sa rencontre ainsi que
Panchine, dont la figure reprit aussitôt sa première expression
diplomatique.
– Comment va votre santé ?
demanda-t-il à Lise.
– Je vais mieux à présent ; merci,
répondit-elle.
– Nous autres, nous avons fait un peu de
musique ; il est fâcheux que vous n’ayez pas entendu madame
Lavretzky. Elle chante admirablement bien, en artiste
consommée.
– Venez ici ! s’écria Maria
Dmitriévna.
Varvara Pavlowna se leva aussitôt avec la
soumission d’un enfant, et s’assit à ses pieds sur un petit
tabouret. Maria Dmitriévna ne l’appelait que pour faciliter à
Panchine un court entretien avec Lise : elle espérait encore
que sa fille se raviserait. Il lui vint de plus une idée en tête,
qu’elle voulut tout aussitôt réaliser.
– Savez-vous, dit-elle tout bas à Varvara
Pavlowna, je veux essayer de vous réconcilier avec votre
mari ; je ne réponds point du succès, mais j’essayerai. Vous
savez qu’il a beaucoup d’estime pour moi.
Varvara Pavlowna leva lentement les yeux sur
Maria Dmitriévna et croisa les bras avec grâce.
– Vous êtes mon sauveur, ma tante,
dit-elle d’une voix triste : je ne sais comment vous remercier
de toutes vos bontés ; mais je suis trop coupable devant
Théodore Ivanowitch, il ne peut me pardonner.
– Mais… est-ce qu’en effet… ?
commença à dire Maria Dmitriévna avec un accent de curiosité.
– Ne me demandez rien, interrompit
Varvara Pavlowna en baissant les yeux. J’ai été jeune,
inconsidérée… Du reste, je ne veux pas me justifier.
– Cependant, pourquoi ne pas
essayer ? Ne vous désespérez pas, répliqua Maria
Dmitriévna.
Et elle voulut lui donner une petite tape sur
la joue ; mais, jetant un regard sur ses traits, elle fut
intimidée.
« Toute modeste qu’elle est,
pensa-t-elle, c’est toujours une lionne. »
– Êtes-vous malade ? disait pendant
ce temps-là Panchine à Lise.
– Oui ; je ne me porte pas bien.
– Je vous comprends, dit-il après un
assez long silence. – Oui, je vous comprends.
– Que voulez-vous dire ?
– Je vous comprends, répéta avec emphase
Panchine, qui ne savait trop que dire.
Lise se troubla un moment, mais elle ne tarda
pas à prendre vaillamment son parti.
Panchine affectait un air mystérieux ; il
se tut en se détournant et en prenant une contenance grave.
– Il me semble toutefois qu’il est déjà
onze heures, observa Maria Dmitriévna.
La société comprit et commença à faire ses
adieux.
Varvara Pavlowna fut obligée de promettre
qu’elle viendrait dîner le lendemain, et qu’elle amènerait avec
elle Adda ; Guédéonofski, qui avait failli s’endormir, assis
dans son coin, s’offrit pour la reconduire chez elle.
Panchine salua tout le monde avec des façons
toutes solennelles. Mais se trouvant sur le perron et mettant
Varvara Pavlowna en voiture, il lui serra la main, et lui dit de
nouveau :
– Au revoir.
Guédéonofski avait pris place à côté
d’elle ; pendant toute la route, elle s’amusa à mettre comme
par hasard le bout de son petit pied sur celui de son voisin ;
il s’embarrassait, il se confondait en compliments : elle
souriait coquettement, et l’agaçait du regard quand le reflet du
réverbère de la rue pénétrait dans la voiture.
La valse qu’elle venait de jouer tournoyait
encore dans sa tête, et la préoccupait. Quel que fût l’endroit où
elle se trouvait, il lui suffisait de se représenter une salle de
bal, les lustres, un tournoiement rapide au son de la musique, pour
qu’une animation fébrile bouillonnât aussitôt dans son âme ;
ses yeux s’allumaient d’un feu intérieur, un sourire errait sur ses
lèvres, une certaine grâce lascive semblait se répandre sur toute
sa personne.
Arrivée chez elle, Varvara Pavlowna sauta
légèrement de voiture, – il n’y a que les lionnes qui sachent
sauter ainsi, – se tourna vers Guédéonofski et tout à coup lui
éclata de rire au nez.
« C’est une charmante créature – pensait
le conseiller d’État, en revenant chez lui, où l’attendait son
domestique avec une fiole de baume d’Opodeldoch ; – il est
heureux que je sois un homme posé… Seulement pourquoi s’est-elle
mise à rire ? »
Marpha Timoféevna passa toute la nuit au
chevet de Lise.