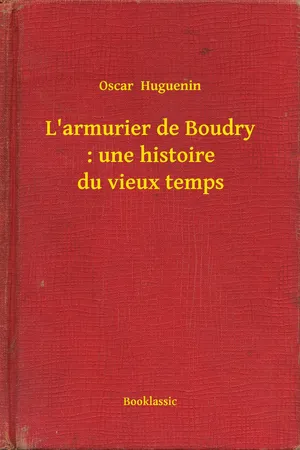Pour prendre les choses par leur commencement, il me faut parler premièrement de mes père et mère, lesquels ne furent point grands seigneurs en leur vivant. Mon père creusait les fosses des trépassés au cimetière de Pontareuse et mettait les cloches en branle pour les offices au moûtier du dit lieu, consacré à Notre-Dame et à Saint-Pierre. Un jour vint où le pauvre fossoyeur ayant été pris de fièvre maligne, défunta et fut mis en terre à son tour par un autre, lequel prit sa place de marguiller.
Ma mère en eut tant de chagrin, qu’elle quitta tôt après cette terre de douleurs ; sa pauvre dépouille fut déposée à côté de celle de son mari, et triste reste d’une pauvre mais honnête maison, je demeurai en mon bas-âge tout seulet sur la terre.
Je ne sais ces choses que par ouï-dire, étant pour lors un pauvre enfantelet de deux ans.
La bourgeoisie me plaça de ci de là, tantôt chez l’un, tantôt chez l’autre ; comme si j’eusse été marchandise avariée et de défaite malaisée, on me cédait à qui demandait la plus mince somme pour ma garde et ma nourriture. À mesure que je pris des forces et de la raison, mes patrons tirèrent tout ce qu’ils purent de mes bras et de mes jambes, me donnant d’autre part si maigre et si chétive pitance que je m’émerveille encore à l’heure qu’il est de n’avoir pas péri de langueur, mais d’être devenu si gros et si solide luron. J’avais néanmoins mes heures de tristesse : quand je voyais garçons et fillettes, les plus misérables comme les plus fortunés, avoir père et mère, ou du moins l’un des deux, pendant que moi, pauvre orphelin, il me fallait toujours obéir à des maîtres durs et malaisés à contenter, je me sentais devenir méchant et envieux. Pourquoi, disais-je amèrement, pourquoi la cruelle mort ne m’a-t-elle pas du moins laissé quelque frère ou sœur à aimer et qui m’eût aimé ?
Il faut savoir qu’un de mes maîtres, plus dur encore que les autres, avait dit un jour en ma présence qu’il était fort heureux pour la bourgeoisie que les autres enfants du marguiller fussent trépassés en bas âge.
J’avais grandement tort de murmurer contre la Providence, attendu que c’est là un grief péché ; au surplus, le bon Dieu, alors qu’il nous frappe, mesure l’affliction aux forces de notre pauvre nature, en sorte qu’on a grand’raison de dire en proverbe : « À brebis tondue, Dieu mesure le vent. »
En l’an de grâce 1526, étant dans ma quinzième année, je servais, comme petit valet, chez le sieur Abram Emonet, un des hommes les plus considérables de Vermondins (faubourg de Boudry), encore qu’il ne fût pas l’un des plus considérés, car s’il était, d’une part, gros propriétaire de biens au soleil, d’autre part, il était, de sa personne, un fort vilain sire, jamais à jeun de vin, cervoise et liqueurs, maugréant et tempêtant tout le long du jour contre sa femme, sa servante et notamment contre moi. Sauf le respect que je dois à ceux qui liront ceci, son visage bouffi avait bien plus l’apparence d’un groin de pourceau que la ressemblance humaine. Il avait un nez étonnant, en figure de carotte, lequel nez changeait de couleur suivant l’occasion, ainsi qu’on raconte de ce gros lézard des lointaines contrées, qu’on appelle, je crois, « camélion ».
Or un soir d’hiver, comme je balayais sous le « néveau » (porche ; néveau est probablement une corruption de « niveau »), ayant coupé du bois, je vis mon maître qui revenait de Pontareuse où il était allé suivre en terre un sien parent de Bosle. Le nez du sieur Emonet était violet tel qu’un pruneau mal mûr ; son couvre-chef tombait sur sa nuque, et ses jambes bancales se croisaient d’étrange manière : – Holà ! pensai-je en moi-même : le maître a bu, tu vas payer l’écot !
De fait, le sieur Emonet m’apostropha rudement :
– Qu’est-ce que tu fais là, graine de fainéant ? une belle besogne pour un gaillard de ta taille ! on voit bien de quelle race tu sors, fils de gueux !
Le sang me montait à la tête ; en cette maison, j’avais enduré bien des avanies déjà, mais je ne pouvais pas laisser nommer mon père un gueux.
– Maître, dis-je en serrant les dents, mon père était un pauvre hère, mais je ne veux pas qu’on le traite de gueux et de fainéant, celui qui dit cela en a menti par la gorge !
Mon maître se jeta sur moi comme un loup enragé, mais mis hors de moi et possédé par l’indignation, je lui assénai sur le chef un maître coup de balai, lequel coup lui enfonça son chapeau jusqu’au menton et fit choir l’ivrogne à la renverse.
Juste en ce moment apparut M. le curé Gauthier, lequel voyant le sieur Emonet se débattre dans la crotte en poussant des cris sourds, s’approcha vivement et me dit en se baissant :
– Holà ! est-ce qu’il est féru d’une attaque ?
Emonet qui venait enfin de se décoiffer avec violence au dommage notable de son nez, lui répondit lui-même en bégayant de courroux :
– Oui, oui, une attaque ! C’est ce gueux qui m’a attaqué, mais – et il proféra un effroyable blasphème – je vais lui bailler son dû !
M. le curé voyant pour lors ce qui en était, la colère d’Emonet, et comme je serrais mon manche à balai, se vint mettre entre nous deux, retint mon maître d’une poigne vigoureuse, comme on fait d’un chien hargneux, et dit avec autorité :
– Ça, voyons un peu : la paix, d’abord, et qu’on s’explique. Claude, mon garçon, comment as-tu pu porter la main sur ton maître ?
Ce n’était guère le moment de rire, mais il vous vient parfois au bout de la langue de ces drôleries qu’on ne peut pas se tenir de lâcher.
– Pas la main, M. le curé ; c’est le balai. Et puis, continuai-je en m’échauffant, il avait vilipendé mon père : je ne veux pas qu’il l’insulte, et s’il recommence…
– C’est bon, c’est bon, interrompit le digne homme en entraînant mon maître dans la maison.
Pour moi, jetant le balai sous le « néveau », je me pris à ruminer toute l’affaire, et je vis que je m’étais mis dans une fort méchante situation. Un jour, j’avais vu attaché au pilori du bas du pont un pauvre hère de braconnier qui avait assommé un lièvre dans une vigne. Et moi, malheureux ! j’avais fait bien pis ; n’avais-je pas quasi assommé un des bourgeois et propriétaires les plus considérables de la bourgeoisie et commune de Boudry ! Je me vis attaché au « tourniquet », le carcan de fer au cou, en butte aux risées et aux injures de tout le monde, puis je songeai avec angoisse au terrible et noir « croton » où l’on jetait les malfaiteurs ; et le gibet ! si on m’allait pendre ! À ce coup, horrifié jusqu’à en perdre le sens, je formais le dessein de m’aller cacher au plus profond de quelqu’une des baumes du Vaux de l’Areuse, quand M. le curé, ressortant seul du logis d’Emonet, me mit la main sur l’épaule :
– Suis-moi, mon gars, me dit-il doucement.
Et ainsi fis-je, en essuyant mes yeux avec la manche déchirée de ma souquenille. J’appréhendais fort ce qui m’allait advenir, d’autant que de Boudry à Pontareuse, M. le curé demeura silencieux, moi cheminant sur ses talons, ainsi qu’un pauvre chien à qui l’on va donner le fouet.
Quand nous fûmes au presbytère, M. Gauthier me poussa dans une chambre, où, sur des tablettes, il y avait nombre de bouquins gros et menus, avec des rouleaux de parchemin et un grand crucifix noir appendu au mur. Là, M. le curé se prit à me considérer, tandis que je tremblais dans mes haillons. C’est qu’il était de mine imposante, M. le curé Pierre Gauthier, avec sa haute stature, sa tête grise et crépue, ses yeux noirs, perçants sous la broussaille de ses sourcils, et par-dessus la bouche aux lèvres minces, son nez crochu en bec d’épervier ! Toutefois il me parut, comme je me risquais à lever les yeux, que ses paupières clignotaient, voire même que sa bouche, nullement sévère, s’apprêtait à sourire. Et de fait, se penchant vers moi pour me prendre sans rudesse par l’oreille :
– Mon fils, dit-il, sais-tu bien que le péché de colère est du nombre des sept péchés capitaux, et que l’homme qui s’y abandonne court droit à l’enfer ? Veille sur toi pour n’y pas retomber ! Toutefois, il est à croire que tes saints patrons ont plaidé là-haut pour obtenir ton absolution, eu égard à la cause que tu défendais. Présentement, poursuivit le digne homme, que dirais-tu de quitter le service du sieur Emonet pour entrer au mien ?
À l’ouïe de ces paroles, il me sembla voir une soudaine et magnifique lumière s’allumant pour éclairer le sombre chemin de ma vie.
J’avais ouï raconter quelque jour l’étrange aventure de quatre « marmets », – ainsi nomme-t-on en la comté de Neufchâtel les gens d’outre-lac – desquels marmets la nacelle venant de Portalban avait chaviré par grand vent de joran [3]. Les quatre hommes, accrochés durant plus d’une heure à leur nef renversée, avaient finalement été vus de Cortaillod par des pêcheurs qui les avaient été quérir et sauver. Or on rapportait qu’un des marmets, voyant le secours arriver, de joie en était devenu soudainement insensé et l’était demeuré le restant de ses jours.
Et moi aussi, je pensai perdre le sens à l’ouïe de l’offre charitable de M. Gauthier.
– Oh ! M. le curé, dis-je en me jetant à ses genoux, vous me sauvez la vie ! C’est le paradis après l’enfer ! et je riais et pleurais en lui baisant les mains.
Lui, me relevant de force et prenant une mine riante pour me cacher les larmes qui lui troublaient la vue :
– Ta, ta, ta, mon pauvre Claude, j’ai idée que le paradis de là-haut est plus beau et commode que mon vieux presbytère tout lézardé et qui s’en va croulant par les quatre côtés à la fois ! Puis il me poussa dans la cuisine, en ordonnant à la vieille Nannette, sa servante, de me donner à manger.
Pour dire toute la vérité, Nannette, qui avait une tête carrée qu’il fallait savoir prendre par le bon côté, me regarda de travers par-dessous sa coiffe blanche, comme si j’eusse été quelque chien sortant d’une mare d’eau sale et qui va secouer son poil dégouttant.
La figure de la vieille servante, ridée, jaunie comme une pomme de reinette au printemps, avait un air si renfrogné que j’en perdis le courage et restai sur le seuil, tête basse et le cœur tout gros. Ce n’est pas que je fusse pleurnicheur de mon naturel, mais ce jour-là m’avait si rudement secoué, que pour un rien les larmes m’emplissaient les yeux.
Il y a apparence que Nannette vit cela, car elle passa doucement sa main ridée sur mes cheveux ébouriffés et me fit seoir sur un escabeau.
Ah ! la bonne soupe aux oignons que je mangeai là ! l’odeur m’en revient encore au nez après trente ans bien comptés ! Mais peut-être après tout, ce qui la rendait si onctueuse et appétissante, c’était cette idée qui bourdonnait et chantait dans ma tête tout le temps que je mangeais : Présentement, toi aussi, Claude-Moïse, tu as une famille ! M. Gauthier te sera un père et tu lui seras fils respectueux jusqu’à la fin de ses jours ou des tiens ; il t’aimera sûrement et te permettra de l’aimer. Puis je considérais, le cœur tout attendri, la vieille Nannette, laquelle s’émerveillait de mon appétit, et, voyant clignoter ses petits yeux gris, je pensais : Elle aussi est bonne et te sera comme une mère.
En cela, je ne me méprenais point, ainsi qu’il paraîtra par la suite de ma...