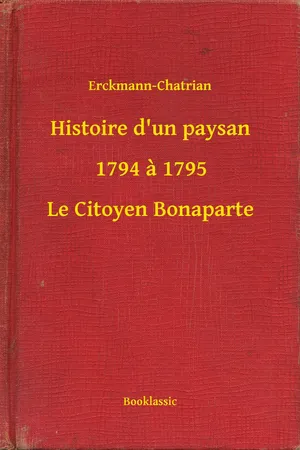Je vous ai raconté notre campagne de Vendée, ce que les Vendéens eux-mêmes appellent la grande guerre. Nous avions exterminé la mauvaise race sur les deux rives de la Loire, mais les trois quarts d’entre nous avaient laissé leurs os en route. Tout ce qu’on a vu depuis n’est rien auprès d’un acharnement pareil.
Le restant des Vendéens, après l’affaire de Savenay, s’était sauvé dans les marais de long de la côte, où le dernier de leurs chefs, le fameux Charette, tenait encore. Cette espèce de finaud ne voulait pas livrer de batailles rangées ; il pillait, autour de ses marais, les fermes et les villages, emmenant bœufs, vaches, foin, paille, tout ce qu’il pouvait happer ; les malheureux paysans, réduits à n’avoir ni feu, ni lieu, finissaient toujours par le rejoindre, et la guerre civile continuait.
La 18e demi-brigade et les autres troupes cantonnées aux environ de Nantes, d’Ancenis et d’Angers, fournissaient de forts détachements, pour tâcher d’entourer et de prendre ce chef de bandes ; mais à l’approche de nos colonnes il se retirait précipitamment, et d’aller le suivre à travers les saules, les joncs, les aunes et autres plantations touffues, où les Vendéens nous attendaient en embuscade, on pense bien que nous n’étions pas si bêtes : ils nous auraient tous détruits en détail.
Voilà notre existence aux mois de janvier et février 1794. Et maintenant je vais marcher plus vite ; je me fais vieux, j’ai encore plusieurs années à vous raconter jusqu’à la fin de notre république, et je ne veux rien oublier, surtout de ce que j’ai vu moi-même.
C’est dans une de nos expéditions contre Charette que je retombai malade. Il pleuvait tous les jours ; nous couchions dans l’eau ; les Vendéens coupaient souvent nos convois, nous manquions de tout ; mes crachements de sang, par la souffrance, les privations, les marches forcées, recommencèrent plus fort ; il fallut m’envoyer à Nantes, avec un convoi de blessés.
À Nantes, le médecin en chef ne me donna pas seulement quinze jours à vivre ; les blessés du combat de Colombin encombraient les salles, les escaliers, les corridors ; je demandai à retourner au pays.
– Tu veux revoir ton pays, mon garçon ? me dit le major en riant ; c’est bon, ton congé va bientôt venir !
Et huit ou dix jours après il m’apportait déjà mon congé définitif, comme hors de service ; un autre avait de la place dans mon lit.
Il s’est passé depuis des années et des années, le major qui m’avait condamné n’a plus mal aux dents, j’en suis sûr, et moi je suis toujours là ! Que cela serve de leçon aux malades et aux vieillards que les médecins condamnent ; ils vivront peut-être plus longtemps qu’eux ; je ne suis pas le seul qui puisse leur servir d’exemple.
Enfin, ayant mon congé dans ma poche, et cent livres en assignats, que Marguerite m’avait envoyés bien vite, en apprenant par mes lettres que j’étais malade à l’hôpital de Nantes, je ramassai mon courage et je pris le chemin du pays. C’était en mars, au temps de la plus grande terreur et de la plus effrayante famine. Il ne faut pas croire que le temps était mauvais ; au contraire, l’année se présentait bien, tout verdissait et fleurissait, les poiriers, les pruniers, les abricotiers étaient déjà blancs et roses avant la fin d’avril. On aurait béni l’Éternel, s’il avait été possible de rentrer la moitié des récoltes qu’on voyait en herbe ; mais elles étaient encore sous terre, il fallait attendre des semaines et des mois pour les avoir.
Je pourrais vous peindre tout le long de la Loire les villages abandonnés, les églises fermées, les files de prisonniers qu’on emmenait ; l’épouvante des gens qui n’osaient vous regarder ; les commissaires civils, avec leur écharpe et leurs hommes, le dénonciateur derrière, en train de faire la visite ; les gendarmes et même les citoyens qui vous demandaient votre feuille de route à chaque pas.
Les hébertistes, qui voulaient abolir l’Être suprême, venaient d’être guillotinés ; on cherchait de tous les côtés leurs complices, et naturellement plus d’un frémissait car on ne voulait plus d’ivrognes, plus de débauchés, plus d’êtres éhontés qui renient la justice et l’humanité ; on ne parlait plus que de Robespierre et du règne de la vertu.
Moi je me traînais d’étape en étape, tout pâle et maigre, comme un malheureux qui n’a plus que le souffle. Quelquefois les paysans que je rencontrais, tournant la tête, avaient l’air de se dire en eux-mêmes :
« Celui-là n’a pas besoin de s’inquiéter, il ne fera pas de vieux os ! »
Dans les environs d’Orléans, l’idée me vint d’aller voir Chauvel à Paris ; c’était une idée de malade qui se raccroche à toutes les branches. Je me figurais que les médecins de Paris en savaient plus que les barbiers, les vétérinaires et les arracheurs de dents qu’on avait envoyés dans nos bataillons en 92 ; et puis Paris c’était tout : c’est de là que partaient les décrets, les ordres aux armées, les gazettes et les grandes nouvelles ; je voulais voir Paris avant de mourir, et vers le commencement d’avril j’arrivai dans ses environs.
Quant à vous peindre comme Marguerite et Chauvel cette grande ville, ce mouvement au loin, ces faubourgs, ces barrières, ces courriers qui vont et viennent, ces grandes rues encombrées de monde, ces files de misérables en guenilles, enfin ce bourdonnement de cris, de voitures, qui monte et descend comme un orage, vous devez bien comprendre que je n’en suis pas capable ; d’autant plus que j’ai passé là dans un temps extraordinaire, seul, malade, sans savoir, au milieu de cette confusion, ce qu’il fallait regarder, ni même de quel côté je venais d’entrer et de quel côté j’allais sortir.
Tout ce qui me revient, c’est que je descendais une grande rue qui n’en finissait pas, et que cela dura plus d’une heure ; ceux auxquels je demandais la rue du Bouloi me répondaient tous :
– Toujours devant vous !
Je croyais perdre la tête.
Il pouvait être cinq heures et la nuit venait, lorsque, à la fin des fins, au bout de cette rue, en face d’un vieux pont couvert de grosses guérites en pierres de taille, je vis la Seine, de vieilles maisons à perte de vue penchées au bord, une grande église noire sans clocher par-dessus, et d’autres bâtisses innombrables. Le soleil se couchait justement, tous ces vieux toits étaient rouges. Comme je regardais cela, me demandant de quel côté tourner, quelque chose d’épouvantable passa devant moi, quelque chose d’horrible et qui me fait encore bouillonner mon vieux sang après tant d’années.
J’avais déjà passé le pont ; et voilà qu’au milieu d’une foule de canailles, – qui criaient, dansaient, roulaient les uns sur les autres, en levant leurs sales casquettes et leurs bâtons, – voilà qu’entre deux forts piquets de gendarmes à cheval, s’avancent lentement trois voitures pleines de condamnés. Dans la première de ces voitures, à longues échelles peintes en rouge, deux hommes se tenaient debout, en bras de chemise, la poitrine et le cou nus, les mains liées sur le dos. Tous les autres condamnés étaient assis sur des bancs à l’intérieur et regardaient devant eux d’un air d’abattement et les joues longues ; mais de ces deux-là, l’un, fort, large des épaules, la tête grosse, les yeux enfoncés et comme remplis de sang, riait en serrant ses lèvres, on aurait dit un lion entouré de misérables chiens qui gueulent et s’excitent pour tomber dessus ; il les regardait d’un air de mépris, ses grosses joues pendantes tremblaient de dégoût. L’autre plus grand, sec et pâle, voulait parler ; il bégayait en écumant, l’indignation le possédait.
Ces choses sont peintes devant moi ; je les verrai jusqu’à ma dernière heure.
Et pendant que les chevaux, les sabres, les échelles rouges et la race abominable s’éloignaient, piaffant, grinçant et criant : « À mort les corrompus !… À mort les traîtres !… Ça ira !… Dansons la carmagnole !… À toi, Camille !… À toi, Danton !… Ha ! ha ! ha !… Vive le règne de la vertu ! Vive Robespierre ! » pendant que cette espèce de mauvais rêve s’en allait à travers la foule innombrable, penchée aux fenêtres, aux balcons, rangée le long de la rivière, voilà que la deuxième voiture arrive, aussi pleine que la première, et plus loin la troisième. Je me souvins en même temps que Chauvel était l’ami de Danton, et je frémis en moi-même ; s’il avait été là, malgré tout j’aurais tiré mon sabre pour tomber sur la canaille et me faire tuer, mais je ne le vis pas ; je reconnus seulement notre général Westermann dans le nombre : le vainqueur de Châtillon, du Mans, de Savenay. Il s’y trouvait, lui, les mains attachées sur le dos, tout sombre et la tête penchée.
La même abomination de cris, de chants et d’éclats de rire suivait ces deux dernières voitures.
Ce n’est pas l’idée de la mort qui peut faire trembler de pareils hommes, mais la colère de voir l’ingratitude du peuple, qui les laisse insulter et traîner à la guillotine par des mouchards. Ces mouchards ont sali notre révolution ; ils se disaient sans-culottes et vivaient à leur aise dans la police, pendant que le peuple, ouvriers et paysans, souffrait toutes les misères ; ils restaient à Paris pour souffleter les victimes, pendant que nous autres, par centaines de mille, nous défendions la patrie et versions notre sang à la frontière.
Enfin je partis de là dans l’épouvante. Je voyais déjà notre république perdue, cette manière de se guillotiner les uns les autres ne pouvait pas durer longtemps ; ce n’est pas en coupant le cou aux gens qu’on prouve au peuple qu’ils avaient tort.
À quelques cents pas plus loin, je finis par trouver la maison où demeurait Chauvel. Il faisait nuit. J’entrai dans la petite allée sombre ; en bas, à gauche, demeurait un tailleur, au fond d’une niche que sa table remplissait tout entière. C’était un vieux, le nez rouge jusqu’aux oreilles. Je lui demandai le représentant du peuple Chauvel. Aussitôt cet homme, avec de grosses besicles, me regarda des pieds à la tête ; ensuite il décroisa ses jambes cagneuses et me dit :
– Attends, citoyen, je vais le chercher.
Il sortit, et cinq ou six minutes après, il revenait, amenant un gros homme court, le chapeau retroussé, une grosse cocarde devant, et l’écharpe tricolore autour du ventre. Deux ou trois sans-culottes le suivaient.
– Tenez, le voilà, dit le tailleur, c’est lui qui demande Chauvel.
L’autre, un commissaire civil sans doute, commença par me demander qui j’étais, d’où je venais. Je lui répondis que Chauvel le saurait bien.
– Au nom de la loi, me cria cet homme, je te demande tes papiers !… Vas-tu te dépêcher, oui ou non ?
Les sans-culottes alors entrèrent dans la niche. Je ne pouvais plus me remuer ; de tous les côtés dans la petite allée, j’entendais des gens marcher, descendre des escaliers, et je voyais cette espèce me regarder dans l’ombre avec des yeux de rats ; c’est pourquoi tout pâle de colère, je jetai ma feuille de route et mon congé sur la table. Le commissaire les prit et les mit dans sa poche en me disant :
– Arrive ! – Et vous autres, attention, qu’on ouvre l’œil !
Le tailleur paraissait content ; il croyait déjà tenir la prime de cinquante livres : j’aurais voulu l’étrangler.
Il fallut sortir. Cinquante pas plus loin, dans une grande salle carrée où des citoyens montaient la garde, on examina mes papiers.
Quant à vous dire toutes les questions que me fit le commissaire sur mon engagement, sur ma route, sur mon changement de direction et la manière dont j’avais connu Chauvel, c’est impossible depuis le temps. Cela dura plus d’une demi-heure. À la fin il reconnut pourtant que mes papiers étaient en règle et me dit, en posant dessus son cachet, que Chauvel était en mission à l’armée des Alpes. Alors la colère me prit ; je lui criai :
– Ne pouviez-vous pas me dire cela tout de suite ? tas de…
Mais je retins ma langue ; et le commissaire, me regardant d’un air de mépris, s’écria :
–Tout de suite ! Il fallait te dire cela tout de suite ! Ah ça ! dis donc, imbécile, est-ce que tu crois que la république raconte ses secrets au premier venu ? Est-ce que tu ne pouvais pas être un espion de Cobourg ou de Pitt ? Est-ce que tu portes ton certificat de civisme peint sur ta figure ?
Cet homme paraissait furieux ; s’il avait fait un signe aux sectionnaires, attentifs autour de nous, avec leurs piques, j’étais arrêté. J’eus assez de bon sens pour garder le silence ; et lui, vexé de n’avoir pas fait une bonne prise, me montra la porte en disant :
– Tu es libre ; mais tâche de ne pas être toujours aussi bête, ça te jouerait un mauvais tour.
Je sortis bien vite et je remontai la rue. Tous ces sans-culottes me regardaient encore de travers.
Durant les deux jours que je restai à Paris, le même spectacle me suivit : partout les gens ne voyaient que des suspects, le premier venu pouvait vous arrêter ; on passait sans oser se regarder les uns les autres. Et ce n’était pas sans cause : les trahisons avaient donné le branle ; la disette poussait les misérables à chercher de quoi vivre, ils dénonçaient les gens, pour avoir la prime ! Un mal avait amené l’autre ; nous étions en pleine terreur, et cette terreur épouvantable venait des Lafayette, des Dumouriez, de tous ceux qui, dans le temps, avaient livré nos places, essayé d’entraîner leurs armées contre la nation et porté les paysans à détruire la république. Les grands maux font les grands remèdes, il ne faut pas s’en étonner.
Une fois hors des griffes du commissaire, en remontant la vieille rue sombre, je finis par trouver une de ces auberges où les mendiants et les pauvres diables de mon espèce logeaient à quelques sous la nuit. C’est ce qu’il me fallait ; car avec mon vieux sac, mon vieux chapeau, mes pauvres habits de Vendée, tout usés, déchirés et rapiécés, on n’aurait pas voulu me recevoir ailleurs. J’entrai donc dans ce cabaret borgne, et la vieille qui se trouvait derrière le comptoir, au milieu d’un tas de sans-culottes qui buvaient, fumaient et jouaient aux cartes, cette vieille comprit tout de suite ce que je voulais. Elle me conduisit en haut de sa baraque, moyennant une corde qui servait de rampe ; il fallut payer d’avance, et puis m’étendre sur une paillasse, d’où les puces, les punaises et autres vermines me chassèrent bientôt. Je m’étendis alors sur le plancher, la tête sur mon sac, comme en plein champ ; et, malgré les mauvaises odeurs, les cris d’ivrognes, le passage des rondes en bas dans la rue ; malgré le manque d’air dans ce recoin, sous les tuiles, et les jurements abominables de ceux qui trébuchaient dans l’escalier, je dormis jusqu’au matin.
L’idée que Danton, Camille Desmoulins, Westermann et les meilleurs patriotes étaient morts ; que leurs têtes coupées reposaient l’une sur l’autre avec leurs corps, dans le sang, me réveilla bien deux ou trois fois ; mon cœur se serrait ; je bénissais le ciel de savoir Chauvel en mission à l’armée, et je me rendormais à force de fatigue.
Le lendemain d’assez bonne heure, je descendis ; j’aurais pu m’en aller tout de suite, ma dépense était payée, mais autant rester là, puisqu’on y mangeait à bon marché. Je m’assis donc tout seul, et je déjeunai tranquillement avec un morceau de pain, du fromage, un demi-litre de vin. Cela me coûta deux livres dix sous en assignats ; il me restait soixante-quinze livres.
Je voulais voir la Convention nationale avant de retourner au pays. Depuis trois mois que nous avions couru le Bocage et le Marais, nous ne connaissions plus les nouvelles ; les fédérés parisiens avaient presque tous péri ; eux seuls s’inquiétaient des grandes batailles de la Convention, des Jacobins et des Cordeliers ; après eux on n’avait plus songé qu’au service. La mort de Danton, de Camille Desmoulins et de tous ces patriotes qui les premiers avaient soutenu la république, me paraissait quelque chose de terrible ; il fallait donc que les royalistes eussent pris le dessus ! voilà les idées qui me passaient par la tête ; et sur les huit heures, ayant payé ce que je devais à la vieille, je laissai chez elle mon sac, en la prévenant que je reviendrais le prendre.
Tout ce que Marguerite m’avait écrit autrefois sur Paris, sur les cris des marchands, les files de malheureux à la porte des boulangeries, les disputes au marché pour s’arracher ce que les campagnards apportaient, je le vis alors, et c’était devenu pire. On chantait de nouvelles chansons ; on criait partout les journaux qui parlaient de la mort des corrompus.
Je me souviens avoir traversé d’abord une grande cour plantée de vieux arbres, – le palais du ci-devant duc d’Orléans, – et d’avoir vu beaucoup de gens assis dehors, en train de boire et de lire les gazettes ; ils riaient, ils se saluaient comme si rien ne s’était passé. Plus loin, sur l’enseigne d’une salle en plein air, qui me rappela celle que Chauvel avait établie chez nous pour la commodité des patriotes, ayant lu : « Cabinet de lecture », j’entrai hardiment et je m’assis parmi des quantités de citoyens, qui ne tournèrent pas même la tête ; là je lus le Moniteur tout entier, et d’autres gazettes racontant le procès des dantonistes, ce qui ne me coûta que deux sous.
Le Comité de salut public avait fait arrêter les dantonistes, soi-disant pour avoir conspiré contre le peuple français, en voulant rétab...