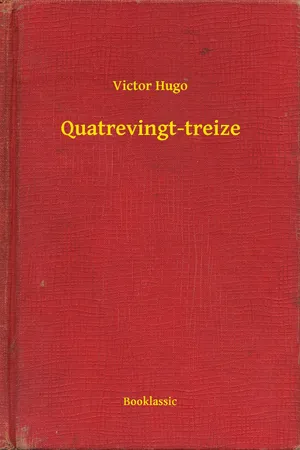Dans les derniers jours de mai 1793, un des bataillons parisiens amenés en Bretagne par Santerre fouillait le redoutable bois de la Saudraie en Astillé. On n’était pas plus de trois cents, car le bataillon était décimé par cette rude guerre. C’était l’époque où, après l’Argonne, Jemmapes et Valmy, du premier bataillon de Paris, qui était de six cents volontaires, il restait vingt-sept hommes, du deuxième trente-trois, et du troisième cinquante-sept. Temps des luttes épiques.
Les bataillons envoyés de Paris en Vendée comptaient neuf cent douze hommes. Chaque bataillon avait trois pièces de canon. Ils avaient été rapidement mis sur pied. Le 25 avril, Gohier étant ministre de la justice et Bouchotte étant ministre de la guerre, la section du Bon-Conseil avait proposé d’envoyer des bataillons de volontaires en Vendée ; le membre de la commune Lubin avait fait le rapport ; le 1er mai, Santerre était prêt à faire partir douze mille soldats, trente pièces de campagne et un bataillon de canonniers. Ces bataillons, faits si vite, furent si bien faits, qu’ils servent aujourd’hui de modèles ; c’est d’après leur mode de composition qu’on forme les compagnies de ligne ; ils ont changé l’ancienne proportion entre le nombre des soldats et le nombre des sous-officiers.
Le 28 avril, la commune de Paris avait donné aux volontaires de Santerre cette consigne : Point de grâce, point de quartier. À la fin de mai, sur les douze mille partis de Paris, huit mille étaient morts.
Le bataillon engagé dans le bois de la Saudraie se tenait sur ses gardes. On ne se hâtait point. On regardait à la fois à droite et à gauche, devant soi et derrière soi ; Kléber a dit : Le soldat a un œil dans le dos. Il y avait longtemps qu’on marchait. Quelle heure pouvait-il être ? à quel moment du jour en était-on ? Il eût été difficile de le dire, car il y a toujours une sorte de soir dans de si sauvages halliers, et il ne fait jamais clair dans ce bois-là.
Le bois de la Saudraie était tragique. C’était dans ce taillis que, dès le mois de novembre 1792, la guerre civile avait commencé ses crimes ; Mousqueton, le boiteux féroce, était sorti de ces épaisseurs funestes ; la quantité de meurtres qui s’étaient commis là faisait dresser les cheveux. Pas de lieu plus épouvantable. Les soldats s’y enfonçaient avec précaution. Tout était plein de fleurs ; on avait autour de soi une tremblante muraille de branches d’où tombait la charmante fraîcheur des feuilles ; des rayons de soleil trouaient çà et là ces ténèbres vertes ; à terre, le glaïeul, la flambe des marais, le narcisse des prés, la gênotte, cette petite fleur qui annonce le beau temps, le safran printanier, brodaient et passementaient un profond tapis de végétation où fourmillaient toutes les formes de la mousse, depuis celle qui ressemble à la chenille jusqu’à celle qui ressemble à l’étoile. Les soldats avançaient pas à pas, en silence, en écartant doucement les broussailles. Les oiseaux gazouillaient au-dessus des bayonnettes.
La Saudraie était un de ces halliers où jadis, dans les temps paisibles, on avait fait la Houiche-ba, qui est la chasse aux oiseaux pendant la nuit ; maintenant on y faisait la chasse aux hommes.
Le taillis était tout de bouleaux, de hêtres et de chênes ; le sol plat ; la mousse et l’herbe épaisse amortissaient le bruit des hommes en marche ; aucun sentier, ou des sentiers tout de suite perdus ; des houx, des prunelliers sauvages, des fougères, des haies d’arrête-bœufs, de hautes ronces ; impossibilité de voir un homme à dix pas.
Par instants passait dans le branchage un héron ou une poule d’eau indiquant le voisinage des marais.
On marchait. On allait à l’aventure, avec inquiétude et en craignant de trouver ce qu’on cherchait.
De temps en temps on rencontrait des traces de campements, des places brûlées, des herbes foulées, des bâtons en croix, des branches sanglantes. Là on avait fait la soupe, là on avait dit la messe, là on avait pansé des blessés. Mais ceux qui avaient passé avaient disparu. Où étaient-ils ? bien loin peut-être. Peut-être là tout près, cachés, l’espingole au poing. Le bois semblait désert. Le bataillon redoublait de prudence. Solitude, donc défiance. On ne voyait personne ; raison de plus pour redouter quelqu’un. On avait affaire à une forêt mal famée.
Une embuscade était probable.
Trente grenadiers, détachés en éclaireurs et commandés par un sergent, marchaient en avant à une assez grande distance du gros de la troupe. La vivandière du bataillon les accompagnait. Les vivandières se joignent volontiers aux avant-gardes. On court des dangers, mais on va voir quelque chose. La curiosité est une des formes de la bravoure féminine.
Tout à coup les soldats de cette petite troupe d’avant-garde eurent ce tressaillement connu des chasseurs qui indique qu’on touche au gîte. On avait entendu comme un souffle au centre d’un fourré, et il semblait qu’on venait de voir un mouvement dans les feuilles. Les soldats se firent signe.
Dans l’espèce de guet et de quête confiée aux éclaireurs, les officiers n’ont pas besoin de s’en mêler ; ce qui doit être fait se fait de soi-même.
En moins d’une minute le point où l’on avait remué fut cerné ; un cercle de fusils braqués l’entoura ; le centre obscur du hallier fut couché en joue de tous les côtés à la fois, et les soldats, le doigt sur la détente, l’œil sur le lieu suspect, n’attendirent plus pour le mitrailler que le commandement du sergent.
Cependant la vivandière s’était hasardée à regarder à travers les broussailles, et au moment où le sergent allait crier : Feu ! cette femme cria : Halte !
Et se tournant vers les soldats : – Ne tirez pas, camarades !
Et elle se précipita dans le taillis. On l’y suivit.
Il y avait quelqu’un là en effet.
Au plus épais du fourré, au bord d’une de ces petites clairières rondes que font dans les bois les fourneaux à charbon en brûlant les racines des arbres, dans une sorte de trou de branches, espèce de chambre de feuillage, entrouverte comme une alcôve, une femme était assise sur la mousse, ayant au sein un enfant qui tétait et sur ses genoux les deux têtes blondes de deux enfants endormis.
C’était là l’embuscade.
– Qu’est-ce que vous faites ici, vous ? cria la vivandière.
La femme leva la tête.
La vivandière ajouta furieuse :
– Êtes-vous folle d’être là !
Et elle reprit :
– Un peu plus, vous étiez exterminée !
Et, s’adressant aux soldats, la vivandière ajouta :
– C’est une femme.
– Pardine, nous le voyons bien ! dit un grenadier.
La vivandière poursuivit :
– Venir dans les bois se faire massacrer ! a-t-on idée de faire des bêtises comme çà !
La femme stupéfaite, effarée, pétrifiée, regardait autour d’elle, comme à travers un rêve, ces fusils, ces sabres, ces bayonnettes, ces faces farouches.
Les deux enfants s’éveillèrent et crièrent.
– J’ai faim, dit l’un.
– J’ai peur, dit l’autre.
Le petit continuait de téter.
La vivandière lui adressa la parole.
– C’est toi qui as raison, lui dit-elle. La mère était muette d’effroi.
Le sergent lui cria :
– N’ayez pas peur, nous sommes le bataillon du Bonnet-Rouge.
La femme trembla de la tête aux pieds. Elle regarda le sergent, rude visage dont on ne voyait que les sourcils, les moustaches et deux braises qui étaient les deux yeux.
– Le bataillon de la ci-devant Croix-Rouge, ajouta la vivandière.
Et le sergent continua :
– Qui es-tu, madame ?
La femme le considérait, terrifiée. Elle était maigre, jeune, pâle, en haillons ; elle avait le gros capuchon des paysannes bretonnes et la couverture de laine rattachée au cou avec une ficelle. Elle laissait voir son sein nu avec une indifférence de femelle. Ses pieds, sans bas ni souliers, saignaient.
– C’est une pauvre, dit le sergent.
Et la vivandière reprit de sa voix soldatesque et féminine, douce en dessous :
– Comment vous appelez-vous ?
La femme murmura dans un bégaiement presque indistinct :
– Michelle Fléchard.
Cependant la vivandière caressait avec sa grosse main la petite tête du nourrisson.
– Quel âge a ce môme ? demanda-t-elle.
La mère ne comprit pas. La vivandière insista.
– Je vous demande l’âge de çà.
– Ah ! dit la mère, dix-huit mois.
– C’est vieux, dit la vivandière. Ça ne doit plus téter. Il faudra me sevrer çà. Nous lui donnerons de la soupe.
La mère commençait à se rassurer. Les deux petits qui s’étaient réveillés étaient plus curieux qu’effrayés. Ils admiraient les plumets.
– Ah ! dit la mère, ils ont bien faim.
Et elle ajouta :
– Je n’ai plus de lait.
– On leur donnera à manger, cria le sergent, et à toi aussi. Mais ce n’est pas tout çà. Quelles sont tes opinions politiques ?
La femme regarda le sergent et ne répondit pas.
– Entends-tu ma question ?
Elle balbutia :
– J’ai été mise au couvent toute jeune, mais je me suis mariée, je ne suis pas religieuse. Les sœurs m’ont appris à parler français. On a mis le feu au village. Nous nous sommes sauvés si vite que je n’ai pas eu le temps de mettre des souliers.
– Je te demande quelles sont tes opinions politiques ?
– Je ne sais pas ça.
Le sergent poursuivit :
– C’est qu’il y a des espionnes. Ça se fusille, les espionnes. Voyons. Parle. Tu n’es pas bohémienne ? Quelle est ta patrie ?
Elle continua de le regarder comme ne comprenant pas. Le sergent répéta :
– Quelle est ta patrie ?
– Je ne sais pas, dit-elle.
– Comment, tu ne sais pas quel est ton pays ?
– Ah ! mon pays. Si fait.
– Eh bien, quel est ton pays ? La femme répondit :
– C’est la métairie de Siscoignard, dans la paroisse d’Azé.
Ce fut le tour du sergent d’être stupéfait. Il demeura un moment pensif, puis il reprit :
– Tu dis ?
– Siscoignard.
– Ce n’est pas une patrie, ça.
– C’est mon pays.
Et la femme, après un instant de réflexion, ajouta :
– Je comprends, monsieur. Vous êtes de France, moi je suis de Bretagne.
– Eh bien ?
– Ce n’est pas le même pays.
– Mais c’est la même patrie ! cria le sergent.
La femme se borna à répondre :
– Je suis de Siscoignard.
– Va pour Siscoignard, repartit le sergent. C’est de là qu’est ta famille ?
– Oui.
– Que fait-elle ?
– Elle est toute morte. Je n’ai plus personne.
Le sergent, qui était un peu beau parleur, continua l’interrogatoire.
– On a des parents, que diable ! ou on en a eu. Qui es-tu ? Parle.
La femme écouta, ahurie, cet – ou on en a eu – qui ressemblait plus à un cri de bête qu’à une parole humaine.
La vivandière sentit le besoin d’intervenir. Elle se remit à caresser l’enfant qui tétait, et donna une tape sur la joue aux deux autres.
– Comment s’appelle la téteuse ? demanda-t-elle ; car c’est une fille, ça.
La mère répondit : Georgette.
– Et l’aîné ? car c’est un homme, ce polisson-là.
– René-Jean.
– Et le cadet ? car lui aussi, il est un homme, et joufflu encore !
– Gros-Alain, dit la mère.
– Ils sont gentils, ces petits, dit la vivandière ; çà vous a déjà des airs d’ê...