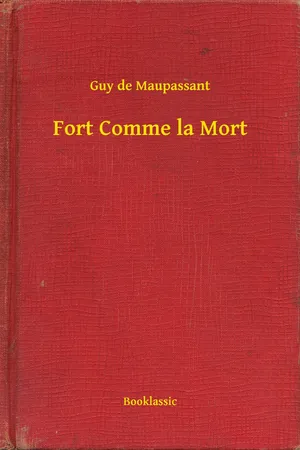Le jour tombait dans le vaste atelier par la baie ouverte du plafond. C’était un grand carré de lumière éclatante et bleue, un trou clair sur un infini lointain d’azur, où passaient, rapides, des vols d’oiseaux.
Mais à peine entrée dans la haute pièce sévère et drapée, la clarté joyeuse du ciel s’atténuait, devenait douce, s’endormait sur les étoffes, allait mourir dans les portières, éclairait à peine les coins sombres où, seuls, les cadres d’or s’allumaient comme des feux. La paix et le sommeil semblaient emprisonnés là-dedans, la paix des maisons d’artistes où l’âme humaine a travaillé. En ces murs que la pensée habite, où la pensée s’agite, s’épuise en des efforts violents, il semble que tout soit las, accablé, dès qu’elle s’apaise. Tout semble mort après ces crises de vie ; et tout repose, les meubles, les étoffes, les grands personnages inachevés sur les toiles, comme si le logis entier avait souffert de la fatigue du maître, avait peiné avec lui, prenant part, tous les jours, à sa lutte recommencée. Une vague odeur engourdissante de peinture, de térébenthine et de tabac flottait, captée par les tapis et les sièges ; et aucun autre bruit ne troublait le lourd silence que les cris vifs et courts des hirondelles qui passaient sur le châssis ouvert, et la longue rumeur confuse de Paris à peine entendue pardessus les toits. Rien ne remuait que la montée intermittente d’un petit nuage de fumée bleue s’élevant vers le plafond à chaque bouffée de cigarette qu’Olivier Bertin, allongé sur son divan, soufflait lentement entre ses lèvres.
Le regard perdu dans le ciel lointain, il cherchait le sujet d’un nouveau tableau. Qu’allait-il faire ? Il n’en savait rien encore. Ce n’était point d’ailleurs un artiste résolu et sûr de lui, mais un inquiet dont l’inspiration indécise hésitait sans cesse entre toutes les manifestations de l’art. Riche, illustre, ayant conquis tous les honneurs, il demeurait, vers la fin de sa vie, l’homme qui ne sait pas encore au juste vers quel idéal il a marché. Il avait été prix de Rome, défenseur des traditions, évocateur, après tant d’autres, des grandes scènes de l’histoire ; puis, modernisant ses tendances, il avait peint des hommes vivants avec des souvenirs classiques. Intelligent, enthousiaste, travailleur tenace au rêve changeant, épris de son art qu’il connaissait à merveille, il avait acquis, grâce à la finesse de son esprit, des qualités d’exécution remarquables et une grande souplesse de talent née en partie de ses hésitations et de ses tentatives dans tous les genres. Peut-être aussi l’engouement brusque du monde pour ses œuvres élégantes, distinguées et correctes, avait-il influencé sa nature en l’empêchant d’être ce qu’il serait normalement devenu. Depuis le triomphe du début, le désir de plaire toujours le troublait sans qu’il s’en rendît compte, modifiait secrètement sa voie, atténuait ses convictions. Ce désir de plaire, d’ailleurs, apparaissait chez lui sous toutes les formes et avait contribué beaucoup à sa gloire.
L’aménité de ses manières, toutes les habitudes de sa vie, le soin qu’il prenait de sa personne, son ancienne réputation de force et d’adresse, d’homme d’épée et de cheval, avaient fait un cortège de petites notoriétés à sa célébrité croissante. Après Cléopâtre, la première toile qui l’illustra jadis, Paris brusquement s’était épris de lui, l’avait adopté, fêté, et il était devenu soudain un de ces brillants artistes mondains qu’on rencontre au bois, que les salons se disputent, que l’Institut accueille dès leur jeunesse. Il y était entré en conquérant avec l’approbation de la ville entière.
La fortune l’avait conduit ainsi jusqu’aux approches de la vieillesse, en le choyant et le caressant.
Donc, sous l’influence de la belle journée qu’il sentait épanouie au-dehors, il cherchait un sujet poétique. Un peu engourdi d’ailleurs par sa cigarette et son déjeuner, il rêvassait, le regard en l’air, esquissant dans l’azur des figures rapides, des femmes gracieuses dans une allée du bois ou sur le trottoir d’une rue, des amoureux au bord de l’eau, toutes les fantaisies galantes où se complaisait sa pensée. Les images changeantes se dessinaient au ciel, vagues et mobiles dans l’hallucination colorée de son œil ; et les hirondelles qui rayaient l’espace d’un vol incessant de flèches lancées semblaient vouloir les effacer en les biffant comme des traits de plume.
Il ne trouvait rien ! Toutes les figures entrevues ressemblaient à quelque chose qu’il avait fait déjà, toutes les femmes apparues étaient les filles ou les sœurs de celles qu’avait enfantées son caprice d’artiste ; et la crainte encore confuse, dont il était obsédé depuis un an, d’être vidé, d’avoir fait le tour de ses sujets, d’avoir tari son inspiration, se précisait devant cette revue de son œuvre, devant cette impuissance à rêver du nouveau, à découvrir de l’inconnu.
Il se leva mollement pour chercher dans ses cartons parmi ses projets délaissés s’il ne trouverait point quelque chose qui éveillerait une idée en lui.
Tout en soufflant sa fumée, il se mit à feuilleter les esquisses, les croquis, les dessins qu’il gardait enfermés en une grande armoire ancienne ; puis, vite dégoûté de ces vaines recherches, l’esprit meurtri par une courbature, il rejeta sa cigarette, siffla un air qui courait les rues et, se baissant, ramassa sous une chaise un pesant haltère qui traînait.
Ayant relevé de l’autre main une draperie voilant la glace qui lui servait à contrôler la justesse des poses, à vérifier les perspectives, à mettre à l’épreuve la vérité, et s’étant placé juste en face, il jongla en se regardant.
Il avait été célèbre dans les ateliers pour sa force, puis dans le monde pour sa beauté. L’âge, maintenant, pesait sur lui, l’alourdissait. Grand, les épaules larges, la poitrine pleine, il avait pris du ventre comme un ancien lutteur, bien qu’il continuât à faire des armes tous les jours et à monter à cheval avec assiduité. La tête était restée remarquable, aussi belle qu’autrefois, bien que différente. Les cheveux blancs, drus et courts, avivaient son œil noir sous d’épais sourcils gris. Sa moustache forte, une moustache de vieux soldat, était demeurée presque brune et donnait à sa figure un rare caractère d’énergie et de fierté.
Debout devant la glace, les talons unis, le corps droit, il faisait décrire aux deux boules de fonte tous les mouvements ordonnés, au bout de son bras musculeux, dont il suivait d’un regard complaisant l’effort tranquille et puissant.
Mais soudain, au fond du miroir où se reflétait l’atelier tout entier, il vit remuer une portière, puis une tête de femme parut, rien qu’une tête qui regardait. Une voix, derrière lui, demanda :
« On est ici ? »
Il répondit : « Présent » en se retournant. Puis jetant son haltère sur le tapis, il courut vers la porte avec une souplesse un peu forcée.
Une femme entrait, en toilette claire. Quand ils se furent serré la main :
« Vous vous exerciez, dit-elle.
– Oui, dit-il, je faisais le paon, et je me suis laissé surprendre. »
Elle rit et reprit :
« La loge de votre concierge était vide et, comme je vous sais toujours seul à cette heure-ci, je suis entrée sans me faire annoncer. »
Il la regardait.
« Bigre ! comme vous êtes belle. Quel chic !
– Oui, j’ai une robe neuve. La trouvez-vous jolie ?
– Charmante, d’une grande harmonie. Ah ! on peut dire qu’aujourd’hui on a le sentiment des nuances. »
Il tournait autour d’elle, tapotait l’étoffe, modifiait du bout des doigts l’ordonnance des plis, en homme qui sait la toilette comme un couturier, ayant employé, durant toute sa vie, sa pensée d’artiste et ses muscles d’athlète à raconter, avec la barbe mince des pinceaux, les modes changeantes et délicates, à révéler la grâce féminine enfermée et captive en des armures de velours et de soie ou sous la neige des dentelles.
Il finit par déclarer :
« C’est très réussi. Ça vous va très bien. »
Elle se laissait admirer, contente d’être jolie et de lui plaire.
Plus toute jeune, mais encore belle, pas très grande un peu forte, mais fraîche avec cet éclat qui donne à là chair de quarante ans une saveur de maturité, elle avait l’air d’une de ces roses qui s’épanouissent indéfiniment jusqu’à ce que, trop fleuries, elles tombent en une heure.
Elle gardait sous ses cheveux blonds la grâce alerte et jeune de ces Parisiennes qui ne vieillissent pas, qui portent en elles une force surprenante de vie, une provision inépuisable de résistance, et qui, pendant vingt ans, restent pareilles, indestructibles et triomphantes, soigneuses avant tout de leur corps et économes de leur santé.
Elle leva son voile et murmura :
« Eh bien, on ne m’embrasse pas ?
– J’ai fumé », dit-il.
Elle fit : « Pouah. » Puis, tendant ses lèvres : « Tant pis. »
Et leurs bouches se rencontrèrent.
Il enleva son ombrelle et la dévêtit de sa jaquette printanière, avec des mouvements prompts et sûrs, habitués à cette manœuvre familière. Comme elle s’asseyait ensuite sur le divan, il demanda avec intérêt :
« Votre mari va bien ?
– Très bien, il doit même parler à la Chambre en ce moment.
– Ah ! Sur quoi donc ?
– Sans doute sur les betteraves ou les huiles de colza, comme toujours. »
Son mari, le comte de Guilleroy, député de l’Eure, s’était fait une spécialité de toutes les questions agricoles.
Mais ayant aperçu dans un coin une esquisse qu’elle ne connaissait pas, elle traversa l’atelier, en demandant :
« Qu’est-ce que cela ?
– Un pastel que je commence, le portrait de la princesse de Pontève.
– Vous savez, dit-elle gravement, que si vous vous remettez à faire des portraits de femme, je fermerai votre atelier. Je sais trop où ça mène, ce travail-là.
– Oh ! dit-il, on ne fait pas deux fois un portrait d’Any.
– Je l’espère bien. »
Elle examinait le pastel commencé en femme qui sait les questions d’art. Elle s’éloigna, se rapprocha, fit un abat-jour de sa main, chercha la place d’où l’esquisse était le mieux en lumière, puis elle se déclara satisfaite.
« Il est fort bon. Vous réussissez très bien le pastel. »
Il murmura, flatté :
« Vous trouvez ?
– Oui, c’est un art délicat où il faut beaucoup de distinction. Ça n’est pas fait pour les maçons de la peinture.
Depuis douze ans elle accentuait son penchant vers l’art distingué, combattait ses retours vers la simple réalité, et par des considérations d’élégance mondaine, elle le poussait tendrement vers un idéal de grâce un peu maniéré et factice.
Elle demanda :
« Comment est-elle, la princesse ? »
Il dut lui donner mille détails de toute sorte, ces détails minutieux où se complaît la curiosité jalouse et subtile des femmes, en passant des remarques sur la toilette aux considérations sur l’esprit.
Et soudain :
« Est-elle coquette avec vous ? »
Il rit et jura que non.
Alors, posant ses deux mains sur les épaules du peintre, elle le regarda fixement. L’ardeur de l’interrogation faisait frémir la pupille ronde au milieu de l’iris bleu taché d’imperceptibles points noirs comme des éclaboussures d’encre.
Elle murmura de nouveau :
« Bien vrai, elle n’est pas coquette ?
– Oh ! bien vrai. »
Elle ajouta :
« Je suis tranquille d’ailleurs. Vous n’aimerez plus que moi maintenant. C’est fini, fini pour d’autres. Il est trop tard, mon pauvre ami. »
Il fut effleuré par ce léger frisson pénible qui frôle le cœur des hommes mûrs quand on leur parle de leur âge, et il murmura :
« Aujourd’hui, demain, comme hier, il n’y a eu et il n’y aura que vous en ma vie, Any. »
Elle lui prit alors le bras, et retournant vers le divan, le fit asseoir à côté d’elle.
« À quoi pensiez-vous ?
– Je cherche un sujet de tableau.
– Quoi donc ?
– Je ne sais pas, puisque je cherche.
– Qu’avez-vous fait ces jours-ci ? »
Il dut lui raconter toutes les visites qu’il avait reçues, les dîners et les soirées, les conversations et les potins. Ils s’intéressaient l’un et l’autre d’ailleurs à toutes ces choses futiles et familières de l’existence mondaine. Les petites rivalités, les liaisons connues ou soupçonnées, les jugements tout faits, mille fois redits, mille fois entendus, sur les mêmes personnes, les mêmes événements et les mêmes opinions, emportaient et noyaient leurs esprits dans ce fleuve trouble et agité qu’on appelle la vie parisienne. Connaissant tout le monde, dans tous les mondes, lui comme artiste devant qui toutes les portes s’étaient ouvertes, elle comme femme élégante d’un député conservateur, ils étaient exercés à ce sport de la causerie française fine, banale, aimablement malveillante, inutilement spirituelle, vulgairement distinguée qui donne une réputation particulière et très enviée à ceux dont la langue s’est assouplie à ce bavardage médisant.
« Quand venez-vous dîner ? demanda-t-elle tout à coup.
– Quand vous voudrez. Dites votre jour.
– Vendredi. J’aurai la duchesse de Mortemain, les Corbelle et Musadieu, pour fêter le retour de ma fillette qui arrive ce soir. Mais ne le dites pas. C’est un secret.
– Oh ! mais oui, j’accepte. Je serai ravi de retrouver Annette. Je ne l’ai pas vue depuis trois ans.
– C’est vrai ! Depuis trois ans ! »
Élevée d’abord à Paris chez ses parents, Annette était devenue l’affection dernière et passionnée de sa grand-mère, Mme Paradin, qui, presque aveugle, demeurait toute l’année dans la propriété de son gendre, au château de Roncières, dans l’Eure. Peu à peu, la vieille femme avait gardé de plus en plus l’enfant près d’elle et, comme les Guilleroy passaient presque la moitié de leur vie en ce domaine où les appelaient sans cesse des intérêts de toute sorte, agricoles et électoraux, on avait fini par ne plus amener à Paris que de temps en temps la fillette, qui préférait d’ailleurs la vie libre et remuante de la campagne à la vie cloîtrée de la ville.
Depuis trois ans elle n’y était même pas venue une seule fois, la comtesse préférant l’en tenir tout à fait éloignée, afin de ne point éveiller en elle un goût nouveau avant le jour fixé pour son entrée dans le monde. Mme de Guilleroy lui avait donné là-bas deux institutrices fort diplômées, et elle multipliait ses voyages auprès de sa mère et de sa fille. Le séjour d’Annette au château était d’ailleurs rendu presque nécessaire par la présence de la vieille femme.
Autrefois, Olivier Bertin allait chaque été passer six semaines ou deux mois à Roncières ; mais depuis trois ans des rhumatismes l’avaient entraîné en des villes d’eaux lointaines qui avaient tellement ravivé son amour de Paris, qu’il ne le pouvait plus quitter en y rentrant.
La jeune fille, en principe, n’aurait dû revenir qu’à l’automne, mais son père avait brusquement conçu un projet de mariage pour elle, et il la rappelait afin qu’elle rencontrât immédiatement celui qu’il lui destinait comme fiancé, le marquis de Farandal. Cette combinaison, d’ailleurs, était tenue très secrète, et seul Olivier Bertin en avait reçu la confidence de Mme de Guilleroy.
Donc il demanda :
« Alors, l’idée de votre mari est bien arrêtée ?
– Oui, je la crois même très heureuse. »
Puis ils parlèrent d’autres choses.
Elle revint à la peinture et voulut le décider à faire un Christ. Il résistait, j...