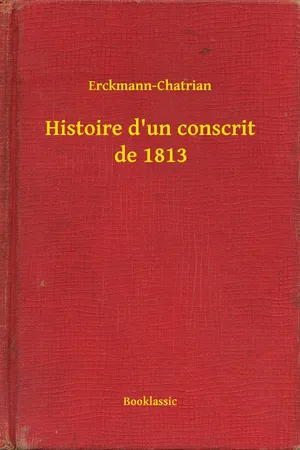Ceux qui n’ont pas vu la gloire de l’Empereur
Napoléon dans les années 1810,1811 et 1812 ne sauront jamais à quel
degré de puissance peut monter un homme.
Quand il traversait la Champagne, la Lorraine
ou l’Alsace, les gens, au milieu de la moisson ou des vendanges,
abandonnaient tout pour courir à sa rencontre ; il en arrivait
de huit et dix lieues ; les femmes, les enfants, les
vieillards se précipitaient sur sa route en levant les mains, et
criant : Vive l’Empereur ! vive
l’Empereur ! On aurait cru que c’était Dieu ; qu’il
faisait respirer le monde, et que si par malheur il mourait, tout
serait fini. Quelques anciens de la République qui hochaient la
tête et se permettaient de dire, entre deux vins, que l’Empereur
pouvait tomber, passaient pour des fous. Cela paraissait contre
nature, et même on n’y pensait jamais.
Moi, j’étais en apprentissage, depuis 1804,
chez le vieil horloger Melchior Goulden, à Phalsbourg. Comme je
paraissais faible et que je boitais un peu, ma mère avait voulu me
faire apprendre un métier plus doux que ceux de notre
village ; car, au Dagsberg, on ne trouve que des bûcherons,
des charbonniers et des schlitteurs. M. Goulden m’aimait bien.
Nous demeurions au premier étage de la grande maison qui fait le
coin en face du Bœuf-Rouge, près de la porte de France.
C’est là qu’il fallait voir arriver des
princes, des ambassadeurs et des généraux, les uns à cheval, les
autres en calèche, les autres en berline, avec des habits galonnés,
des plumets, des fourrures et des décorations de tous les pays. Et
sur la grande route, il fallait voir passer les courriers, les
estafettes, les convois de poudre, de boulets, les canons, les
caissons, la cavalerie et l’infanterie ! Quel temps !
quel mouvement !
En cinq ou six ans, l’hôtelier Georges fit
fortune ; il eut des prés, des vergers, des maisons et des
écus en abondance, car tous ces gens arrivant d’Allemagne, de
Suisse, de Russie, de Pologne ou d’ailleurs ne regardaient pas à
quelques poignées d’or répandues sur les grands chemins ;
c’étaient tous des nobles, qui se faisaient gloire en quelque sorte
de ne rien ménager.
Du matin au soir, et même pendant la nuit,
l’hôtel du Bœuf-Rouge tenait table ouverte. Le long des hautes
fenêtres en bas, on ne voyait que les grandes nappes blanches,
étincelantes d’argenterie et couvertes de gibier, de poisson et
d’autres mets rares, autour desquels ces voyageurs venaient
s’asseoir côte à côte. On n’entendait dans la grande cour derrière
que les hennissements des chevaux, les cris des postillons, les
éclats de rire des servantes, le roulement des voitures, arrivant
ou partant, sous les hautes portes cochères. Ah ! l’hôtel du
Bœuf-Rouge n’aura jamais un temps de prospérité pareille !
On voyait aussi descendre là des gens de la
ville, qu’on avait connus dans le temps pour chercher du bois sec à
la forêt, ou ramasser le fumier des chevaux sur les grandes routes.
Ils étaient passés commandants, colonels, généraux, un sur mille, à
force de batailler dans tous les pays du monde.
Le vieux Melchior, son bonnet de soie noire
tiré sur ses larges oreilles poilues, les paupières flasques, le
nez pincé dans ses grandes besicles de corne et les lèvres serrées,
ne pouvait s’empêcher de déposer sur l’établi sa loupe et son
poinçon et de jeter quelquefois un regard vers l’auberge, surtout
quand les grands coups de fouet des postillons à lourdes bottes,
petite veste et perruque de chanvre tortillée sur la nuque,
retentissaient dans les échos des remparts, annonçant quelque
nouveau personnage. Alors, il devenait attentif, et de temps en
temps je l’entendais s’écrier :
« Tiens ! c’est le fils du couvreur
Jacob, de la vieille ravaudeuse Marie-Anne ou du tonnelier Franz
Sépel ! Il a fait son chemin… le voilà colonel et baron de
l’Empire par-dessus le marché ! Pourquoi donc est-ce qu’il ne
descend pas chez son père, qui demeure là-bas dans la rue des
Capucins ? »
Mais lorsqu’il les voyait prendre le chemin de
la rue, en donnant des poignées de main à droite et à gauche aux
gens qui les reconnaissaient, sa figure changeait ; il
s’essuyait les yeux avec son gros mouchoir à carreaux, en
murmurant :
« C’est la pauvre vieille Annette qui va
avoir du plaisir ! À la bonne heure, à la bonne heure !
il n’est pas fier celui-là, c’est un brave homme ; pourvu
qu’un boulet ne l’enlève pas de sitôt ! »
Les uns passaient comme honteux de reconnaître
leur nid, les autres traversaient fièrement la ville, pour aller
voir leur sœur ou leur cousine. Ceux-ci, tout le monde en parlait,
on aurait dit que tout Phalsbourg portait leurs croix et leurs
épaulettes ; les autres, on les méprisait autant et même plus
que lorsqu’ils balayaient la grande route.
On chantait presque tous les mois des Te
Deum pour quelque nouvelle victoire, et le canon de l’arsenal
tirait ses vingt et un coups, qui vous faisaient trembler le cœur.
Dans les huit jours qui suivaient, toutes les familles étaient dans
l’inquiétude, les pauvres vieilles femmes surtout attendaient une
lettre ; la première qui venait, toute la ville le
savait : « Une telle a reçu des nouvelles de Jacques ou
de Claude ! » et tous couraient pour savoir s’il ne
disait rien de leur Joseph ou de leur Jean-Baptiste. Je ne parle
pas des promotions, ni des actes de décès ; les promotions,
chacun y croyait, il fallait bien remplacer les morts ; mais
pour les actes de décès, les parents attendaient en pleurant, car
ils n’arrivaient pas tout de suite ; quelquefois même ils
n’arrivaient jamais, et les pauvres vieux espéraient toujours,
pensant : « Peut-être que notre garçon est prisonnier…
Quand la paix sera faite, il reviendra… Combien sont revenus, qu’on
croyait morts ! »Seulement la paix ne se faisait
jamais ; une guerre finie, on en commençait une autre. Il nous
manquait toujours quelque chose, soit du côté de la Russie, soit du
côté de l’Espagne ou ailleurs ; – l’Empereur n’était jamais
content.
Souvent, au passage des régiments qui
traversaient la ville – la grande capote retroussée sur les
hanches, le sac au dos, les hautes guêtres montant jusqu’aux genoux
et le fusil à volonté, allongeant le pas, tantôt couverts de boue,
tantôt blancs de poussière –, souvent le père Melchior, après avoir
regardé ce défilé, me demandait tout rêveur :
« Dis donc, Joseph, combien penses-tu que
nous en avons vu passer depuis 1804 ?
– Oh ! je ne sais pas, monsieur Goulden,
lui disais-je, au moins quatre ou cinq cent mille.
– Oui… au moins ! faisait-il. Et combien
en as-tu vu revenir ? »
Alors, je comprenais ce qu’il voulait dire, et
je lui répondais :
« Peut-être qu’ils rentrent par Mayence,
ou par une autre route… Ça n’est pas possible
autrement ! »
Mais il hochait la tête et disait :
« Ceux que tu n’as pas vus revenir sont
morts, comme des centaines et des centaines de mille autres
mourront, si le Bon Dieu n’a pas pitié de nous, car l’Empereur
n’aime que la guerre. Il a déjà versé plus de sang pour donner des
couronnes à ses frères, que notre grande Révolution pour gagner les
Droits de l’Homme. »
Nous nous remettions à l’ouvrage, et les
réflexions de M. Goulden me donnaient terriblement à
réfléchir.
Je boitais bien un peu de la jambe gauche,
mais tant d’autres avec des défauts avaient reçu leur feuille de
route tout de même !
Ces idées me trottaient dans la tête, et quand
j’y pensais longtemps, j’en concevais un grand chagrin. Cela me
paraissait terrible, non seulement parce que je n’aimais pas la
guerre, mais encore parce que je voulais me marier avec ma cousine
Catherine des Quatre-Vents. Nous avions été en quelque sorte élevés
ensemble. On ne pouvait voir de fille plus fraîche, plus
riante ; elle était blonde, avec de beaux yeux bleus, des
joues roses et des dents blanches comme du lait ; elle
approchait de ses dix-huit ans ; moi j’en avais dix-neuf, et
la tante Margrédel paraissait contente de me voir arriver tous les
dimanches de grand matin pour déjeuner et dîner avec eux.
Catherine et moi nous allions derrière, dans
le verger ; nous mordions dans les mêmes pommes et dans les
mêmes poires ; nous étions les plus heureux du monde.
C’est moi qui conduisais Catherine à la
grand-messe et aux vêpres, et, pendant la fête, elle ne quittait
pas mon bras et refusait de danser avec les autres garçons du
village. Tout le monde savait que nous devions nous marier un
jour ; mais, si j’avais le malheur de partir à la
conscription, tout était fini. Je souhaitais d’être encore mille
fois plus boiteux, car, dans ce temps, on avait d’abord pris les
garçons, puis les hommes mariés, sans enfants, et malgré moi je
pensais : « Est-ce que les boiteux valent mieux que les
hommes mariés ? est-ce qu’on ne pourrait pas me mettre dans la
cavalerie ! » Rien que cette idée me rendait
triste ; j’aurais déjà voulu me sauver.
Mais c’est principalement en 1812, au
commencement de la guerre contre les Russes, que ma peur grandit.
Depuis le mois de février jusqu’à la fin de mai, tous les jours
nous ne vîmes passer que des régiments et des régiments : des
dragons, des cuirassiers, des carabiniers, des hussards, des
lanciers de toutes les couleurs, de l’artillerie, des caissons, des
ambulances, des voitures, des vivres, toujours et toujours, comme
une rivière qui coule et dont on ne voit jamais la fin.
Je me rappelle encore que cela commença par
des grenadiers qui conduisaient de gros chariots attelés de bœufs
Ces bœufs étaient à la place de chevaux, pour servir de vivres plus
tard, quand on aurait usé les munitions. Chacun disait :
« Quelle belle idée ! Quand les grenadiers ne pourront
plus nourrir les bœufs, les bœufs nourriront les grenadiers. »
Malheureusement, ceux qui disaient cela ne savaient pas que les
bœufs ne peuvent faire que sept à huit lieues par jour, et qu’il
leur faut sur huit jours de marche un jour de repos au moins ;
de sorte que ces pauvres bêtes avaient déjà la corne usée, la lèvre
baveuse, les yeux hors de la tête, le cou rivé dans les épaules, et
qu’il ne leur restait plus que la peau et les os. Il en passa
pendant trois semaines de cette espèce, tout déchirés de coups de
baïonnette. La viande devint bon marché, car on abattait beaucoup
de ces bœufs, mais peu de personnes en voulaient, la viande malade
étant malsaine. Ils n’arrivèrent pas seulement à vingt lieues de
l’autre côté du Rhin.
Après cela, nous ne vîmes plus défiler que des
lances, des sabres et des casques. Tout s’engouffrait sous la porte
de France, traversait la place d’Armes en suivant la grande route,
et sortait par la porte d’Allemagne.
Enfin, le 10 mai de cette année 1812, de grand
matin, les canons de l’arsenal annoncèrent le maître de tout. Je
dormais encore lorsque le premier coup partit, en faisant grelotter
mes petites vitres comme un tambour, et presque aussitôt
M. Goulden, avec la chandelle allumée, ouvrit ma porte en me
disant :
« Lève-toi… le voilà ! »
Nous ouvrîmes la fenêtre. Au milieu de la nuit
je vis s’avancer au grand trot, sous la porte de France, une
centaine de dragons dont plusieurs portaient des torches ; ils
passèrent avec un roulement et des piétinements terribles ;
leurs lumières serpentaient sur la façade des maisons comme de la
flamme, et de toutes les croisées on entendait partir des cris sans
fin : Vive l’Empereur ! vive
l’Empereur !
Je regardais la voiture, quand un cheval
s’abattit sur le poteau du boucher Klein, où l’on attachait les
bœufs ; le dragon tomba comme une masse, les jambes écartées,
le casque dans la rigole, et presque aussitôt une tête se pencha
hors de la voiture pour voir ce qui se passait, une grosse tête
pâle et grasse, une touffe de cheveux sur le front : c’était
Napoléon ; il tenait la main levée comme pour prendre une
prise de tabac, et dit quelques mots brusquement. L’officier qui
galopait à côté de la portière se pencha pour lui répondre. Il prit
sa prise et tourna le coin, pendant que les cris redoublaient et
que le canon tonnait.
Voilà tout ce que je vis.
L’Empereur ne s arrêta pas à Phalsbourg ;
tandis qu’il courait déjà sur la route de Saverne, le canon tirait
ses derniers coups. Puis le silence se rétablit. Les hommes de
garde à la porte de France relevèrent le pont, et le vieil horloger
me dit :
« Tu l’as vu ?
– Oui, monsieur Goulden.
– Eh bien, fit-il, cet homme-là tient notre
vie à tous dans sa main ; il n’aurait qu’à souffler sur nous
et ce serait fini. Bénissons le Ciel qu’il ne soit pas méchant, car
sans cela le monde verrait des choses épouvantables, comme du temps
des rois sauvages et des Turcs. »
Il semblait tout rêveur ; au bout d’une
minute, il ajouta :
« Tu peux te recoucher ; voici trois
heures qui sonnent. »
Il rentra dans sa chambre, et je me remis dans
mon lit. Le grand silence qu’il faisait dehors me paraissait
extraordinaire après tout ce tumulte, et jusqu’au petit jour je ne
cessai point de rêver à l’Empereur. Je songeais aussi au dragon et
je désirais savoir s’il était mort du coup. Le lendemain nous
apprîmes qu’on l’avait porté à l’hôpital et qu’il en
reviendrait.
Depuis ce jour jusqu’à la fin du mois de
septembre, on chanta beaucoup de Te Deum à l’église, et
l’on tirait chaque fois vingt et un coups de canon pour quelque
nouvelle victoire. C’était presque toujours le matin ;
M. Goulden aussitôt s’écriait :
« Hé, Joseph ! encore une bataille
gagnée ! cinquante mille hommes à terre, vingt-cinq drapeaux,
cent bouches à feu !… Tout va bien… tout va bien. – Il ne
reste maintenant qu’à faire une nouvelle levée pour remplacer ceux
qui sont morts ! »
Il poussait ma porte, et je le voyais tout
gris, tout chauve, en manches de chemise, le cou nu, qui se lavait
la figure dans la cuvette.
« Est-ce que vous croyez, monsieur
Goulden, lui disais-je dans un grand trouble, qu’on prendra les
boiteux ?
– Non, non, faisait-il avec bonté, ne crains
rien, mon enfant ; tu ne pourrais réellement pas servir. Nous
arrangerons cela. Travaille seulement bien, et ne t’inquiète pas du
reste. »
Il voyait mon inquiétude, et cela lui faisait
de la peine. Je n’ai jamais rencontré d’homme meilleur. Alors il
s’habillait pour aller remonter les horloges en ville, celles de
M. le commandant de place, de M. le maire et d’autres
personnes notables. Moi, je restais à la maison.
M. Goulden ne rentrait qu’après le Te
Deum ; il ôtait son grand habit noisette, remettait sa
perruque dans la boîte et tirait de nouveau son bonnet de soie sur
ses oreilles, en disant :
« L’armée est à Vilna – ou bien à
Smolensk –, je viens d’apprendre ça chez M. le commandant.
Dieu veuille que nous ayons le dessus cette fois encore et qu’on
fasse la paix ; le plus tôt sera le mieux, car la guerre est
une chose terrible. »
Je pensais aussi que, si nous avions la paix,
on n’aurait plus besoin de tant d’hommes et que je pourrais me
marier avec Catherine. Chacun peut s’imaginer combien de vœux je
formais pour la gloire de l’Empereur.