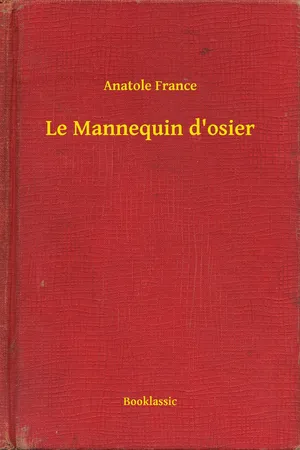Dans son cabinet de travail, au bruit clair et mécanique du piano sur lequel ses filles exécutaient, non loin, des exercices difficiles, M. Bergeret, maître de conférences à la Faculté des lettres, préparait sa leçon sur le huitième livre de l’Énéide. Le cabinet de travail de M. Bergeret n’avait qu’une fenêtre, mais grande, qui en occupait tout un côté et qui laissait entrer plus d’air que de lumière, car les croisées en étaient mal jointes et les vitres offusquées par un mur haut et proche. Poussée contre cette fenêtre, la table de M. Bergeret en recevait les reflets d’un jour avare et sordide. À vrai dire, ce cabinet de travail, où le maître de conférences aiguisait ses fines pensées d’humanité, n’était qu’un recoin difforme, ou plutôt un double recoin derrière la cage du grand escalier dont la rotondité indiscrète, s’avançant vers la fenêtre, ne ménageait à droite et à gauche que deux angles déraisonnables et inhumains. Opprimé par ce monstrueux ventre de maçonnerie, qu’habillait un papier vert, M. Bergeret avait trouvé à peine, dans cette pièce hostile, en horreur à la géométrie et à la raison élégante, une étroite surface plane où ranger ses livres sur des planches de sapin, au long desquelles la file jaune des Tübner baignait dans une ombre éternelle. Lui-même, pressé contre la fenêtre, y écrivait d’un style glacé par l’air malin, heureux s’il ne trouvait pas ses manuscrits bouleversés et tronqués, et ses plumes de fer entrouvrant un bec mutilé ! C’était l’effet ordinaire du passage de Mme Bergeret dans le cabinet du professeur, où elle venait écrire le linge et la dépense. Et Mme Bergeret y déposait le mannequin sur lequel elle drapait les jupes taillées par elle. Il était là, debout, contre les éditions savantes de Catulle et de Pétrone, le mannequin d’osier, image conjugale.
M. Bergeret préparait sa leçon sur le huitième livre de l’Énéide, et il aurait trouvé dans ce travail, à défaut de joie, la paix de l’esprit et l’inestimable tranquillité de l’âme, s’il n’avait pas quitté les particularités de métrique et de linguistique, auxquelles il se devait attacher uniquement pour considérer le génie, l’âme et les formes de ce monde antique dont il étudiait les textes, pour s’abandonner au désir de voir de ses yeux ces rivages dorés, cette mer bleue, ces montagnes roses, ces belles campagnes où le poète conduit ses héros, et pour déplorer amèrement qu’il ne lui eût pas été permis, comme à Gaston Boissier, comme à Gaston Deschamps, de visiter les rives où fut Troie, de contempler les paysages virgiliens, de respirer le jour en Italie, en Grèce et dans la sainte Asie. Son cabinet de travail lui en parut triste, et un grand dégoût envahit son cœur. Il fut malheureux par sa faute. Car toutes nos misères véritables sont intérieures et causées par nous-mêmes. Nous croyons faussement qu’elles viennent du dehors, mais nous les formons au-dedans de nous de notre propre substance.
Ainsi M. Bergeret, sous l’énorme cylindre de plâtre, composait sa tristesse et ses ennuis en songeant que sa vie était étroite, recluse et sans joie, que sa femme avait l’âme vulgaire et n’était plus belle, et que les combats d’Énée et de Turnus étaient insipides. Il fut distrait de ces pensées par la venue de M. Roux, son élève, qui, faisant son année de service militaire, se présenta au maître en pantalon rouge et capote bleue.
– Hé ! dit M. Bergeret, voici qu’ils ont travesti mon meilleur latiniste en héros !
Et comme M. Roux se défendait d’être un héros :
– Je m’entends, dit le maître de conférences. J’appelle proprement héros un porteur de sabre. Si vous aviez un bonnet à poil, je vous nommerais grand héros. C’est bien le moins qu’on flatte un peu les gens qu’on envoie se faire tuer. On ne saurait les charger à meilleur marché de la commission. Mais puissiez-vous, mon ami, n’être jamais immortalisé par un acte héroïque, et ne devoir qu’à vos connaissances en métrique latine les louanges des hommes ! C’est l’amour de mon pays qui seul m’inspire ce vœu sincère. Je me suis persuadé, par l’étude de l’histoire, qu’il n’y avait guère d’héroïsme que chez les vaincus et dans les déroutes. Les Romains, peuple moins prompt à la guerre qu’on ne pense et qui fut souvent battu, n’eurent des Decius qu’aux plus fâcheux moments. À Marathon, l’héroïsme de Cynégire est situé précisément au point faible pour les Athéniens qui, s’ils arrêtèrent l’armée barbare, ne purent l’empêcher de s’embarquer avec toute la cavalerie persane qui venait de se rafraîchir dans la plaine. Il ne paraît pas d’ailleurs que les Perses aient fait grand effort dans cette bataille.
M. Roux posa son sabre dans un coin du cabinet et s’assit sur la chaise que lui offrit son maître.
– Il y a, dit-il, quatre mois que je n’ai entendu une parole intelligente. Moi-même, j’ai concentré depuis quatre mois toutes les facultés de mon esprit à me concilier mon caporal et mon sergent-major par des largesses mesurées. C’est la seule partie de l’art militaire que je sois parvenu à posséder parfaitement. C’est aussi la plus importante. Cependant j’ai perdu toute aptitude à comprendre les idées générales et les pensées subtiles. Et vous me dites, mon cher maître, que les Grecs ont été vaincus à Marathon et que les Romains n’étaient pas belliqueux. Ma tête se perd.
M. Bergeret répondit tranquillement :
– J’ai dit seulement que les forces barbares n’avaient pas été entamées par Miltiade. Quant aux Romains, ils n’étaient pas essentiellement militaires, puisqu’ils firent des conquêtes profitables et durables, au rebours des vrais militaires qui prennent tout et ne gardent rien, comme, par exemple, les Français.
« Ceci encore est à noter que, dans la Rome des rois, les étrangers n’étaient pas admis à servir comme soldats. Mais les citoyens, au temps du bon roi Servius Tullius, peu jaloux de garder seuls l’honneur des fatigues et des périls, y convièrent les étrangers domiciliés dans la ville. Il y a des héros ; il n’y a pas de peuples de héros ; il n’y a pas d’armées de héros. Les soldats n’ont jamais marché que sous peine de mort. Le service militaire fut odieux même à ces pâtres du Latium qui acquirent à Rome l’empire du monde et la gloire d’être déesse. Porter le fourniment leur fut si dur que le nom de ce fourniment, ærumna, exprima ensuite chez eux l’accablement, la fatigue du corps et de l’esprit, la misère, le malheur, les désastres. Bien menés, ils firent, non point des héros, mais de bons soldats et de bons terrassiers ; peu à peu ils conquirent le monde et le couvrirent de routes et de chaussées. Les Romains ne cherchèrent jamais la gloire : ils n’avaient pas d’imagination. Ils ne firent que des guerres d’intérêt, absolument nécessaires. Leur triomphe fut celui de la patience et du bon sens.
« Les hommes se déterminent par leur sentiment le plus fort. Chez les soldats, comme dans toutes les foules, le sentiment le plus fort est la peur. Ils vont à l’ennemi comme au moindre danger. Les troupes en ligne sont mises, de part et d’autre, dans l’impossibilité de fuir. C’est tout l’art des batailles. Les armées de la République furent victorieuses parce qu’on y maintenait avec une extrême rigueur les mœurs de l’ancien régime, qui étaient relâchées dans les camps des alliés. Nos généraux de l’an II étaient des sergents la Ramée qui faisaient fusiller une demi-douzaine de conscrits par jour pour donner du cœur aux autres, comme disait Voltaire, et les animer du grand souffle patriotique.
– C’est bien possible, dit M. Roux. Mais il y a autre chose. C’est la joie innée de tirer des coups de fusil. Vous savez, mon cher maître, que je ne suis pas un animal destructeur. Je n’ai pas de goût pour le militarisme. J’ai même des idées humanitaires très avancées et je crois que la fraternité des peuples sera l’œuvre du socialisme triomphant. Enfin j’ai l’amour de l’humanité. Mais, dès qu’on me fiche un fusil dans la main, j’ai envie de tirer sur tout le monde. C’est dans le sang…
M. Roux était un beau garçon robuste, qui s’était vite débrouillé au régiment. Les exercices violents convenaient à son tempérament sanguin. Et comme il était, de plus, excessivement rusé, il avait, non pas pris le métier en goût, mais rendu supportable la vie de caserne, et conservé sa santé et sa belle humeur.
– Vous n’ignorez pas, cher maître, ajouta-t-il, la force de la suggestion. Il suffit de donner à un homme une baïonnette au bout d’un fusil pour qu’il l’enfonce dans le ventre du premier venu et devienne, comme vous dites, un héros.
La voix méridionale de M. Roux vibrait encore quand Mme Bergeret entra dans le cabinet de travail, où ne l’attirait point d’ordinaire la présence de son mari. M. Bergeret remarqua qu’elle avait sa belle robe de chambre rose et blanche.
Elle étala une grande surprise de trouver là M. Roux ; elle venait, disait-elle, demander à M. Bergeret un livre de poésie, pour se distraire.
Le maître de conférences remarqua encore, sans y prendre d’ailleurs aucun intérêt, qu’elle était devenue tout à coup presque jolie, aimable.
M. Roux ôta de dessus un vieux fauteuil de moleskine le Dictionnaire de Freund et fit asseoir Mme Bergeret. M. Bergeret considéra tour à tour les in-quarto poussés contre le mur et Mme Bergeret qui y avait été substituée dans le fauteuil et il songea que ces deux groupes de substance, si différenciés qu’ils fussent à l’heure actuelle et si divers quant à l’aspect, la nature et l’usage, avaient présenté une similitude originelle et l’avaient longtemps gardée lorsque l’un et l’autre, le dictionnaire et la dame, flottaient encore à l’état gazeux dans la nébuleuse primitive.
« Car enfin, se disait-il, Mme Bergeret nageait dans l’infini des âges, informe, inconsciente, éparse en légères lueurs d’oxygène et de carbone. Les molécules qui devaient un jour composer ce lexique latin gravitaient en même temps, durant les âges, dans cette même nébuleuse d’où devaient sortir enfin des monstres, des insectes et un peu de pensée. Il a fallu une éternité pour produire mon dictionnaire et ma femme, monuments de ma pénible vie, formes défectueuses, parfois importunes. Mon dictionnaire est plein d’erreurs. Amélie contient une âme injurieuse dans un corps épaissi. C’est pourquoi il n’y a guère à espérer qu’une éternité nouvelle crée enfin la science et la beauté. Nous vivons un moment et nous ne gagnerions rien à vivre toujours. Ce n’est ni le temps, ni l’espace qui fit défaut à la nature, et nous voyons son ouvrage ! »
Et M. Bergeret parla encore dans son cœur inquiet :
« Mais qu’est-ce que le temps, sinon les mouvements mêmes de la nature, et puis-je dire qu’ils sont longs ou qu’ils sont courts ? La nature est cruelle et banale. Mais d’où vient que je le sais ? Et comment me tenir hors d’elle pour la connaître et la juger ? Je trouverais l’univers meilleur, peut-être, si j’y avais une autre place. »
Et M. Bergeret, sortant de sa rêverie, se pencha pour assurer contre la muraille l’amas chancelant des in-quarto.
– Vous êtes un peu bruni, monsieur Roux, dit Mme Bergeret, et, il me semble, un peu maigri. Mais cela ne vous va pas mal.
– Les premiers mois sont fatigants, répondit M. Roux. Évidemment, l’exercice à six heures du matin, dans la cour du quartier, par huit degrés de froid, est pénible, et l’on ne surmonte pas tout de suite les dégoûts de la chambrée. Mais la fatigue est un grand remède et l’abêtissement une précieuse ressource. On vit dans une stupeur qui fait l’effet d’une couche d’ouate. Comme on ne dort, la nuit, que d’un sommeil à tout moment interrompu, on n’est pas bien éveillé le jour. Et cet état d’automatisme léthargique où l’on demeure est favorable à la discipline, conforme à l’esprit militaire, utile au bon ordre physique et moral des troupes.
En somme, M. Roux n’avait pas à se plaindre. Mais il avait un ami, Deval, élève, pour le malais, de l’École des langues orientales, qui était malheureux et accablé. Deval, intelligent, instruit, courageux, mais roide de corps et d’esprit, gauche et maladroit, avait un sentiment précis de la justice qui l’éclairait sur ses droits et sur ses devoirs. Il souffrait de cette clairvoyance. Deval était depuis vingt-quatre heures à la caserne quand le sergent Lebrec lui demanda, dans des termes qu’il fallut adoucir pour l’oreille de Mme Bergeret, quelle personne peu estimable avait bien pu donner le jour à un veau aussi mal aligné que le numéro 5. Deval fut lent à s’assurer qu’il était lui-même le veau numéro 5. Il attendit d’être consigné pour n’avoir plus de doute à ce sujet. Et même alors il ne comprit pas qu’on offensât l’honneur de Mme Deval, sa mère, parce qu’il était lui-même inexactement aligné. La responsabilité inattendue de sa mère en cette circonstance contrariait son idéal de justice. Il en garde, après quatre mois, un étonnement douloureux.
– Votre ami Deval, répondit M. Bergeret, avait pris à contresens un discours martial, que je place parmi ceux qui ne peuvent que hausser le moral des hommes et exciter leur émulation en leur donnant envie de mériter les galons, afin de tenir à leur tour de semblables propos, qui marquent évidemment la supériorité de celui qui les tient sur ceux auxquels il les adresse. Il faut prendre garde de ne pas diminuer la prérogative des chefs armés, comme le fit, dans une circulaire récente, un ministre de la Guerre civil et plein de civilité, urbain et plein d’urbanité, honnête homme qui, pénétré de la dignité du citoyen militaire, prescrivit aux officiers et aux sous-officiers de ne pas tutoyer leurs hommes, sans s’apercevoir que le mépris de l’inférieur est un grand principe d’émulation et le fondement de la hiérarchie. Le sergent Lebrec parlait comme un héros qui forme des héros. Il m’a été possible de rétablir sa harangue dans la forme originale ; car je suis philologue. Eh bien, je n’hésite pas à dire que ce sergent Lebrec fut sublime en associant l’honneur d’une famille à l’alignement d’un conscrit dont la bonne tenue importe au succès des batailles, et en rattachant de la sorte, jusque dans ses origines, le numéro 5 au régiment et au drapeau…
« Après cela, vous me direz peut-être que, donnant dans le travers commun à tous les commentateurs, je prête à mon auteur des intentions qu’il n’avait pas. Je vous accorde qu’il y eut une part d’inconscience dans le discours mémorable du sergent Lebrec. Mais c’est là le génie. On le fait éclater sans en mesurer la force.
M. Roux répondit en souriant qu’il croyait aussi qu’il y avait une certaine part d’inconscience dans l’inspiration du sergent Lebrec.
Mais Mme Bergeret dit sèchement à M. Bergeret :
– Je ne te comprends pas, Lucien. Tu ris de ce qui n’est pas risible et l’on ne sait jamais si tu plaisantes ou si tu es sérieux. Il n’y a pas de conversation possible avec toi.
– Ma femme pense comme le doyen, dit M. Bergeret. Il faut leur donner raison à tous deux.
– Ah ! s’écria Mme Bergeret, je te conseille de parler du doyen ! Tu t’es ingénié à lui déplaire et maintenant tu te mords les doigts de ton imprudence. Tu as trouvé moyen encore de te brouiller avec le recteur. Je l’ai rencontré dimanche à la promenade, où j’étais avec mes filles ; et il m’a à peine saluée.
Elle se tourna vers le jeune soldat :
– Monsieur Roux, je sais que mon mari vous aime beaucoup. Vous êtes son élève préféré. Il vous prédit un brillant avenir.
M. Roux, basané, crépu, les dents éclatantes, sourit sans modestie.
– Monsieur Roux, persuadez à mon mari de ménager les gens qui peuvent lui être utiles. Le vide se fait autour de nous.
– Quelle idée, madame ! murmura M. Roux.
Et il détourna la conversation.
– Les paysans ont de la peine à tirer leurs trois ans. Ils souffrent. Mais on ne le sait pas, parce qu’ils n’expriment rien que d’une façon commune. Loin de la terre qu’ils aiment d’un amour animal, ils traînent leur douleur muette, monotone et profonde. Ils n’ont pour les distraire, dans l’exil et dans la captivité, que la peur des chefs et la fatigue du métier. Tout leur est étranger et difficile. Il y a dans ma compagnie deux Bretons qui n’ont pu retenir, après six semaines de leçons, le nom de notre colonel. Chaque matin, alignés devant le sergent, nous apprenons ce nom avec eux, l’instruction militaire étant la même pour tous. Notre colonel se nomme Dupont. Il en va ainsi de tous les exercices. Les hommes ingénieux et adroits y attendent indéfiniment les stupides.
M. Bergeret demanda si les officiers cultivaient, comme le sergent Lebrec, l’éloquence martiale.
– J’ai, répondit M. Roux, un capitaine tout jeune qui observe, au contraire, la plus exquise politesse. C’est un esthète, un rose-croix. Il peint des vierges et des anges très pâles, dans des ciels roses et verts. C’est moi qui fais les légendes de ses tableaux. Pendant que Deval est de corvée dans la cour du quartier, je suis de service chez mon capitaine qui me commande des vers. Il est charmant. Il s’appelle Marcel de Lagère, et il expose à l’Œuvre sous le pseudonyme de Cyne.
– Est-ce qu’il est aussi un héros ? demanda M. Bergeret.
– Un saint Georges, répondit M. Roux. Il se fait une idée mystique du métier militaire. Il dit que c’est un état idéal. On va, sans voir, au but inconnu. On s’achemine, pieux, chaste et grave, vers des dévouements mystérieux et nécessaires. Il est exquis. Je lui apprends le vers libre et la prose rythmée. Il commence à faire des proses sur l’armée. Il est heureux, il est tranquille, il est doux. Une seule chose le désole, c’est le drapeau. Il trouve que le bleu, le blanc et le rouge en sont d’une violence inique. Il voudrait un drapeau rose ou lilas. Il a des rêves de bannières célestes. « Encore, dit-il avec mélancolie, si les trois couleurs partaient de la hampe, comme trois flammes d’oriflamme, ce serait supportable. Mais leur disposition verticale coupe les plis flottants avec une absurdité cruelle ! » Il souffre. Mais il est patient et courageux. Je vous répète que c’est un saint Georges.
– Sur le portrait que vous m’en faites, dit Mme Bergeret, j’éprouve pour lui une vive sympathie.
Elle dit et regarda M. Bergeret avec sévérité.
– Mais les autres officiers, demanda M. Bergeret, ne les étonne-t-il pas ?
– Nullement, répondit M. Roux. Au mess et dans les réunions, il ne dit rien. Il a l’air d’un officier comme un autre.
– Et les soldats, quelle idée se font-ils de lui ?
– Au quartier, les hommes ne voient jamais leurs offici...