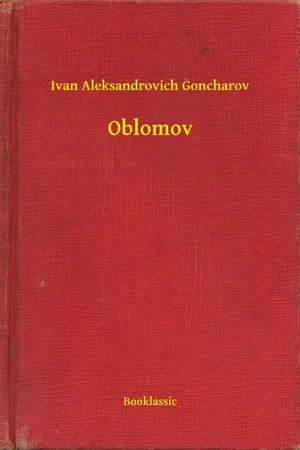M. Élie Oblomoff demeurait, rue Gorokhovaya[1], dans une de ces grandes maisons dont les locataires suffiraient à peupler une ville de district. C’était le matin, et M. Élie Oblomoff était au lit, dans son appartement.
M. Oblomoff pouvait avoir de trente-deux à trente-trois ans : il était de taille moyenne et d’un extérieur agréable ; il avait les yeux gris foncé, mais ses traits accusaient l’absence de toute idée profonde et arrêtée.
La pensée, comme un oiseau, se promenait librement sur son visage, voltigeait dans ses yeux, se posait sur ses lèvres à demi ouvertes et se cachait dans les plis de son front, pour disparaître ensuite tout à fait ; alors, sur toute la physionomie s’étendait une teinte uniforme d’insouciance. L’insouciance se répandait de là dans les poses du corps et jusque dans les plis de la robe de chambre.
Quelquefois le regard devenait terne et exprimait la fatigue ou l’ennui ; mais ni la fatigue ni l’ennui ne pouvaient, même pour un instant, altérer la douceur de la physionomie, tant cette douceur, qui était l’expression habituelle, non-seulement du visage, mais de l’âme, se peignait clairement dans les regards, le sourire et dans chaque mouvement de la tête et de la main.
Un observateur froid et superficiel qui eût jeté un coup d’œil en passant sur Oblomoff, aurait dit : « Ce doit être un bon enfant, un homme qui a le cœur sur la main. » Mais un philosophe doué d’un cœur plus chaud et d’une intelligence plus vive, après avoir longtemps regardé Élie, aurait emporté de cet examen une très-agréable impression.
Le teint d’Oblomoff n’était ni rose, ni brun, ni positivement pâle, mais d’une couleur vague ; il peut se faire qu’il parût ainsi parce qu’Élie s’était affaissé avant l’âge : était-ce par suite du manque d’air ou du manque d’exercice ? peut-être de l’un et de l’autre.
À en juger par le ton trop mat et trop blême du cou, des mains menues et potelées, et par la mollesse des épaules, Oblomoff semblait, en général, beaucoup trop délicat pour un homme. Dans l’émotion même, ses mouvements étaient alanguis par une paresse qui ne manquait pas de grâce.
Si du fond de l’âme s’élevait un nuage de soucis qui l’assombrissait, son front se plissait et on y apercevait la lutte du doute, de la tristesse et de la crainte ; mais rarement cette lutte aboutissait à une idée arrêtée, et plus rarement encore se résumait dans une résolution. Elle s’évaporait en un soupir et s’évanouissait dans l’apathie et la somnolence.
Comme le costume habituel d’Élie allait bien à la placidité de sa figure et à la mollesse de son corps ! Il portait un khalate à la persane, mais un khalate véritablement oriental qui ne rappelait en rien l’Europe, sans houppe, ni velours, ni taille, – si ample qu’Oblomoff aurait pu s’en envelopper deux fois. Il serait encore resté assez d’étoffe pour l’habit de chasse d’un Parisien.
Les manches, suivant l’usage invariable de l’Asie, allaient toujours en s’élargissant des doigts à l’épaule. Quoique ce khalate eût perdu de sa première fraîcheur, et par endroits eût remplacé son éclat primitif et naturel par un lustre acquis, il gardait néanmoins les brillantes couleurs de l’Orient, et le tissu en était encore solide. Aux yeux d’Élie, son khalate possédait mille qualités inappréciables : il était souple et moelleux, ne pesait nullement au corps et se pliait comme un esclave obéissant à ses moindres mouvements.
Élie ne portait jamais à la maison ni cravate ni gilet, parce qu’il aimait à être à l’aise. Ses pantoufles étaient longues, larges et molles ; lorsque sans regarder il descendait du lit sur le plancher, ses pieds y entraient infailliblement du premier coup.
Si Oblomoff demeurait au lit, ce n’était point par nécessité, comme quand on est malade, ou qu’on tombe de fatigue et de sommeil, ni par volupté, comme ferait un paresseux : garder le lit était son état normal. Quand il restait chez lui, – et il ne sortait presque jamais – il était toujours au lit, et toujours nécessairement dans la même pièce où nous l’avons trouvé, et qui lui servait de chambre à coucher, de cabinet et de salon de réception.
Il en avait encore trois autres, mais il n’y jetait qu’un regard en passant, quelquefois le matin, quand le domestique balayait son cabinet, ce qui n’arrivait pas tous les jours. Les meubles y étaient couverts de housses, les stores baissés.
La chambre où Élie était couché semblait à première vue parfaitement ornée. On y voyait un bureau en acajou, deux sofas en damas, et un joli paravent brodé d’oiseaux et de fruits fantastiques, il y avait aussi des tentures de soie, des tapis, plusieurs tableaux, des bronzes, des porcelaines et quantité de charmants bibelots. Mais l’ensemble de ces objets avait un sens qu’un œil exercé aurait démêlé sur-le-champ.
On y lisait le désir de garder tant bien que mal le décorum sans se donner pour cela aucune peine. C’est certainement dans ce seul but qu’Élie avait arrangé son cabinet. Un goût délicat n’aurait pu s’accommoder de ces chaises d’acajou lourdes et disgracieuses, ni de ces étagères vacillantes. Le dossier d’un des sofas s’était affaissé, et l’acajou plaqué s’était décollé par places. Les tableaux, les vases et les bibelots étaient dans le même état.
Le maître lui-même promenait sur l’arrangement de son cabinet un regard morne et distrait qui semblait dire : « Qui diable m’a fourré tant de choses, là-dedans ? » Il suffisait d’un peu plus d’attention pour remarquer cet abandon et cette négligence, résultat de la froide indifférence du propriétaire, et peut-être encore plus de son domestique Zakhare. Le long des murs, autour des tableaux s’accrochaient en festons des toiles d’araignées, imprégnées de poussière.
Les miroirs, au lieu de refléter les objets, ressemblaient aux tables de Moïse : sur la poussière on aurait pu écrire des notes. Les tapis étaient pleins de taches. Un essuie-mains traînait sur un sofa et il se passait rarement un matin sans qu’on vît sur la table une assiette, une salière, un os à demi rongé et des miettes de pain, débris du souper de la veille.
Sans cette assiette et sans une pipe encore chaude, appuyée contre le lit, ou bien encore sans le maître qui y était couché, on aurait pu croire la chambre inhabitée, tant elle apparaissait couverte de poussière, pleine d’objets fanés, et vide de tout ce qui indique la présence d’un homme.
On apercevait bien sur les étagères deux ou trois livres ouverts, un journal abandonné, et même sur le bureau un encrier avec des plumes ; mais ces livres étaient souillés de poussière et jaunis par le temps ; on voyait qu’ils avaient été jetés là de longue date. Le journal était de l’année précédente et, si l’on avait trempé une plume dans l’encrier, peut-être qu’une mouche effrayée s’en serait échappée en bourdonnant.
Oblomoff, contrairement à son habitude, s’était réveillé de très-bon matin, vers les huit heures. Il était en proie à une forte préoccupation. Sa figure exprimait tour à tour de vagues sentiments de crainte, d’ennui et de colère. On devinait qu’il souffrait d’une lutte intérieure et que le raisonnement n’était pas encore venu à son secours.
Le fait est qu’Élie avait reçu la veille des nouvelles fâcheuses de son staroste[2]. On se figure bien de quelle nature sont les nouvelles fâcheuses que doit annoncer la lettre d’un staroste : il ne peut y être question que d’une mauvaise année, d’arriérés, de diminution de revenus, etc. Cependant le staroste avait déjà donné des avis pareils à son seigneur la dernière et l’avant-dernière année, mais cette fois la malencontreuse lettre avait ému Élie comme l’eût fait toute autre surprise désagréable.
Et il y avait de quoi ! Ne fallait-il pas penser à prendre des mesures ? Rendons pourtant justice à la sollicitude d’Oblomoff pour ses affaires personnelles. Au reçu de la première lettre, bien des années auparavant, il avait ébauché dans sa tête un plan de divers changements et améliorations à introduire dans la gestion de ses biens. Il se proposait d’y amener différentes innovations économiques, administratives et autres.
L’auteur était loin d’avoir médité toutes les parties de son plan, et pourtant les lettres affligeantes du staroste se répétaient chaque année, et l’obligeaient à une activité d’esprit qui troublait sa quiétude. Oblomoff reconnut qu’il était urgent, avant la fin de son œuvre, d’entreprendre quelque chose de décisif.
Aussi, dès qu’il fut réveillé, conçut-il le projet de se lever immédiatement, de se laver la figure et, après avoir pris le thé, de réfléchir profondément, d’étudier plusieurs combinaisons, de les noter et en général de s’occuper sérieusement d’affaires. Pendant une demi-heure il resta encore couché, se tourmentant de cette grande résolution. Ensuite il pensa judicieusement que tout cela pouvait se faire après le thé, que le thé, il pouvait bien, selon son habitude, le prendre au lit, et rester couché pour méditer. Ainsi fit-il.
Quand il eut pris le thé, il se souleva un peu et faillit se lever ; il jeta un coup d’œil sur ses pantoufles, et commença même à descendre un de ses pieds, mais il le retira brusquement.
La pendule sonna neuf heures et demie. Oblomoff tressaillit.
« Qu’est-ce que je fais donc ? murmura-t-il tout haut, il faut être raisonnable… il est temps de s’occuper d’affaires. Si on se laisse aller, alors… »
Il cria : Zakhare !
Dans une pièce séparée de la chambre d’Oblomoff par un petit couloir, on entendit d’abord comme le grognement d’un chien de garde, ensuite le bruit de deux pieds tombant sur le parquet. C’était Zakhare qui sautait à bas du poêle[3], où il passait toute sa journée dans une demi-somnolence.
En la chambre entra un homme déjà sur l’âge, habillé d’une veste grise, qui laissait voir la chemise sous l’aisselle, et d’un gilet gris à boutons de métal. Il avait le crâne nu comme un genou, et la face ornée de deux immenses favoris touffus, blonds, grisonnants dont chacun aurait suffi pour trois bonnes barbes.
Non-seulement Zakhare se contentait de l’image que Dieu lui avait donnée, mais il ne prenait même pas la peine de rien changer au costume qu’il avait porté à la campagne. Son habit était taillé sur un modèle apporté du village. La veste et le gilet gris lui plaisaient de plus, parce que cet habillement, presque uniforme, lui rappelait vaguement la livrée qu’il endossait jadis pour accompagner les vieux seigneurs à la messe ou dans leurs visites.
La livrée était la seule chose qui lui remît en mémoire les splendeurs de la maison des Oblomoff. Seul, cet habit retraçait aux yeux du vieux serviteur la vie seigneuriale, large et tranquille, au fond de la province. Les vieux seigneurs sont morts, les portraits de famille sont restés dans le château ; peut-être qu’ils y traînent quelque part au grenier ; les traditions de la noble famille s’effacent et ne vivent plus que dans la mémoire de quelques vieillards, qui eux aussi sont restés à la campagne. Voilà pourquoi Zakhare aimait tant son vieil habit gris.
Cet habit et certaines traces qui, dans la figure et les manières du barine[4], faisaient songer à ses ancêtres, les caprices mêmes du maître, dont Zakhare grognait tout bas et tout haut, mais qu’au fond il respectait comme la manifestation de la volonté, du droit du seigneur, étaient tout ce qui restait pour Zakhare de la grandeur passée. Sans ces caprices, il ne sentait pas le maître au-dessus de lui ; sans eux rien ne ressuscitait sa jeunesse, le village qu’ils avaient depuis longtemps quitté ensemble, et les traditions, seule chronique que gardaient sur cette antique maison les vieux serviteurs, les bonnes, les nourrices, et qu’ils se transmettaient de génération en génération.
La famille des Oblomoff avait jadis été riche et renommée dans le pays, mais ensuite, Dieu sait comment, elle s’était appauvrie, abaissée et insensiblement perdue parmi les maisons d’une noblesse moins ancienne. Seuls, les domestiques qui avaient blanchi à son service se passaient les uns aux autres la mémoire fidèle du temps qui n’était plus, et la chérissaient comme une relique.
Voilà pourquoi Zakhare aimait tant son vieil habit gris. Il se peut qu’il chérît aussi tendrement ses favoris, parce qu’il avait vu dans son enfance beaucoup d’anciens serviteurs avec ce vieil aristocratique ornement.
Oblomoff, enfoncé dans sa méditation, ne remarqua point Zakhare. Zakhare se tenait devant lui en silence ; enfin il toussa.
– Que veux-tu ? demanda Élie.
– Mais c’est vous qui m’avez appelé.
– Je l’ai appelé ? Pourquoi t’ai-je appelé ? Je l’ai oublié, dit Élie en se détirant. Va un moment chez toi, je tâcherai de me souvenir.
Zakhare sortit, et M. Oblomoff continua de rester couché et de penser à cette diable de lettre.
Un quart d’heure s’écoula.
– Allons, dit-il, assez du lit ; il faut enfin que je me lève… Cependant, si je relisais encore une fois, mais avec attention, la lettre du staroste, je pourrais ensuite me lever. Zakhare !
On entendit le même bruit de pieds, avec un grognement plus fort. Zakhare entra et Oblomoff se replongea dans sa rêverie. Zakhare attendit à peu près deux minutes, mais d’un air peu bienveillant, regardant son maître de travers ; puis il se dirigea vers la porte.
– Où vas-tu donc ? demanda brusquement Élie.
– Vous ne dites rien ; voulez-vous que je reste là ...